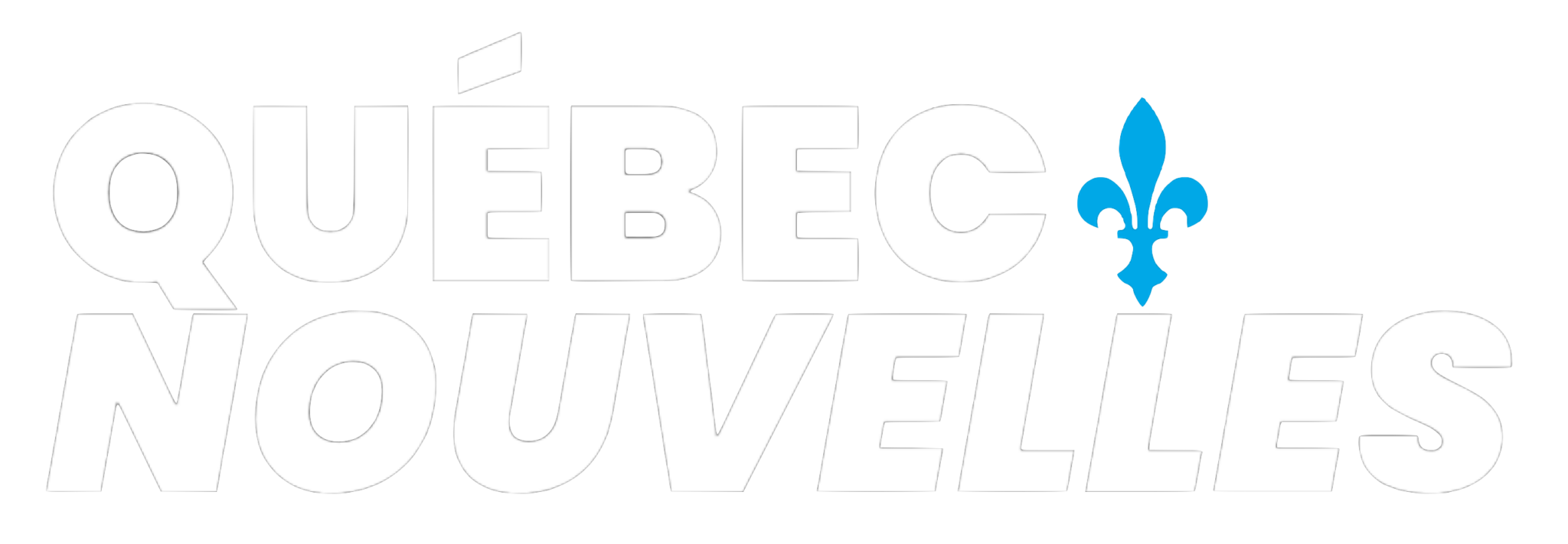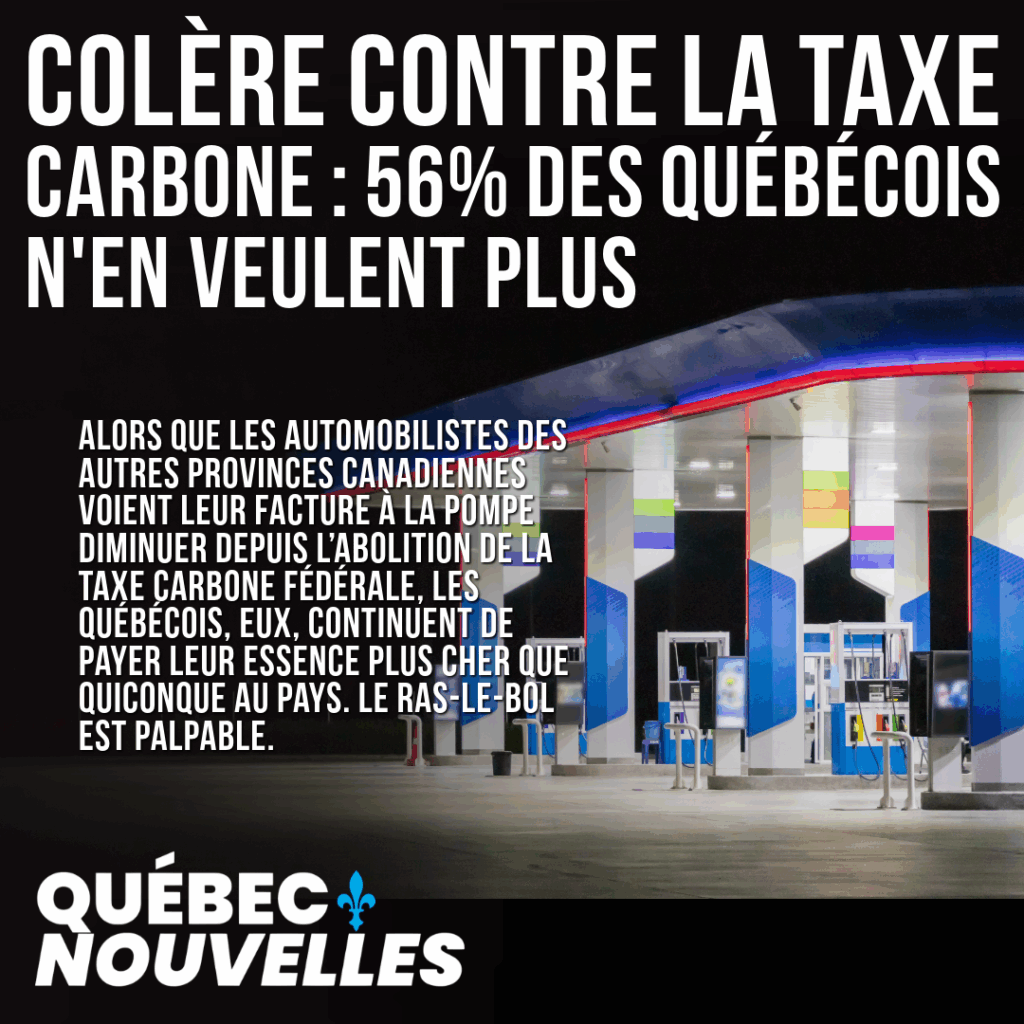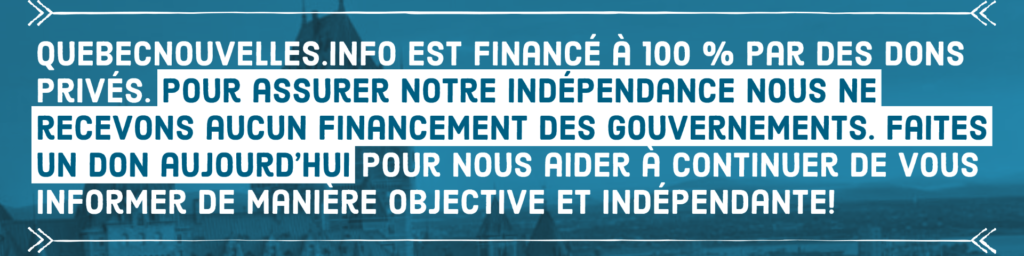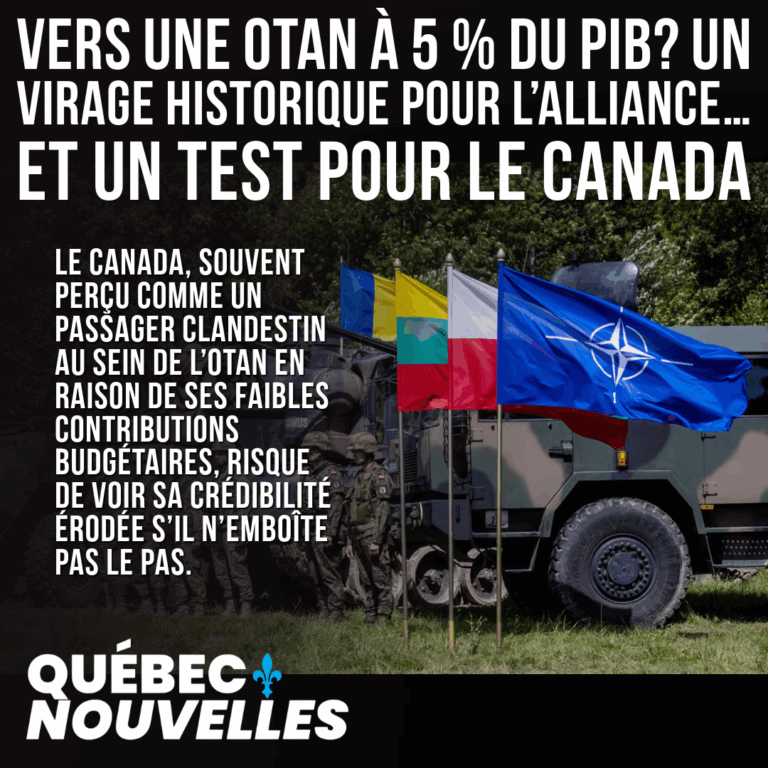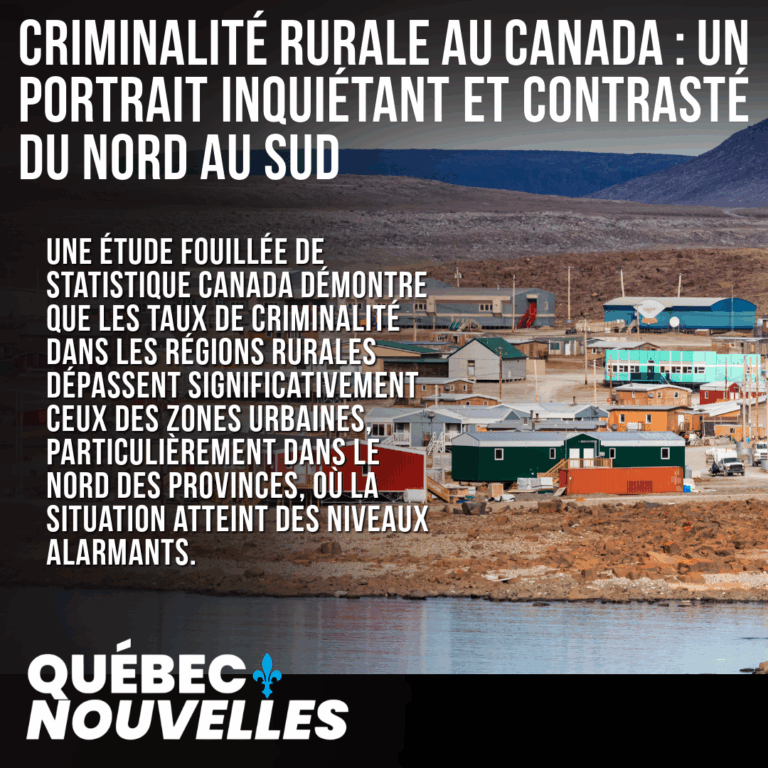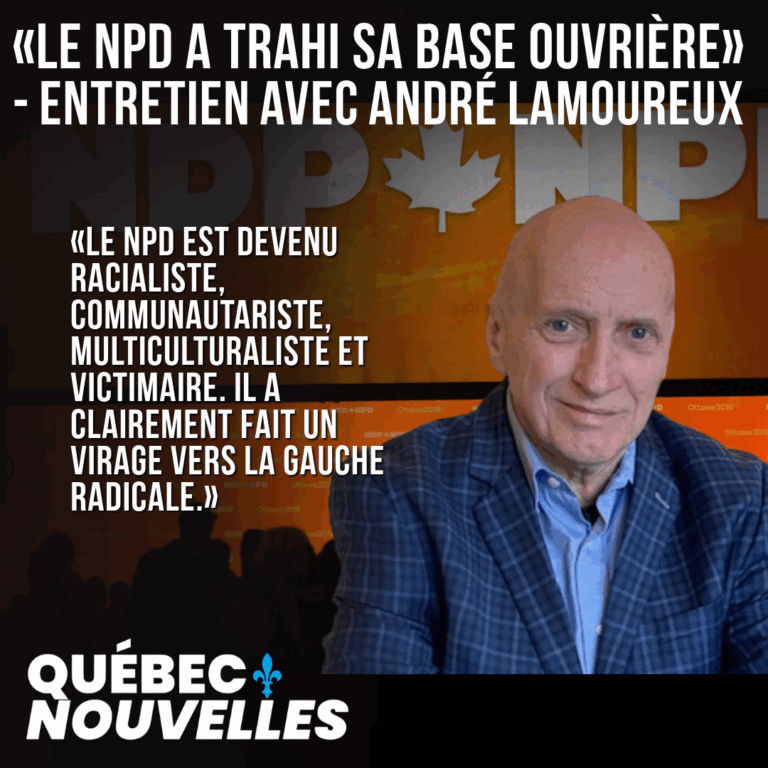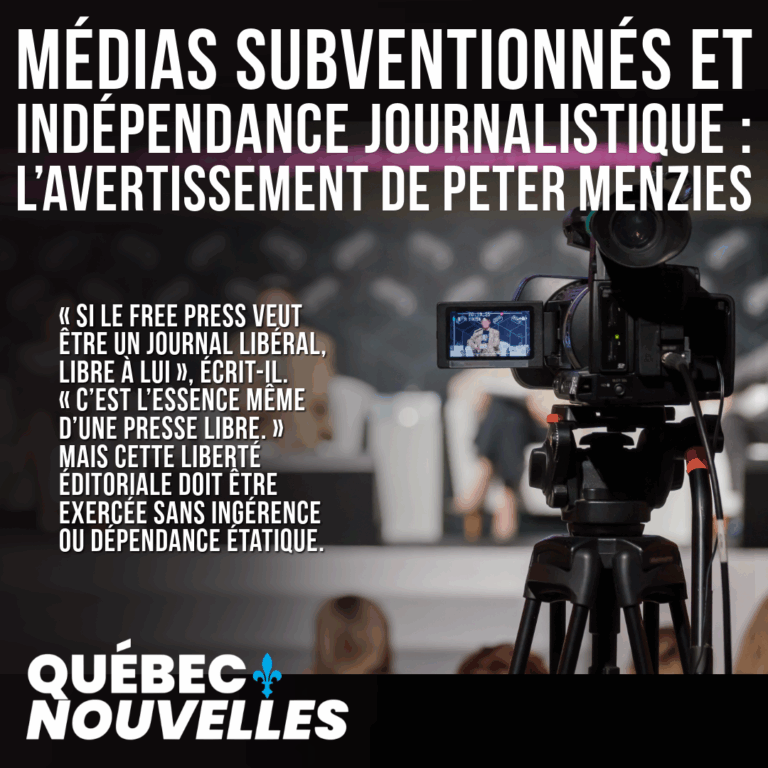Alors que les automobilistes des autres provinces canadiennes voient leur facture à la pompe diminuer depuis l’abolition de la taxe carbone fédérale, les Québécois, eux, continuent de payer leur essence plus cher que quiconque au pays. Le ras-le-bol est palpable : selon un sondage Léger-Le Journal-TVA dévoilé le 20 mai 2025, 56 % des Québécois réclament la fin de la taxe carbone provinciale, une mesure de plus en plus perçue comme injuste, inefficace et socialement déséquilibrée.
Un écart de prix frappant à la pompe
Mathieu Boulay, pour Le Journal de Montréal, rapporte que les prix de l’essence au Québec oscillent entre 1,50 $ et 1,60 $ le litre, tandis qu’ailleurs au pays, le litre d’ordinaire s’achète souvent à plus de 40 cents de moins, notamment en Alberta (1,14 $), au Manitoba (1,16 $) et en Ontario (1,12 $). Ce gouffre tarifaire est apparu clairement depuis l’abolition, le 1er avril, de la taxe carbone fédérale dans neuf provinces, une mesure phare du nouveau premier ministre canadien Mark Carney.
Au Québec, qui maintient son propre système de tarification du carbone, les automobilistes paient environ 10 cents de plus par litre en raison de cette taxe. Résultat : le taux d’inflation y atteint 2,2 %, contre 1,7 % pour la moyenne canadienne, selon les données de l’Indice des prix à la consommation (IPC). Boulay souligne que les stations de Gatineau, en bordure de l’Ontario, tentent de s’ajuster pour rester compétitives avec des prix sous les 1,40 $ — un contraste criant avec Montréal (1,52 $) ou Québec (1,50 $).
Une opposition généralisée, au-delà des lignes partisanes
Geneviève Lajoie, pour Le Journal de Québec, explique que ce rejet de la taxe carbone traverse toutes les affiliations politiques : qu’ils soient libéraux, caquistes, péquistes ou conservateurs, les électeurs ne veulent plus payer davantage que le reste du pays pour un plein d’essence. Seuls les partisans de Québec solidaire maintiennent leur appui à la mesure.
L’analyse du sondeur Sébastien Dallaire est sans équivoque : « En période d’incertitude économique et financière, les citoyens pensent d’abord à leur portefeuille. » La tarification du carbone, qui se voulait un geste fort en faveur de la planète, semble aujourd’hui vécue comme un fardeau fiscal dont les bénéfices réels sont de plus en plus remis en cause.
Même chez les personnes qui n’utilisent pas leur voiture régulièrement, 40 % se disent favorables à l’abolition de la taxe. Et si les véhicules électriques représentent désormais 7 % du parc automobile québécois, la majorité des citoyens reste dépendante de l’essence, d’autant plus que la fin annoncée des subventions à l’achat en 2027 risque de ralentir cette transition.
Une taxe « verte »… au service de l’élite?
Yasmine Abdelfadel, dans une chronique intitulée « Taxe verte, colère noire » pour Le Journal de Montréal, va plus loin en mettant en lumière le sentiment d’injustice qui entoure la gestion des revenus issus de la taxe carbone. Si le principe d’une tarification des émissions de GES était initialement bien accueilli, les révélations sur la destination de ces fonds ont alimenté la colère.
Le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), alimenté par cette taxe, finance chaque année des projets censés favoriser la transition énergétique. Or, des entreprises comme Ivanhoé Cambridge (filiale de la Caisse de dépôt) ont touché plus de 100 000 $ pour optimiser la gestion de matières organiques à la Place Ville-Marie. Le Ritz-Carlton de Montréal, un palace cinq étoiles, a quant à lui reçu 46 000 $ pour un projet similaire.
Pour Abdelfadel, ces aides perçues comme des cadeaux à l’élite économique jettent un doute sur la légitimité du sacrifice exigé aux contribuables : « Doit-on vraiment saigner le portefeuille du travailleur à 20 $ de l’heure pour financer les composteurs de l’élite ? »
Québec isolé sur la scène canadienne
Comme le rappelle Patrick Lagacé au micro du 98.5 FM, le Québec fait désormais cavalier seul : toutes les autres provinces canadiennes ont cessé d’imposer une taxe carbone directe sur l’essence depuis avril. Les citoyens de ces provinces ont non seulement vu leur prix à la pompe baisser, mais ont aussi reçu un chèque de redevance allant jusqu’à 456 $, ce dont les Québécois ne bénéficient pas.
Ce contexte alimente un sentiment d’isolement et d’iniquité, qui pourrait devenir électoralement explosif pour le gouvernement Legault. Le chef conservateur Éric Duhaime en a d’ailleurs fait un cheval de bataille, exigeant l’abolition immédiate de la taxe et la fin des « deux poids, deux mesures » au Canada.
Un virage politique inévitable?
Si le Québec est souvent cité en exemple pour ses politiques environnementales ambitieuses, le fossé entre les intentions climatiques et le sentiment d’équité des citoyens semble aujourd’hui impossible à ignorer. La taxe carbone, censée incarner la lutte contre les changements climatiques, est désormais perçue comme injuste, inefficace et mal redistribuée.
À l’approche du prochain budget provincial et dans un contexte d’essoufflement économique, le gouvernement Legault pourrait être contraint de réévaluer son engagement envers le marché du carbone, ou à tout le moins, de revoir la gouvernance du FECC et la redistribution des revenus. Faute de quoi, la fracture entre l’État et ses citoyens risque de s’élargir — et de laisser une marque profonde dans le paysage politique québécois.