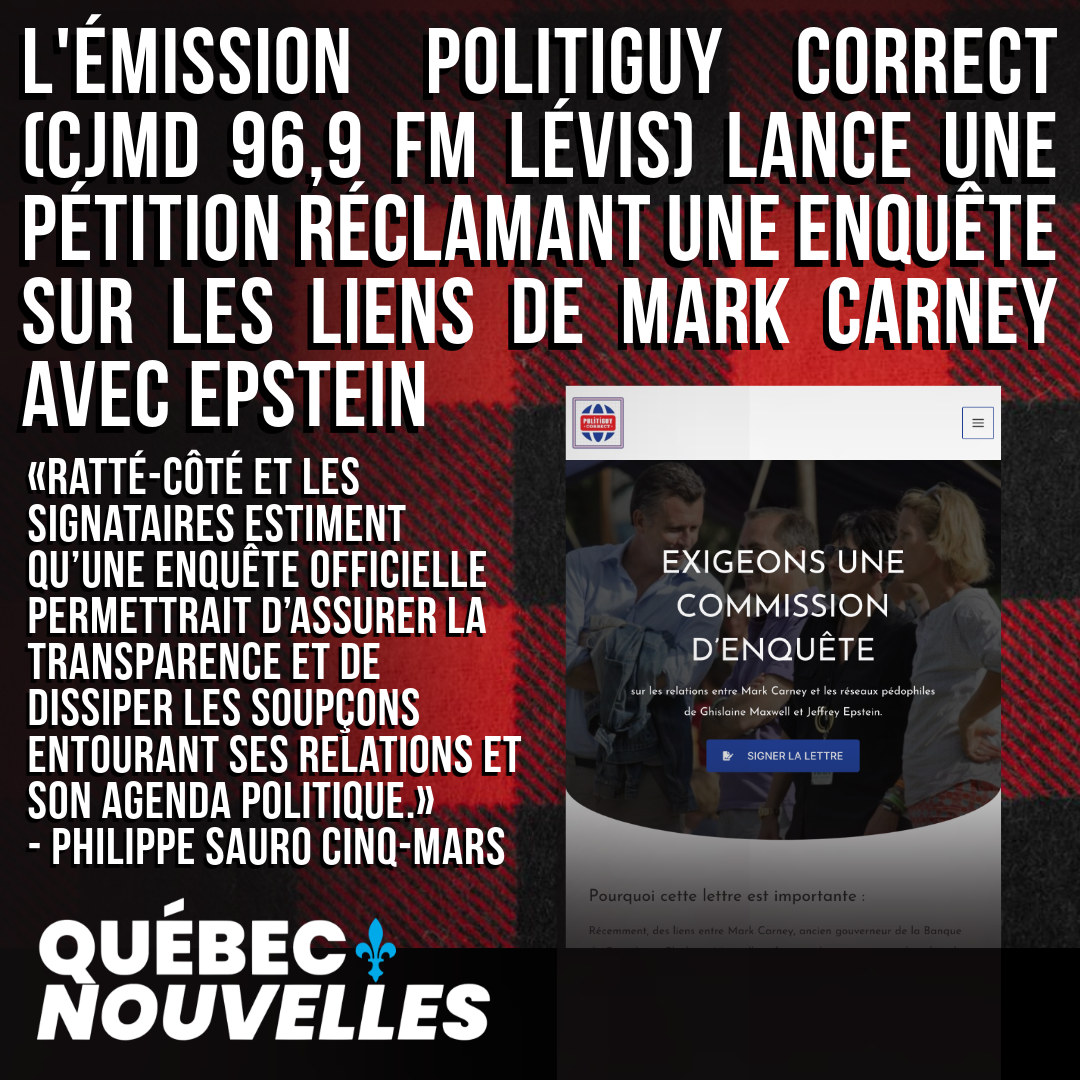De nos jours, on ne voit en la voiture qu’un pot à échappement. Tout au plus, on y voit un moyen de transport énergivore et encombrant. Dans une forme de radicalisme environnemental, on devient complètement aveugles aux particularités qui ont fait son succès pendant un siècle et qui ont stimulé le plus grand bond technologique de tous les temps. On tente désormais de se faire croire que le transport en commun et le « transport actif » peut la remplacer intégralement, qu’il s’agit là de moyens de transports tout à fait équivalents. Ce n’est pas le cas, et ça ne sera jamais le cas.
Qu’on le veuille ou non, et malgré toutes les modernisations qu’on pourra y apporter, les transports en commun demeurent une technologie du XIXe siècle. Avec l’apparition des trains et des tramways, pour la première fois, le peuple peut se déplacer de manière plus efficace, et même voyager, chose qui n’existait pratiquement pas avant cette époque. En effet, pour la majeure partie de l’histoire humaine, les gens naissaient dans une ville ou un village et y mourraient sans jamais l’avoir quitté. Mais cette mécanisation des transports et la capacité de transporter de grandes masses de personnes et de marchandises stimulera la productivité industrielle et permettra l’essor du tourisme de masse.
Selon Alain Corbin dans « L’avènement des loisirs, 1850-1960 », « Avant l’apparition du chemin de fer, le voyage était cher, lent, pénible et même dangereux. Les voyages de masse étaient impossibles sur route. Ainsi, hors de toute considération temporelle, les divertissements supposant un long déplacement avaient été le domaine réservé des riches. En revanche, un seul train pouvait transporter des milliers de personnes ; le chemin de fer rendit le voyage accessible à la multitude. Son influence sur les lieux de villégiature fut énorme ».
Bref, il s’agissait bel et bien, à l’époque, d’une technologie révolutionnaire qui a stimulé la première révolution industrielle et le désenclavement des régions isolées. Ce fut aussi un énorme avantage logistique d’un point de vue militaire, qui deviendra essentiel pendant la guerre de sécession et donnera un avantage significatif aux Allemands pendant la guerre franco-allemande de 1871.
Mais la voiture individuelle, qui apparaît le siècle suivant, sera tout aussi révolutionnaire. Alors que les transports les plus efficaces étaient jusque-là coincés sur leurs rails et ne pouvaient se déplacer que de stations en stations, la voiture permettait pour la première fois de se rendre à peu près partout, n’importe quand et en toute liberté.
Bien que les transports en commun aient continué à jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société en raison du coût prohibitif des voitures, il n’y avait aucune ambiguïté que la voiture individuelle était nettement supérieure en termes de mobilité. Encore une fois, la logistique militaire le démontre bien : les Allemands envahiront la France en seulement un mois dans la tristement célèbre « blitzkrieg » précisément en raison de cette capacité à se déplacer partout rapidement et à s’approvisionner dans des stations à essence. Aussi triste que ça puisse paraître, les nécessités guerrières sont bien souvent le meilleur test d’efficacité des nouvelles technologies… Ça ne trompe pas.
Si l’usage de l’automobile avait déjà connu un boom dans les années folles, c’est néanmoins à partir des années 50 que son usage se démocratise dans l’ensemble des sociétés occidentales. Le complexe industriel qui avait été mobilisé pour l’effort de guerre peut effectivement commencer à se concentrer sur une production de masse. Produits domestiques, maisons, vêtements, automobiles ; c’est l’avènement du fameux mode de vie des banlieues à l’américaine.
Ce nouveau mode de vie entraîne alors une révision complète de l’urbanisme des villes ; les routes sont de plus en plus adaptées pour les voitures, on désinstalle les lignes de chemins de fer devenues inutiles, on éventre les centres historiques et les places centrales – au point où certains Anglais en viennent à affirmer que les urbanistes et architectes font « ce que la Luftwaffe n’était pas parvenue à faire »… – mais surtout, les autoroutes se généralisent sur les territoires.
L’Occident devient définitivement une « civilisation de l’automobile ».
Et toutes ces choses qui nous apparaissent aujourd’hui une hérésie, et qui se perpétuent encore pendant quelques décennies, comme ici, au Québec, avec l’éventrement de la ville par l’autoroute Dufferin, la destruction des quartiers centraux autour du boulevard Saint-Cyrille (aujourd’hui René-Lévesque) pendant les années 70, ou bien dans l’Angleterre de Margaret Tatcher, dans les années 80, qui voit le réseau ferroviaire anglais, pourtant l’un des plus efficaces au monde, fondre à vue d’œil à coup de privatisation, elles n’étaient alors vues que comme une nécessité d’un monde en changement. Toutes ces destructions n’étaient pas un recul, elles visaient à répondre à cet engouement libertaire qu’apportait l’automobile. Elles étaient un signe d’espoir d’un monde nouveau où l’individu ne serait pas lié aux horaires contraignants des gares, mais bien libre d’aller où il veut et quand il veut.
L’impact sociologique et le grand optimisme qu’a occasionné la généralisation de l’usage de l’automobile est visible partout dans la culture des Trentes Glorieuses. C’est l’époque où Jack Kerouac écrit On the Road, où toute une génération devient fascinée par les manœuvres audacieuses de Dean Moriarty au volant de sa voiture sur les autoroutes américaines. C’est l’ère des « road trips », de la route 66, où on rêve de partir, comme dans la chanson « California Dreaming », pour expérimenter la liberté totale. C’est la « fureur de vivre » de James Dean, qui meurt « forever young »‘ au volant de sa Porsche 550 Spyder dans une courbe dangereuse. C’est l’ère des « Easy Riders », qui choisissent plutôt la moto, mais expérimentent la même liberté aventureuse. Ici, au Québec, ce sont les cheveux dans le vent de Plamondon au volant de sa Camaro « sur tous les chemins d’été ».
Plus qu’un simple moyen de transport, l’automobile devient l’incarnation physique de la liberté à l’occidentale, et plus particulièrement de la liberté nord-américaine.
Là où les transports s’étaient limités à un rôle utilitaire, à un passage obligé pour se rendre du point A au point B, avec l’automobile, le trajet en lui-même devient l’objectif. La conduite en elle-même est un plaisir et chaque point sur le trajet entre A et B devient la possibilité d’une nouvelle aventure.
Mais au-delà de l’idéalisation du « road trip », la voiture apporte aussi une mobilité nettement accentuée. Si le besoin se fait sentir, un individu peut se rendre en quelques minutes à l’autre bout d’une ville, ou en quelques heures dans une autre ville, dans un village, dans un chalet isolé, carrément au milieu de nulle part ou bien dans un autre pays. En termes de productivité, aussi, il dispose désormais d’un moyen beaucoup plus efficace. Il peut faire des livraisons à tout moment, d’adresse en adresse, de quartier en quartier, de ville en ville. Il peut répondre et se rendre plus directement à des endroits en cas d’urgence.
Il y a une raison pourquoi ambulanciers, policiers et pompiers ne circulent pas en tramway ou en train…
Peu à peu, cependant, l’urbanisation a rendu l’automobile de moins en moins mobile, prise dans le traffic des heures de pointes et dans le rythme aliénant du travail salarié. De symbole de liberté, elle est peu à peu devenue le symbole d’une aliénation capitaliste, symbole d’un asservissement à son emploi et à la routine. Les fameuses « routes d’été » on fait place à la déprime des autoroutes bétonnées et à la réalité grise d’une vie urbaine encombrée.
Et avec la réalisation de la pollution associée à ce moyen de transport – et ce que beaucoup en sont venus à appeller une « crise climatique » justifiant toutes les extrémités – les sociétés occidentales sont en passe de complètement répudier l’automobile et la liberté qu’elle leur a fait bénéficier. L’automobile est désormais l’ennemi à abattre. Le symbole de l’arrogance civilisationnelle, de la folie humaine et du gaspille.
Dans ce complet renversement symbolique, dans une sorte de nostalgie naïve, les transports en communs du XIXe siècle apparaissent maintenant comme la solution de prédilection. On regrette – souvent à raison – les destructions des décennies précédentes. On idéalise le modèle européen, qui n’a pas complètement abandonné le train et les centre urbains piétons, parfois même sans réaliser que l’Amérique du Nord couvre un territoire beaucoup plus vaste, beaucoup moins développé, et donc beaucoup moins adapté à ce modèle.
Dans cette guerre contre la voiture, on en est venu à essayer de se convaincre que notre civilisation pourrait fonctionner de la même manière en se passant de la voiture. On en est rendu à aspirer à des « villes de 15 minutes », comme l’étaient les villages d’antan d’où les paysans ne sortaient jamais… Tout comme on a détruit de nombreuses lignes de chemin de fer ou de tramway pendant le XXe siècle, on tente désormais par tous les moyens de bloquer des rues, voir des quartiers complets à la circulation automobile. On désinstalle des autoroutes au profit de boulevards urbains, on interdit le stationnement dans les grands centres, etc.
On tente aussi de couvrir de honte certaines voitures « inutiles », comme les pick up, les VUS ou les voitures sport. On cherche à tout prix à drainer tout ce qui peut rester de plaisir dans la conduite automobile : le transport doit redevenir strictement utilitaire. Ce qui importe, c’est de se rendre du point A au point B ; pas la liberté de s’y rendre de la manière qu’on veut.
On idéalise les villes à bicyclette et le modèle néérlandais, en oubliant bien souvent comment le modèle de Pékin dans les années 1990 nous était répulsif. En oubliant aussi qu’avec la généralisation des vélos, le trafic vient toujours nous rattraper. Au lieu d’être dans le trafic en voiture, on peut désormais l’être sur les pistes cyclables. Et si les transports en communs ne sont pas nécessairement dans le trafic, il faut tout de même partager quelques mètres carrés dans la sueur d’un « trafic » immobilisé autour de soi.
Tout n’est pas noir ou blanc, évidemment, et il y a de grands avantages à revoir notre urbanisme et le rendre « plus humain ». Personne ne pourrait sérieusement critiquer l’art de vivre à l’européenne, la beauté de ses rues piétonnes, l’efficacité de ses métros ou de ses trains, dont les gares ont souvent pignon sur rue en plein centre-ville et offrent des trajets rapides vers les autres métropoles du continent. Cela dit, la chute symbolique de la voiture cache quelque chose de beaucoup plus sombre qu’une simple révision urbanistique.
C’est que, comme nous l’avons vu, l’automobile représentait le paroxysme de la liberté à l’occidentale, et en voulant y mettre un terme, c’est aussi une certaine vision de la liberté que nous abandonnons. Et en cherchant à nous faire croire que les transports en commun ou transports actifs sont tout à fait équivalents, on est en train de distordre la réalité symbolique de ce qu’est la liberté.
Il est courant de se moquer des gens de droite – du style républicain américain – qui voient du communisme et du socialisme partout. Or, dans ce cas précis, il faudra reconnaitre que le transport en commun constitue une collectivisation des moyens de transports (qui sont un moyen de production), ce qui, par définition, est du communisme. (Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que « commun » soit dans le nom…). L’automobile est aux transports en commun ce que la liberté individuelle est au communisme.
Tout comme les coopératives au sein d’un système capitaliste, il n’y a aucun problème à faire cette mise en commun librement, de l’initiative même des citoyens, mais lorsque ça devient obligatoire ou forcé par le gouvernement, on embarque dans une dynamique proprement illibérale. Alors quand on voit toutes ces mesures mise en place pour dissuader les gens d’avoir une voiture, ou des ministres et journalistes qui commencent à réfléchir à l’idée de supprimer la moitié du parc automobile – dans l’espoir implicite que les gens s’entassent dans les autobus, les métros, les tramways ou les trains, ou bien qu’ils marchent ou fassent du transport actif – on embarque dans une dynamique de décroissance où, de manière plutôt naïve, on veut rétablir la dépendance individuelle en termes de mobilité qui prévalait au XIXe siècle.
En d’autres mots, cette guerre à l’automobile est un symptôme du déclin de la liberté individuelle dans nos sociétés. Pour de soi-disant considérations morales, nous crachons sur la beauté symbolique de ce moyen de transport révolutionnaire, qui signifiait autrefois l’aventure, la modernité, la liberté et la légèreté. Désormais, tout doit être sérieux et sobre, tout doit être soumis aux impératifs capricieux d’un agenda radical qui entend les trompettes de l’apocalypse à chaque coup de klaxon. Et on se berce d’une illusion à peine croyable, qui pousse à se faire croire que des moyens de transports limités par des horaires, des itinéraires et des tickets tarifés sont équivalents à une machine qui peut théoriquement traverser le Sahara en entier. La désillusion est telle qu’on en vient à répudier notre modèle libertaire et envier les modèles soviétisants caractérisés par le sous-développement et l’autoritarisme.
L’Occident ne rêve plus et ne veut même plus rêver ; il subit et se morfond dans une pulsion de mort en tâchant de se faire croire qu’il est toujours libre. Mais quelque part sur terre, il y a toujours quelqu’un en road trip, les cheveux dans le vent sur des routes d’été, qui se moque des aléas de la fortune et, pour un court moment, profite de la liberté.