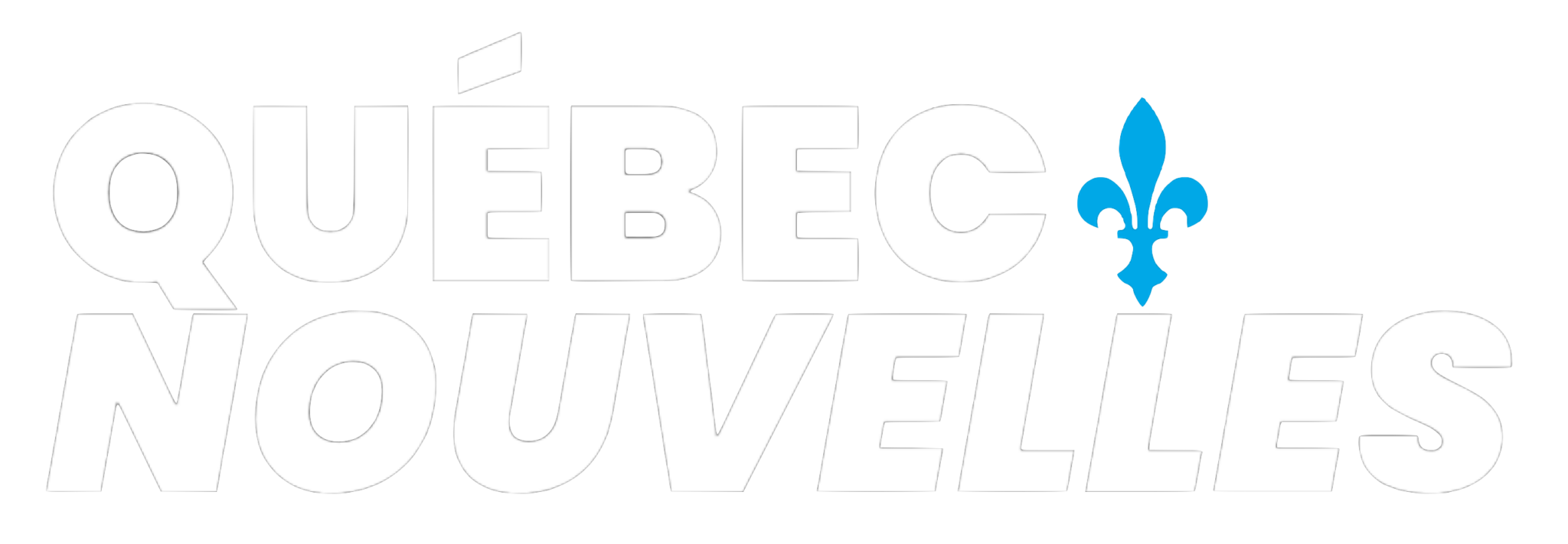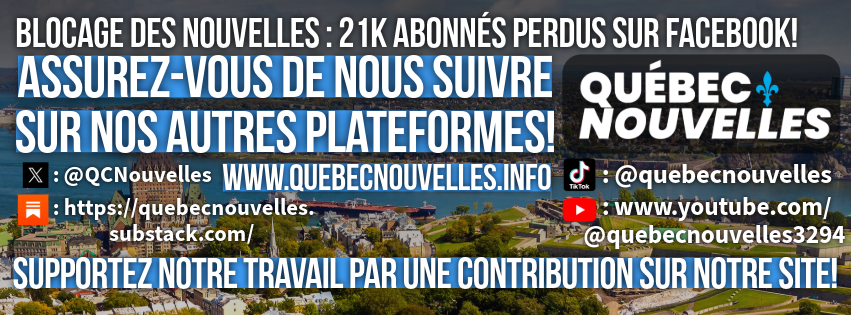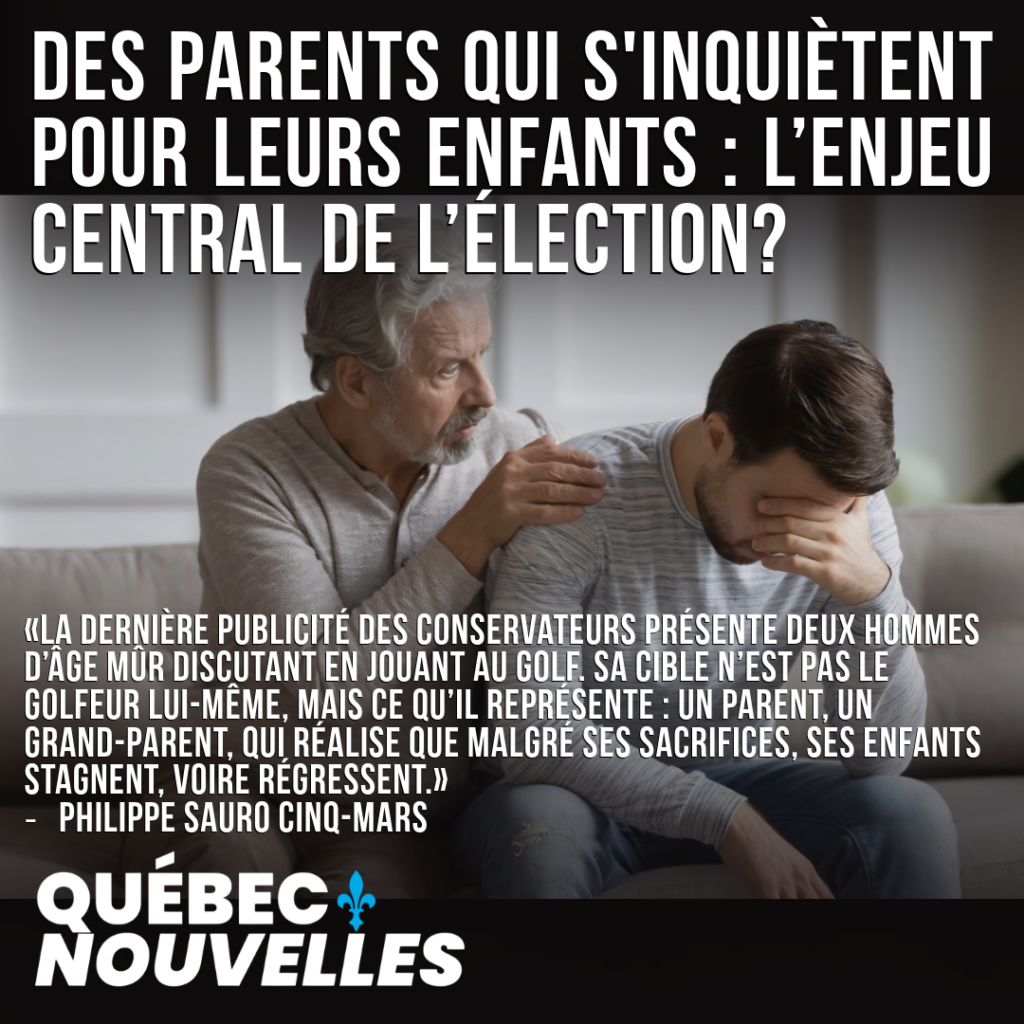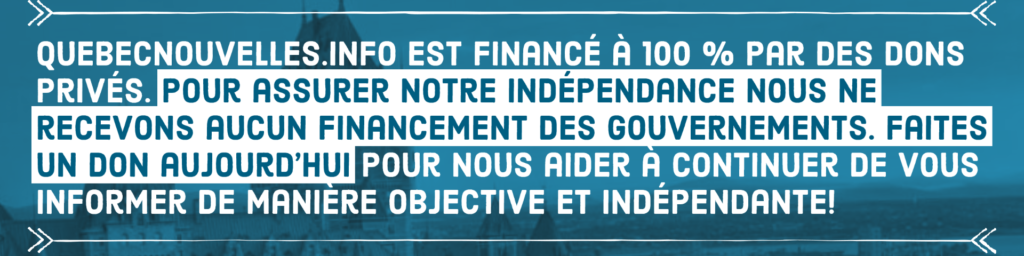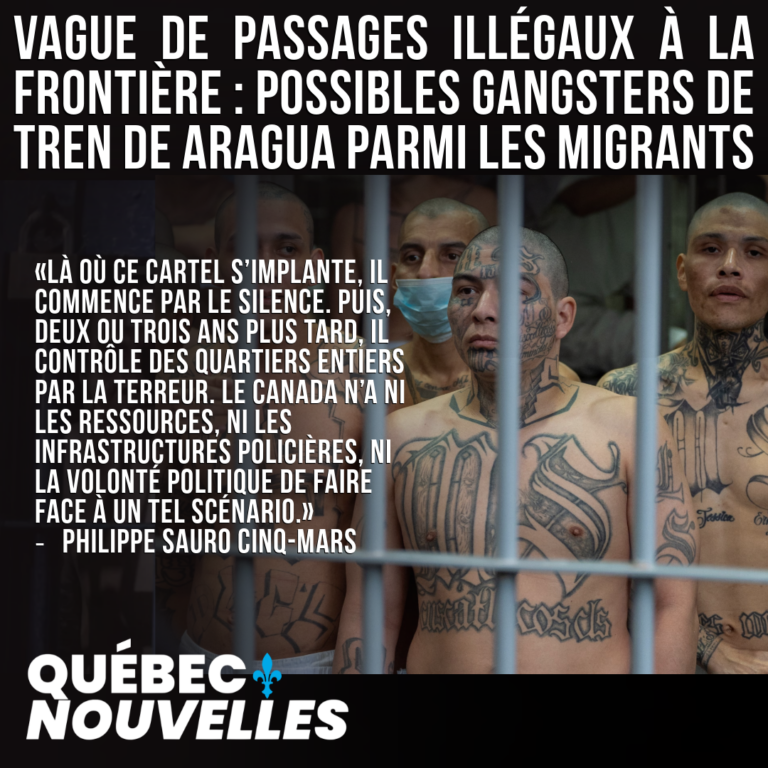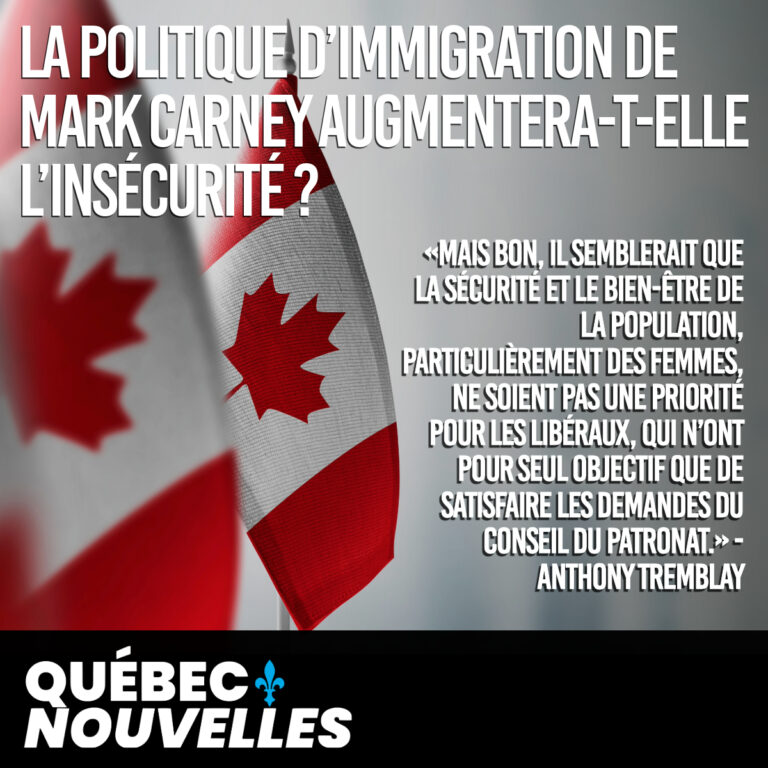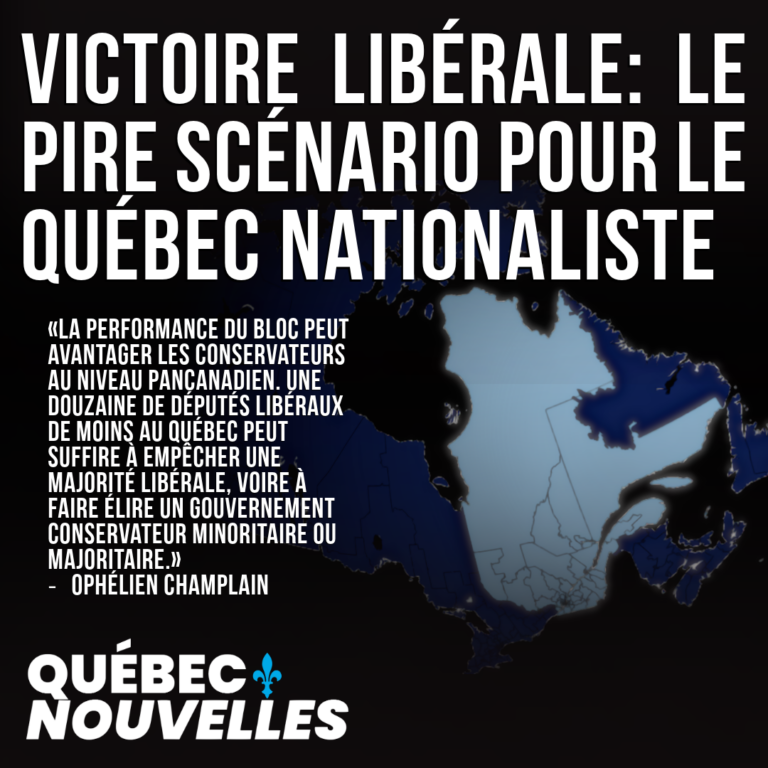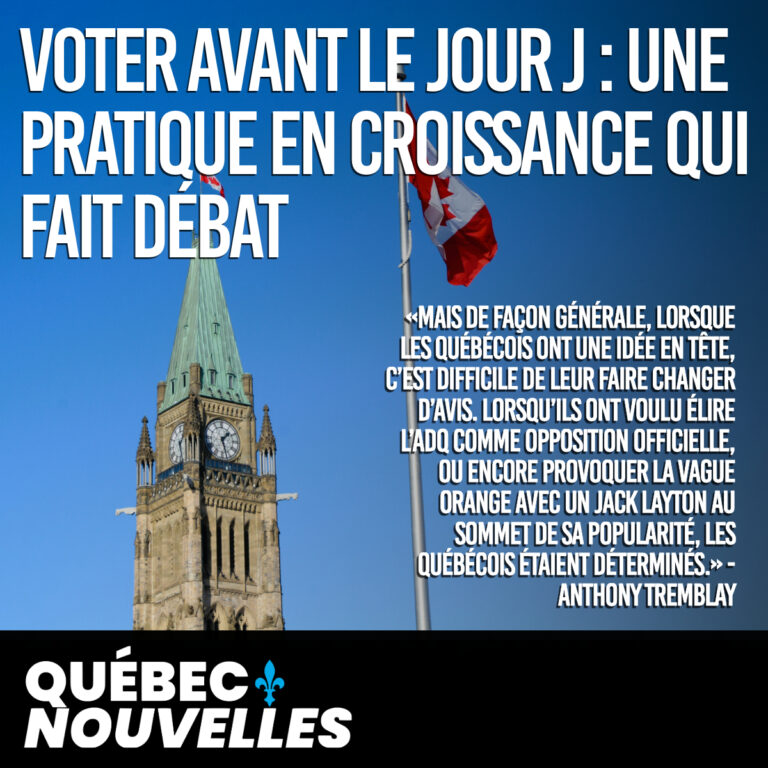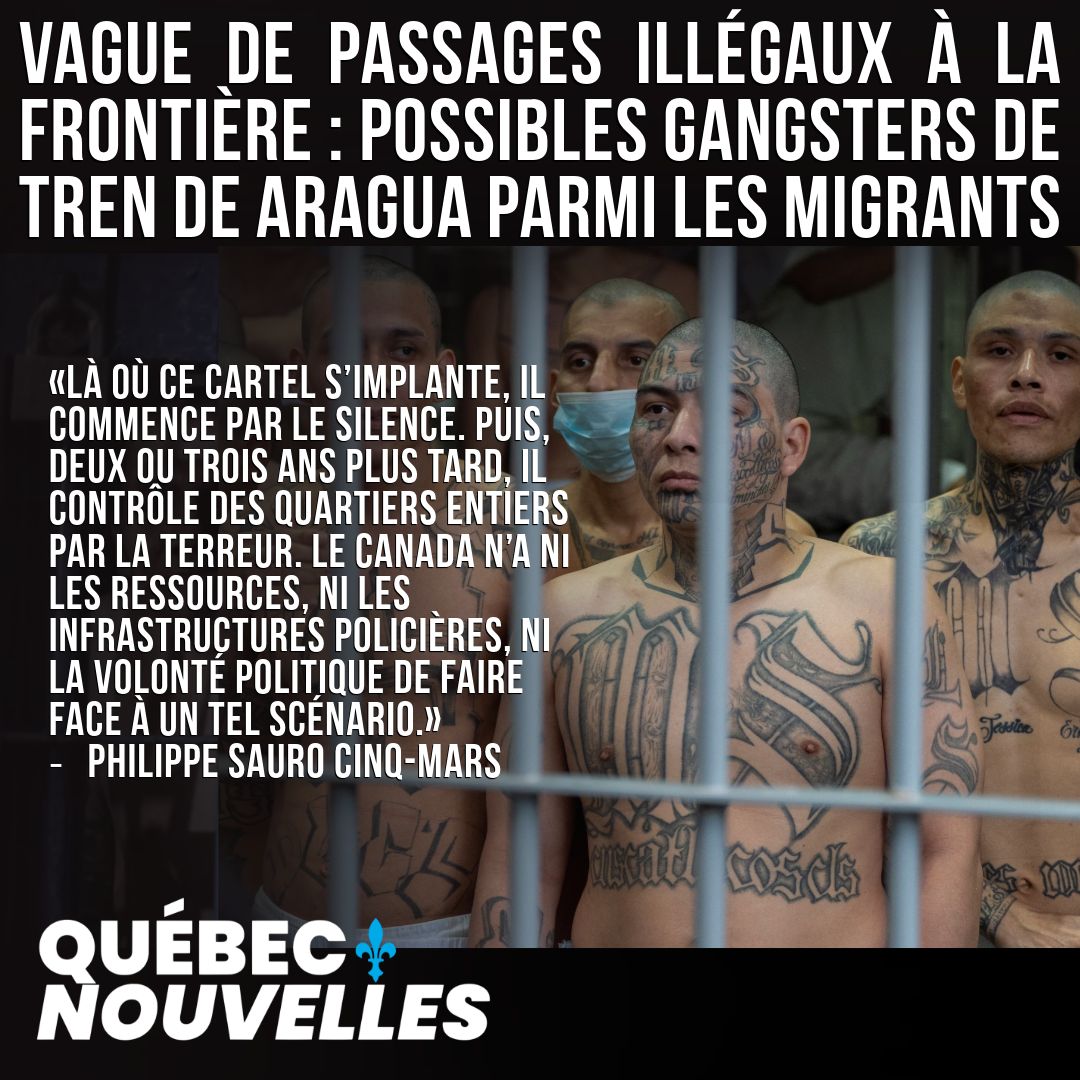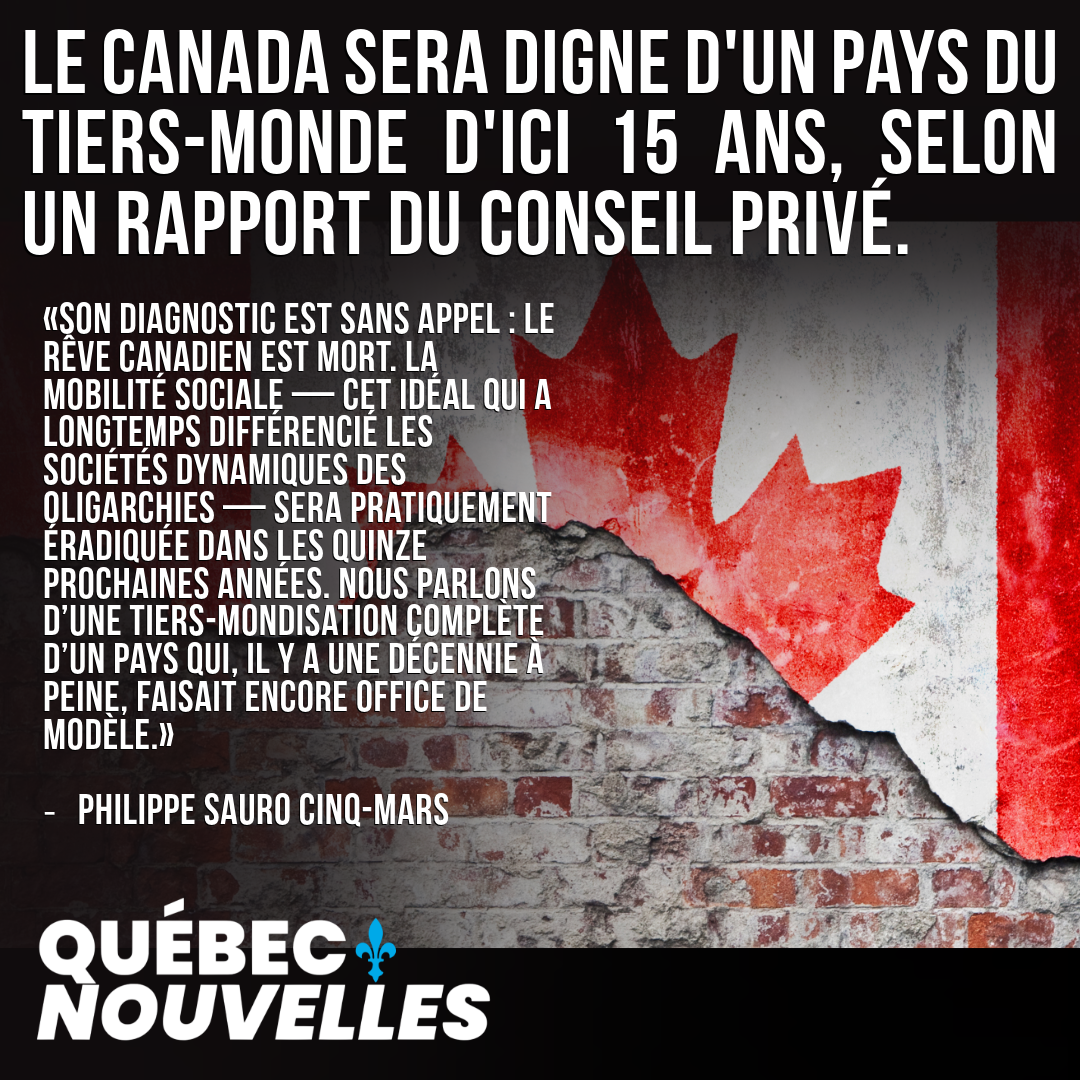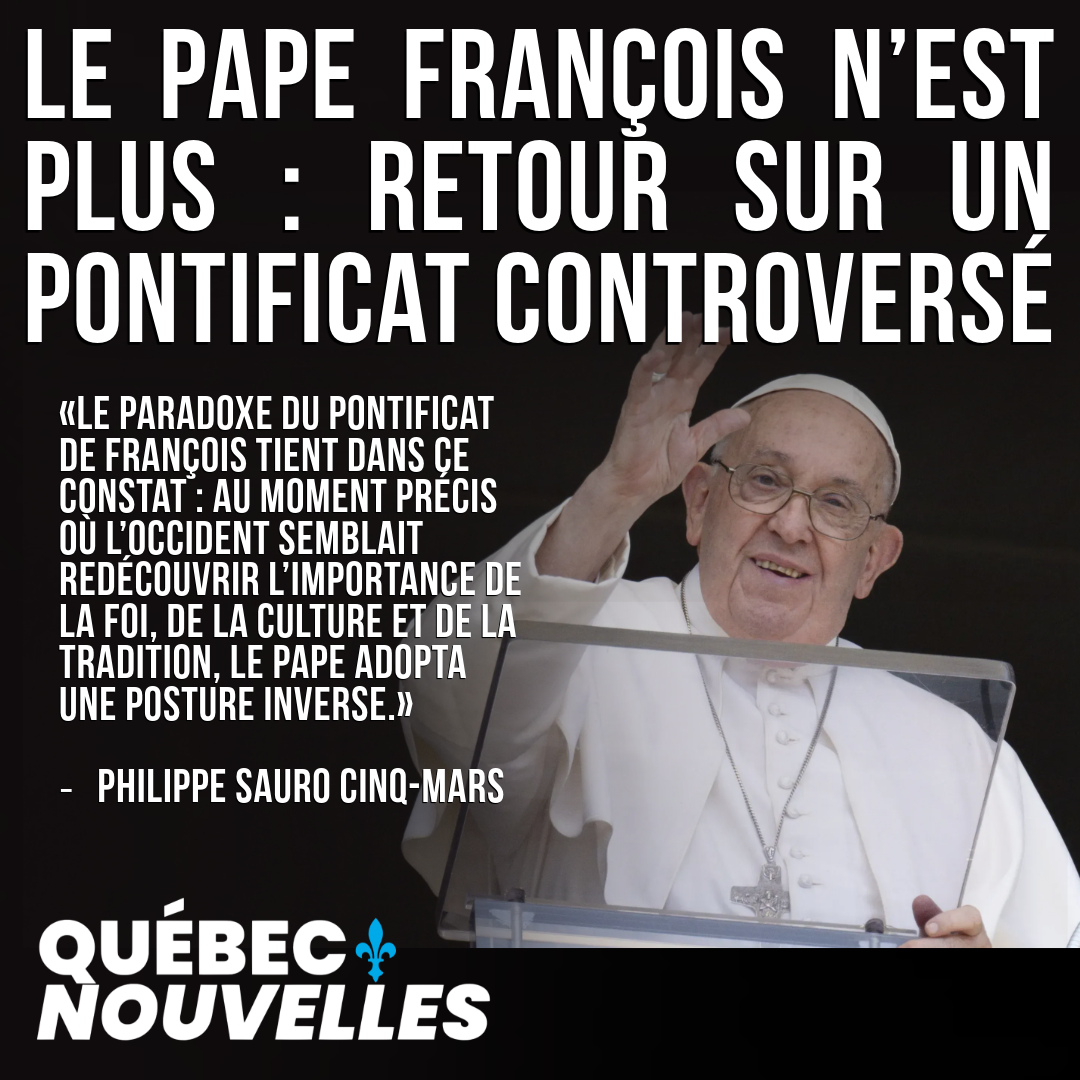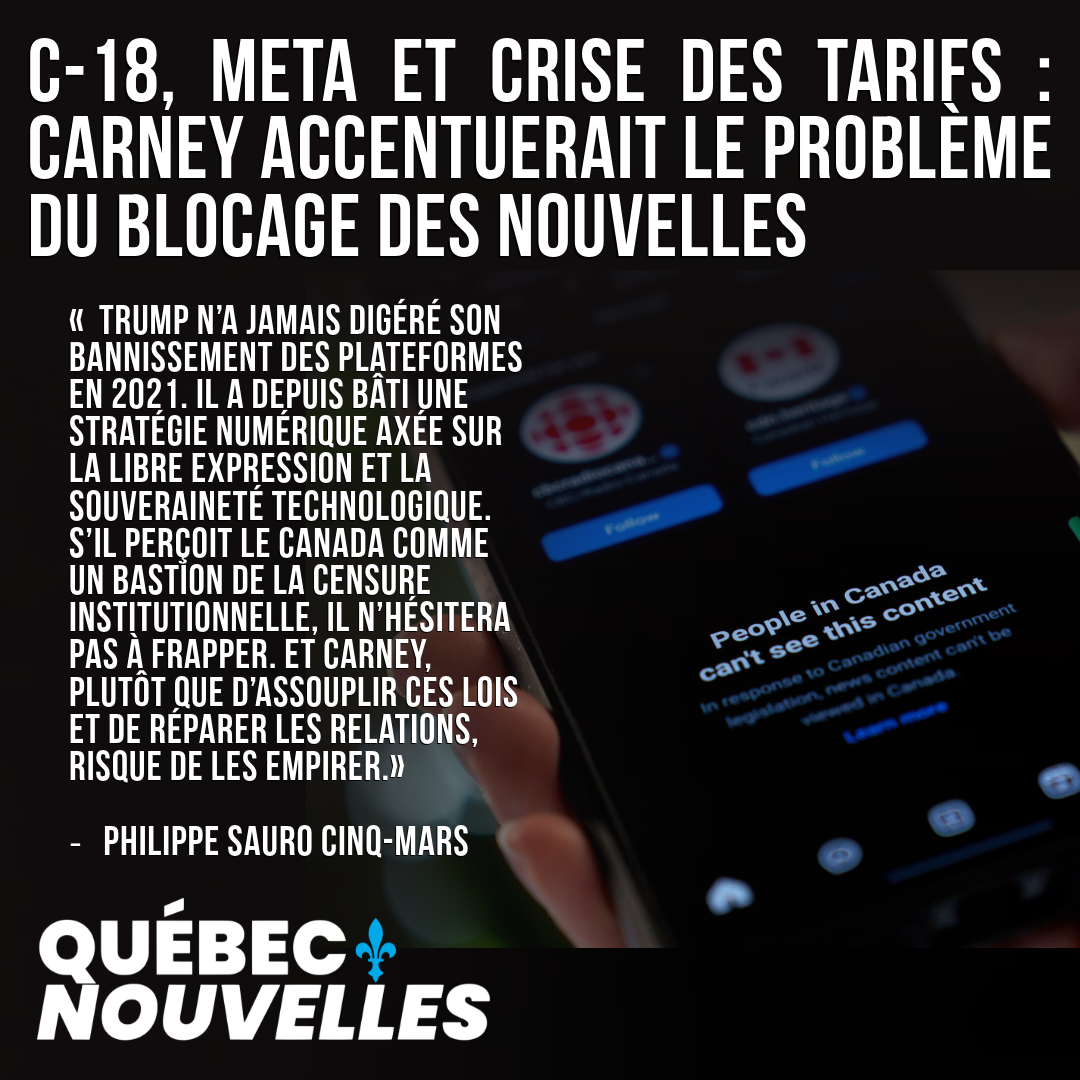La dernière publicité des conservateurs, diffusée à moins d’une semaine du scrutin, semble calibrée pour résonner auprès d’un électorat trop souvent oublié dans les analyses superficielles : les boomers inquiets pour l’avenir de leurs enfants. Deux hommes d’âge mûr discutent en jouant au golf – un cadre que certains sur les réseaux sociaux ont vite tourné en dérision, le jugeant déconnecté, théâtral, voire gênant. Mais c’est précisément là que réside la subtilité du message.
Car la cible de cette publicité n’est pas le golfeur lui-même, mais ce qu’il représente : un parent, un grand-parent, qui réalise que malgré ses sacrifices, ses enfants stagnent, voire régressent. Le fils de David, nous dit-on, « a eu des années difficiles » ; la fille de l’autre ami a dû être soutenue financièrement pour devenir propriétaire. Le tableau est clair : même les enfants de familles aisées ont désormais besoin de l’aide de leurs parents pour atteindre ce qui, il n’y a pas si longtemps, semblait un minimum — un toit, une stabilité, un avenir.
En apparence anodine, cette scène illustre un changement de paradigme : pour la première fois depuis des générations, l’ascension sociale ne va plus de soi. Et ce que dit la publicité, sans jamais le verbaliser trop directement, c’est ceci : le vote de 2025 n’est pas un vote pour vous, c’est un vote pour vos enfants. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux.
Stratégie, suranalyse ou réveil tardif?
Certains commentateurs ont vu dans cette publicité un signe de faiblesse, une manœuvre de dernière minute — un effort désespéré pour redresser la barre. Des intervenants sur un plateau de la CBC ont avancé qu’elle avait été produite « en urgence », comme si elle révélait un affolement conservateur. D’autres soulignent l’absence de Poilievre, figure plus polarisante, particulièrement chez les électeurs plus âgés, au profit d’un message axé uniquement sur les enjeux.
Mais si l’on regarde de plus près, cette approche s’inscrit dans une stratégie bien précise : recentrer la campagne sur les conséquences tangibles d’un quatrième mandat libéral. Non pas en attaquant frontalement Carney, dont l’image reste rassurante pour certains électeurs, mais en contournant l’arène du duel de personnalités pour ramener la conversation à ce qui compte vraiment.
La guerre des tarifs avec Trump, aussi spectaculaire soit-elle, a eu pour effet pervers d’occulter les débats essentiels sur la situation interne du pays. Les médias, emportés dans la panique, ont relayé une vision à court terme. Or, les problèmes que vivent les Canadiens n’ont pas commencé avec Trump, et ne se résoudront pas en se choisissant un négociateur en chef. Il s’agit ici d’un choix de société. Un choix générationnel.
Une imploration silencieuse
Derrière les sourires de façade de cette publicité, il y a une urgence sourde. Celle d’une jeunesse qui ne sait plus comment construire une vie adulte dans un pays qui semble avoir renoncé à elle. Les données les plus récentes du Conseil privé fédéral sont glaçantes : d’ici 2040, le Canada pourrait connaître une forme de « tiers-mondialisation douce », marquée par l’effondrement de la mobilité sociale.
Le rapport évoque un futur où les jeunes Canadiens n’accéderont plus à la propriété, où l’agriculture de survie en milieu urbain deviendra la norme, où l’immobilisme social s’imposera, et où la richesse se reconcentrera dans les mains de ceux qui ont hérité, pas de ceux qui méritent. Un monde d’injustice programmée, d’aristocratie latente, de génération sacrifiée.
Dans ce contexte, les boomers — qui ont connu une société en plein essor, où l’effort était récompensé — sont interpellés non pas en tant qu’électeurs privilégiés, mais en tant que garants du lien intergénérationnel. Le Canada ne peut pas devenir un pays où l’on lègue le désespoir en héritage.
Une élection plus serrée qu’on ne le prétend?
Depuis le déclenchement de cette campagne, la plupart des médias — particulièrement ceux qui bénéficient directement de la manne libérale, comme CBC — présentent l’élection comme jouée d’avance. Carney, bien servi par une conjoncture internationale anxiogène, serait l’homme de la situation. Mais les faits contredisent cette narration.
Les sondages, on le sait, ont souvent sous-estimé certains électorats — jeunes, ruraux, dissidents — et la dynamique sur le terrain ne reflète pas cette prétendue avance confortable. Les conservateurs, en misant sur des enjeux concrets plutôt que sur une rhétorique de peur, creusent lentement mais sûrement leur sillon. Partout où le vote n’est pas figé, ils progressent.
Les débats télévisés, loin d’avoir consolidé l’avance de Carney, ont montré une relative fragilité, notamment face à un Yves-François Blanchet bien préparé au Québec, et à un Poilievre de plus en plus à l’aise dans le rôle de l’alternative.
Et si cette publicité ciblant les boomers, loin d’être une panique de dernière heure, marquait plutôt le début d’un repositionnement stratégique profond? Un appel aux électeurs modérés, raisonnables, soucieux de ce qu’ils laisseront derrière eux?
Chaque semaine compte
C’est pourquoi, à l’instar de plusieurs voix émergentes, je remets en question la généralisation du vote par anticipation. Une campagne électorale est une dynamique vivante. Elle évolue. Elle révèle. Elle clarifie. Priver les électeurs du bénéfice de ces dernières semaines, c’est saboter le processus démocratique.
Nous avons encore des choix à faire. Des choix lourds de conséquences, qui façonneront le Canada des prochaines décennies. Cette fois, ce ne sont pas nos impôts qui sont en jeu. C’est l’avenir de nos enfants.