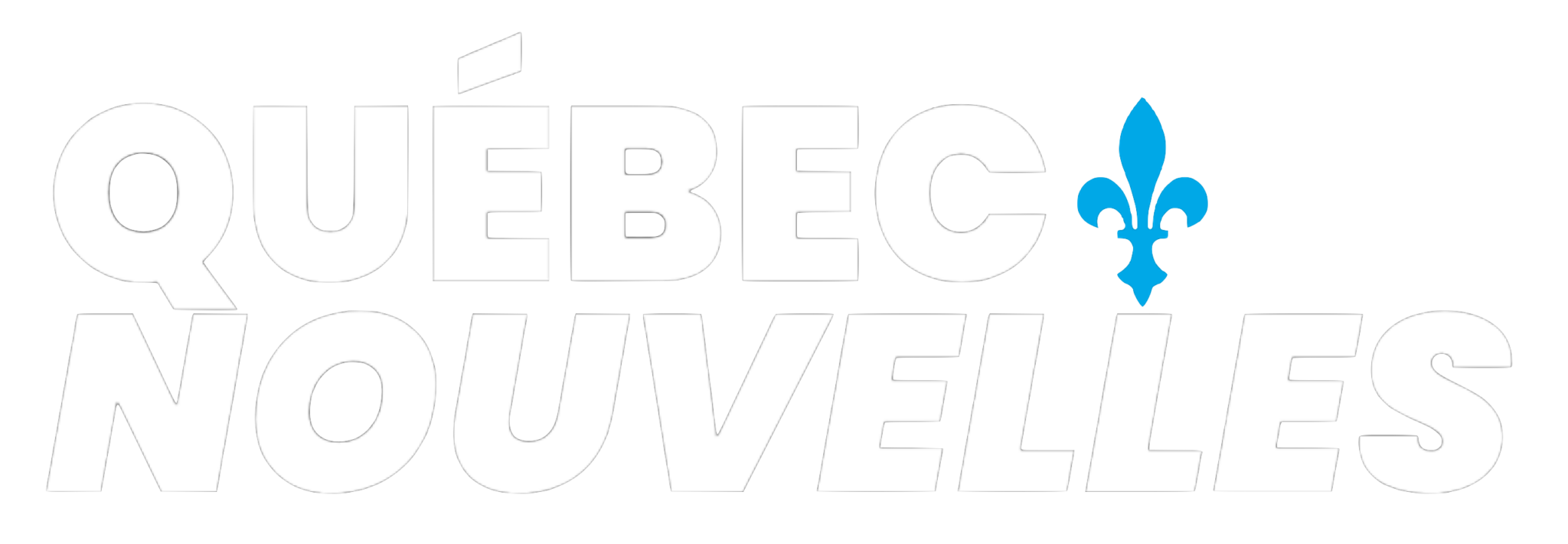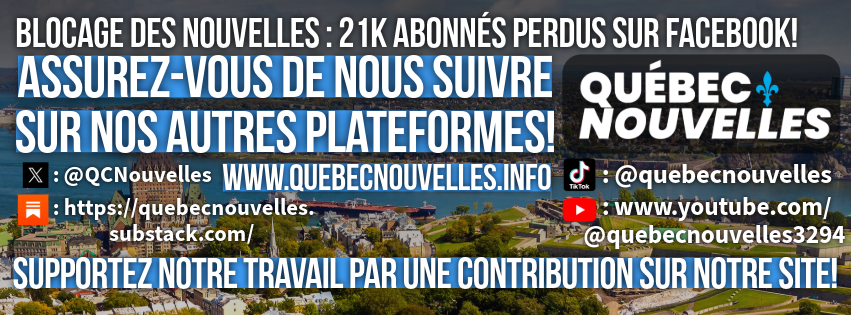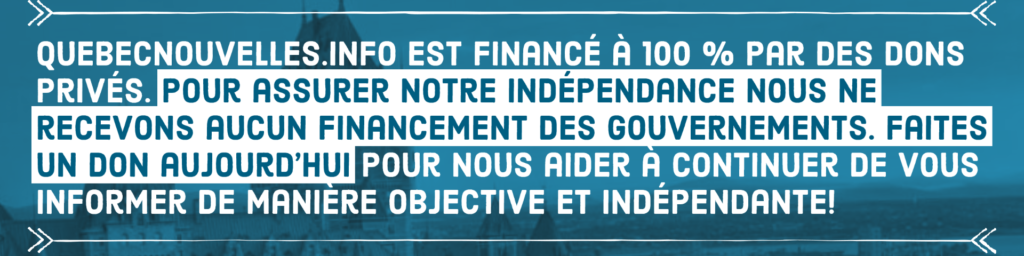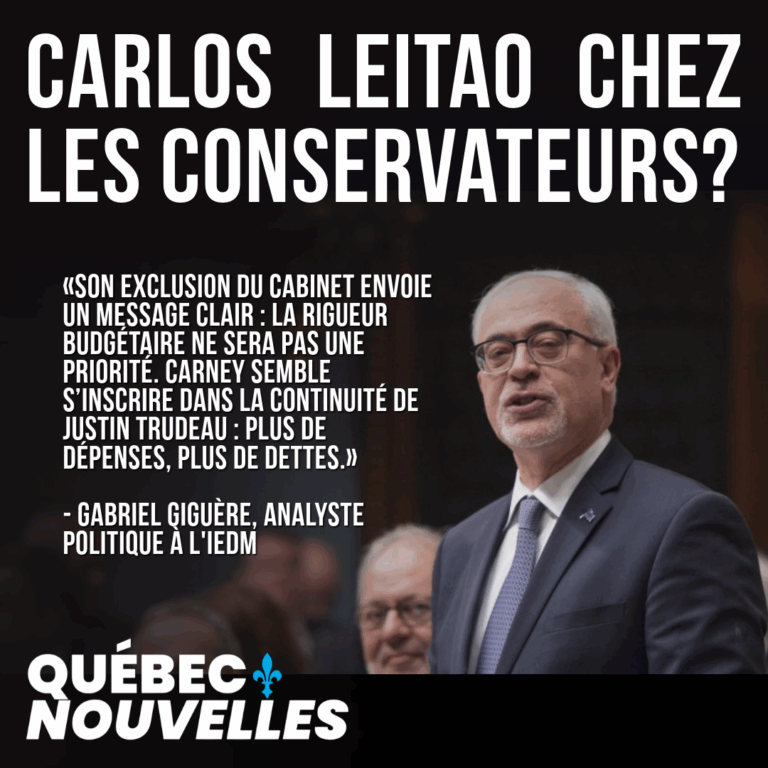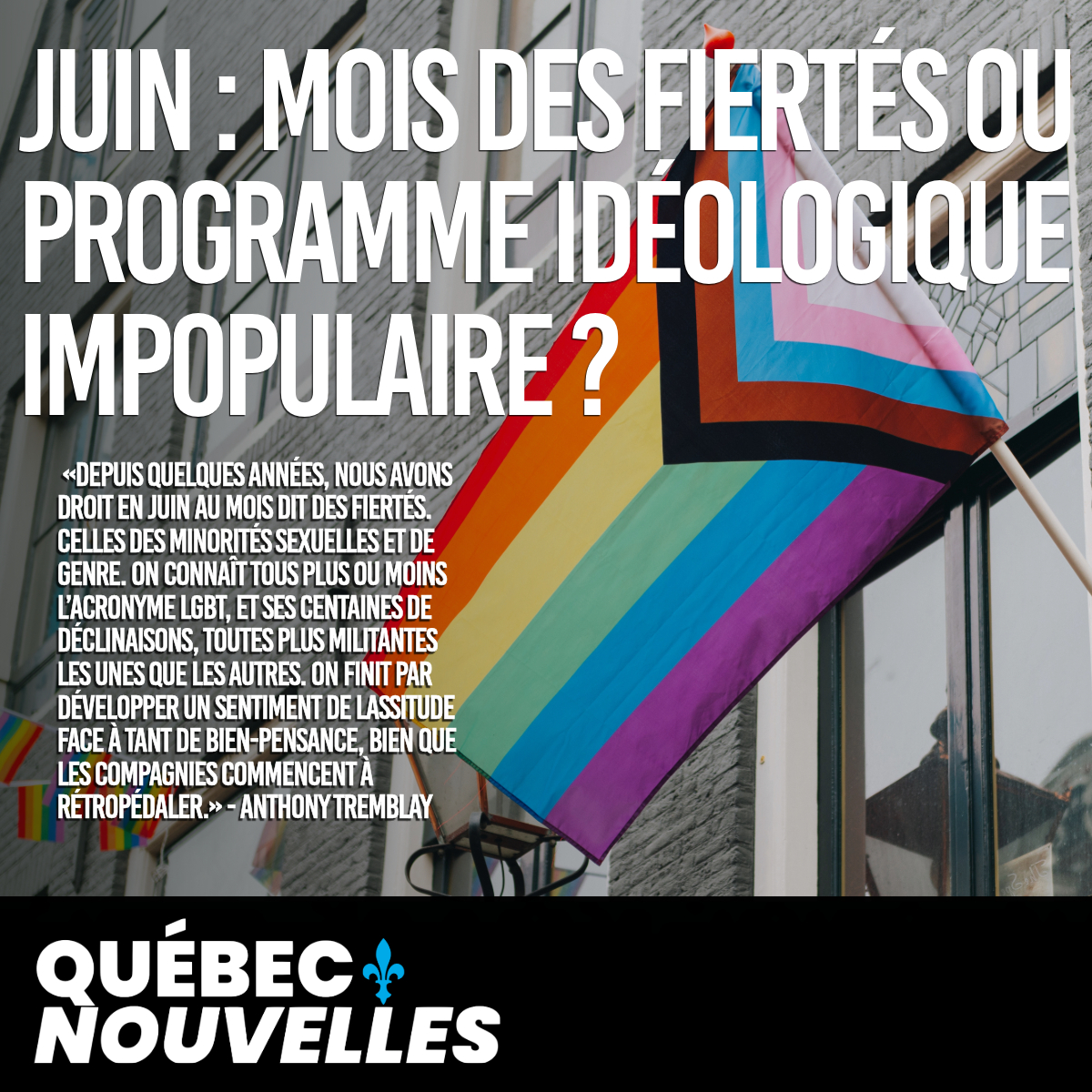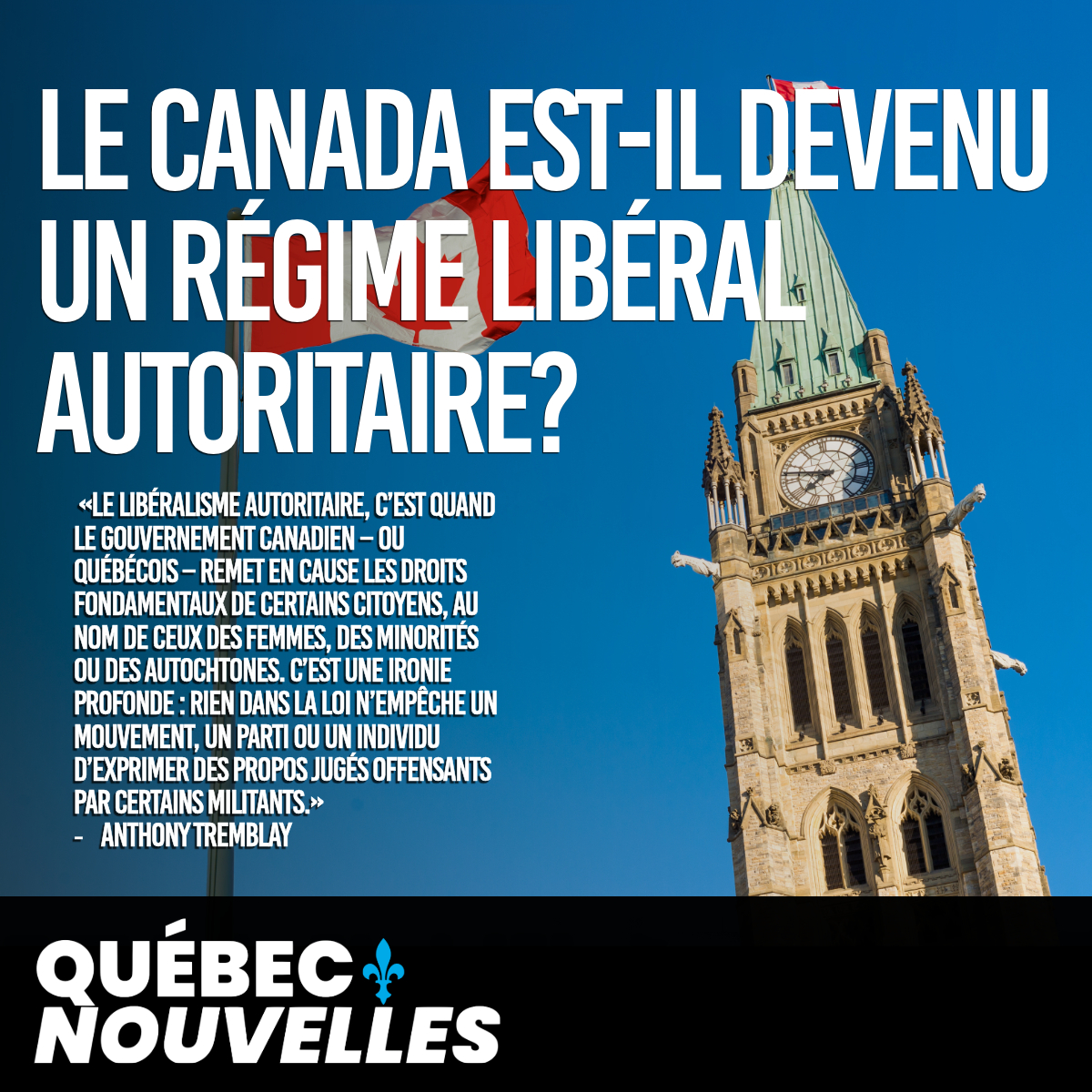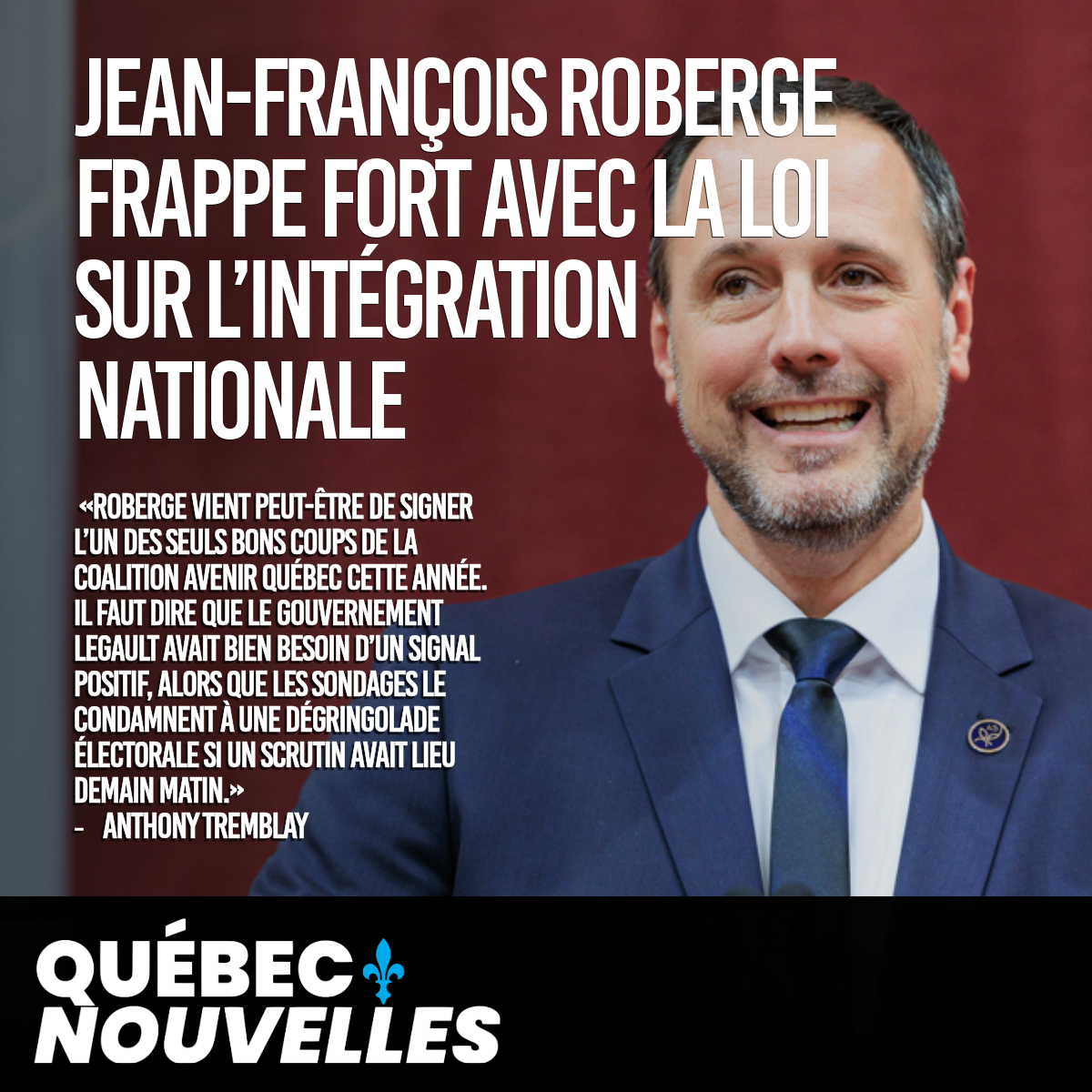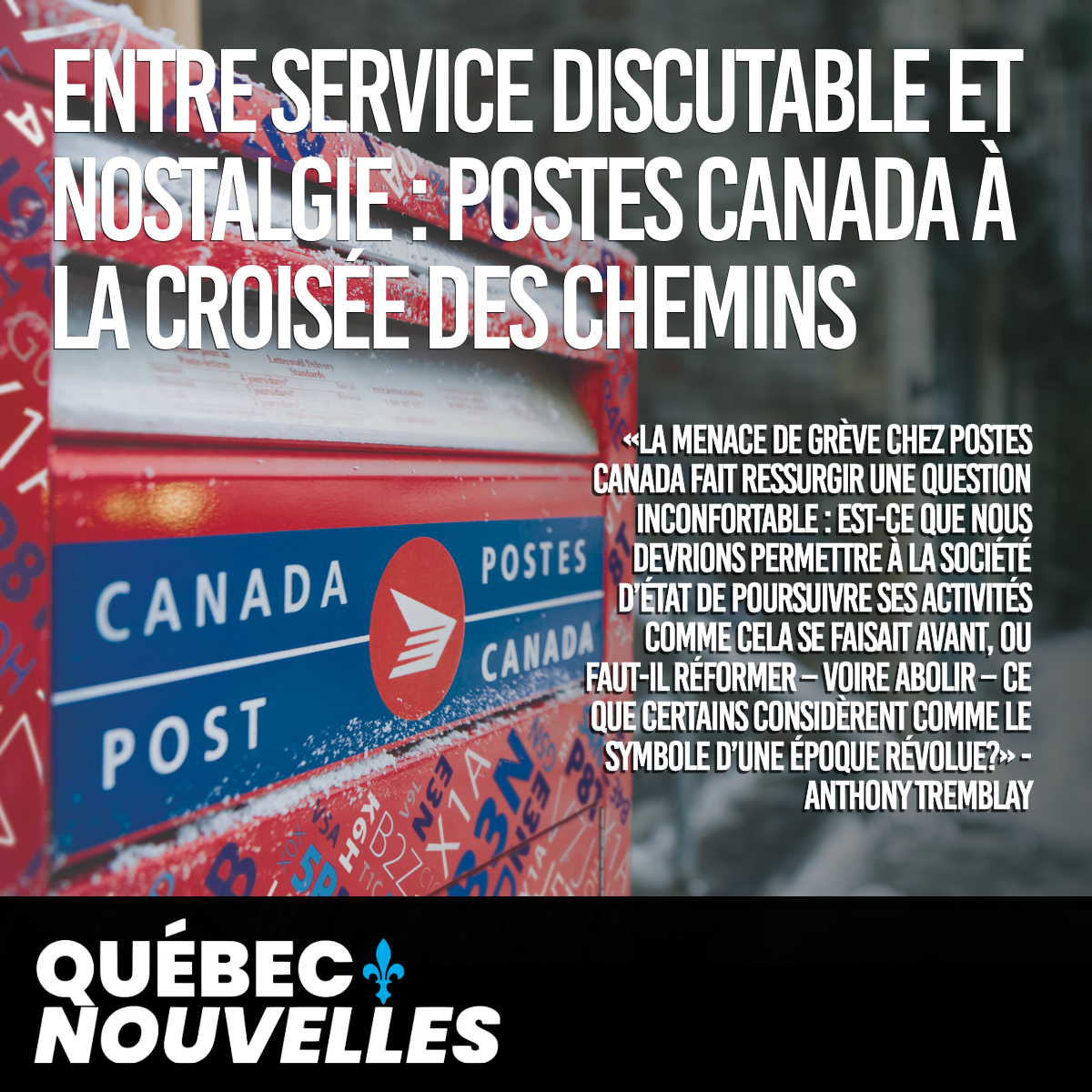Depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024, l’actualité avance à une vitesse folle. Le flot d’informations est tellement puissant qu’il devient difficile de suivre. Beaucoup ressentent une forme d’étouffement, une lassitude croissante face à cette surcharge d’informations. C’est un sentiment légitime. Les choses vont trop vite.
Il fut un temps où une nouvelle mettait des jours à se propager. Puis tout a changé avec CNN, qui a lancé l’info en continu dans les années 1990. La première guerre du Golfe a démontré l’impact d’une telle révolution : des journalistes couvrant les événements en temps réel, 24h/24.
D’autres ont suivi. Al-Jazeera au Qatar, RDI au Québec, la BBC, LCI en France. Les gouvernements ont compris le pouvoir du « soft power » médiatique, tandis qu’Internet et les réseaux sociaux ont fini par bouleverser la manière dont nous consommons l’information.
Les plateformes ont d’abord été accueillies avec enthousiasme, notamment par les médias progressistes, qui y voyaient un outil formidable de communication et de mobilisation. La campagne de Barack Obama en 2008 a été la première à utiliser pleinement les réseaux sociaux, incarnant une Amérique en rupture avec les années Bush, la guerre en Irak et l’influence des évangéliques à la Maison-Blanche.
Mais nous connaissons la suite. Les réseaux sociaux sont devenus des mastodontes, des monopoles d’information, des machines de viralité instantanée. Ce qui était autrefois salué est aujourd’hui perçu comme un problème : la désinformation, l’influence étrangère, la propagation rapide de la haine et des polémiques, l’érosion des médias traditionnels concurrencés par ces nouvelles plateformes.
Aujourd’hui, les gens passent des heures sur Facebook, X et Instagram, par habitude, comme un réflexe. Mais des études montrent que cette surconsommation s’accompagne de stress chronique, d’une montée du narcissisme et d’un taux de dépression en hausse. On parle souvent de désinformation, mais le problème est aussi la surinformation.
L’essentiel de l’actualité transite par quelques géants du web, et être « déconnecté » est presque impossible. Facebook est devenu incontournable pour vendre sur Marketplace, les entreprises imposent souvent un compte sur LinkedIn ou X, et les échanges sociaux passent désormais par Messenger, WhatsApp ou Instagram. L’hyperconnexion s’est imposée, et la fatigue collective devient palpable.
Le cerveau humain n’est pas conçu pour traiter autant d’informations simultanément. Lucien Francoeur, lors d’une entrevue aux Francs-Tireurs avec Richard Martineau, rappelait que l’invention de la roue avait modifié le cerveau humain. Qu’en est-il des écrans ?
Nous savons déjà que les enfants sont plus anxieux, plus colériques, plus difficiles à gérer. Les jeunes générations sont de plus en plus déconnectées des relations humaines « réelles ». La facilité avec laquelle on peut « mettre fin » à une amitié par un simple clic a changé notre rapport aux autres. L’interaction sociale devient de plus en plus distante : dans les transports, dans les files d’attente, chacun est plongé dans son écran.
Quelque chose s’est perdu en nous.
La politique chaotique des dernières semaines n’est qu’un symptôme d’un mal plus profond, une transformation rapide et brutale du monde dans lequel nous vivons.
De plus en plus de jeunes générations développent des tendances technophobes. Les adolescents s’éloignent des réseaux sociaux. Les milléniaux, eux, se réjouissent d’avoir grandi sans cette pression numérique constante. Des figures comme Ted Kaczynski, alias Unabomber, sont redécouvertes par certains, séduits par l’idée d’un retour à un monde sans écrans.
Mais revenir en arrière est-il seulement possible ?
Un monde sans réseaux sociaux, sans information instantanée, sans hyperconnexion, est une illusion.
Au lieu de fantasmer une utopie primitiviste, il faut trouver un équilibre. Réapprendre à se déconnecter. Revaloriser les relations humaines réelles. Faire des réseaux sociaux un outil, et non une dépendance.
Les réseaux sociaux ont du bon. Ils connectent, informent, créent des opportunités. Mais ils ne doivent pas être une prison numérique.
Nous devons trouver un équilibre entre le virtuel et le réel. Celui de l’amour, de l’amitié, de la nature, des relations humaines.
Avant qu’il ne soit trop tard.