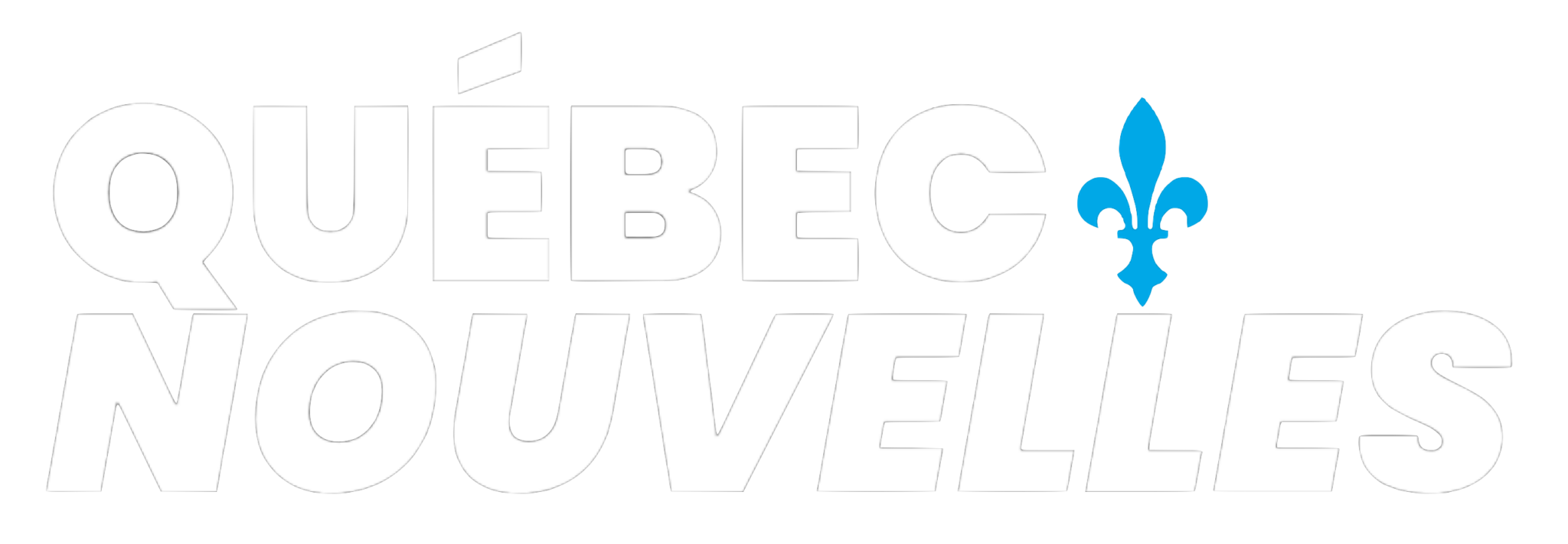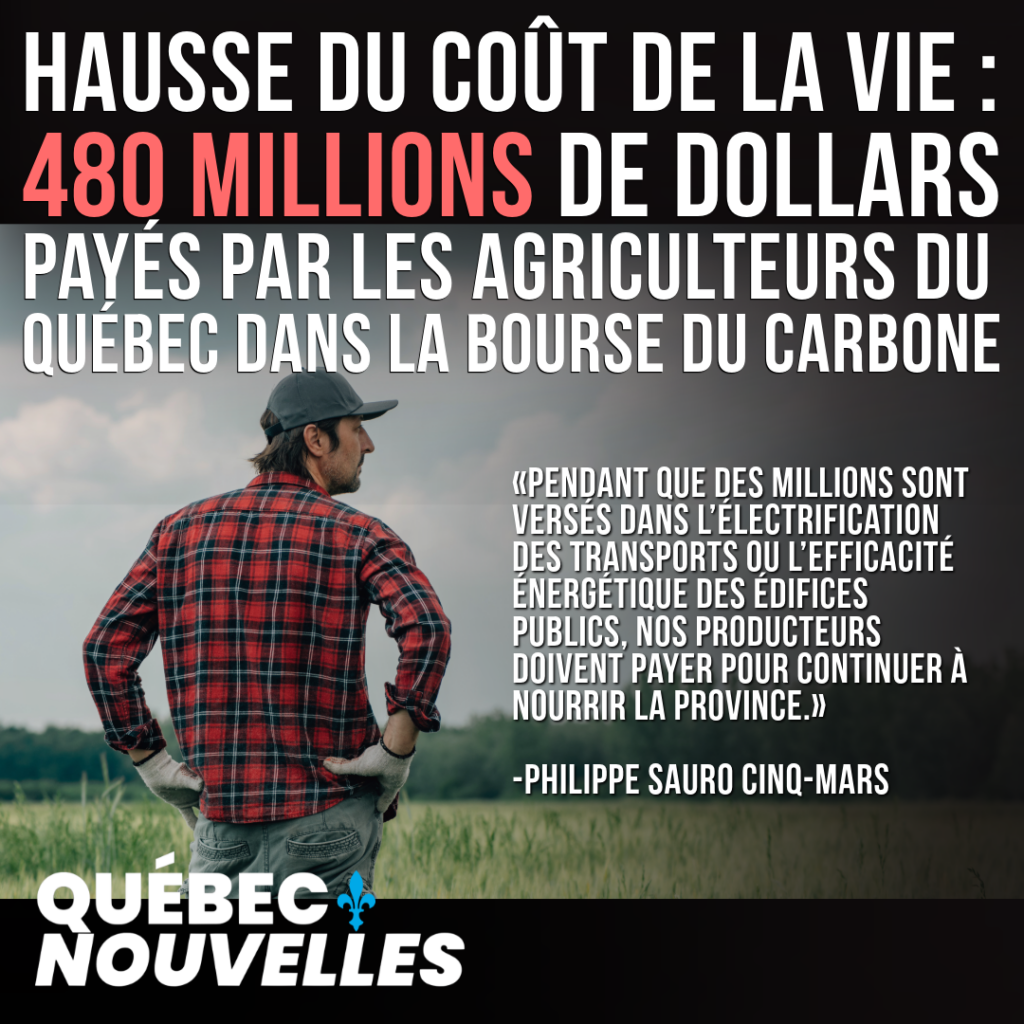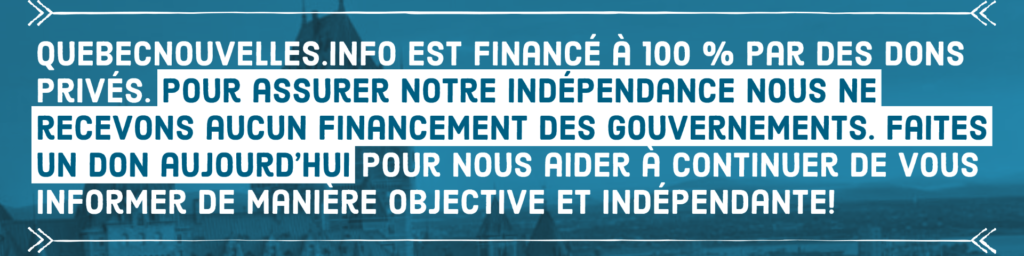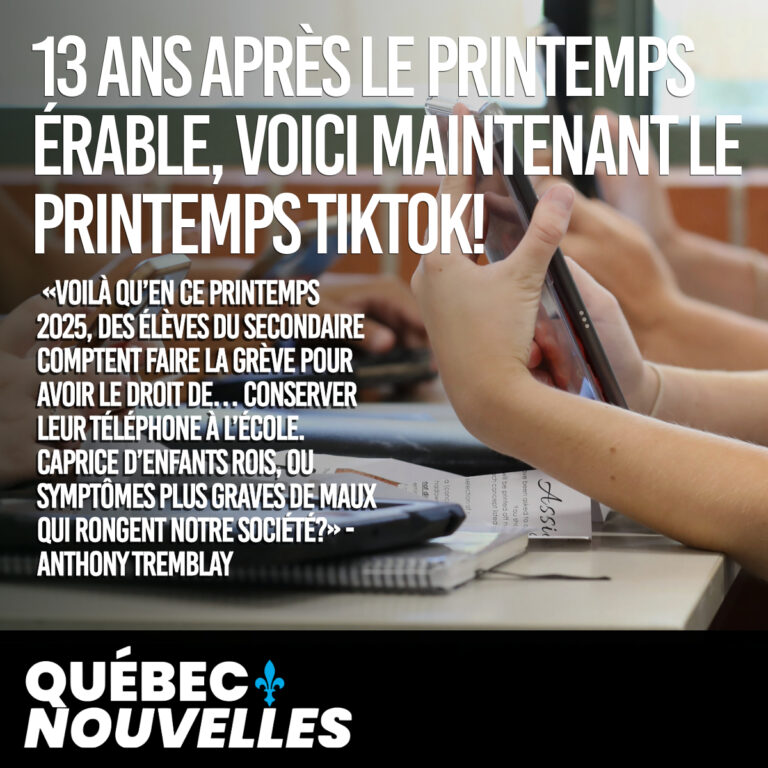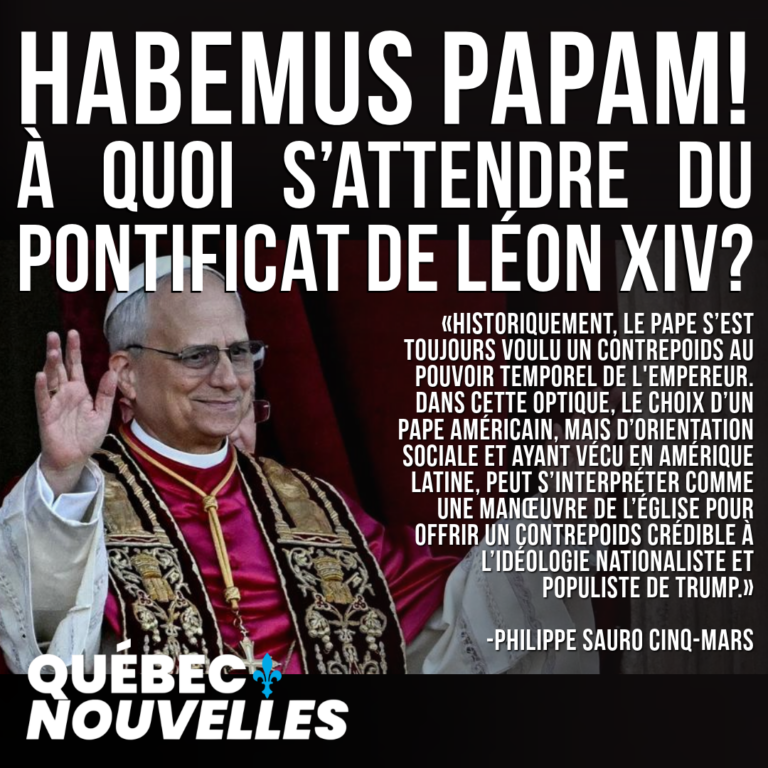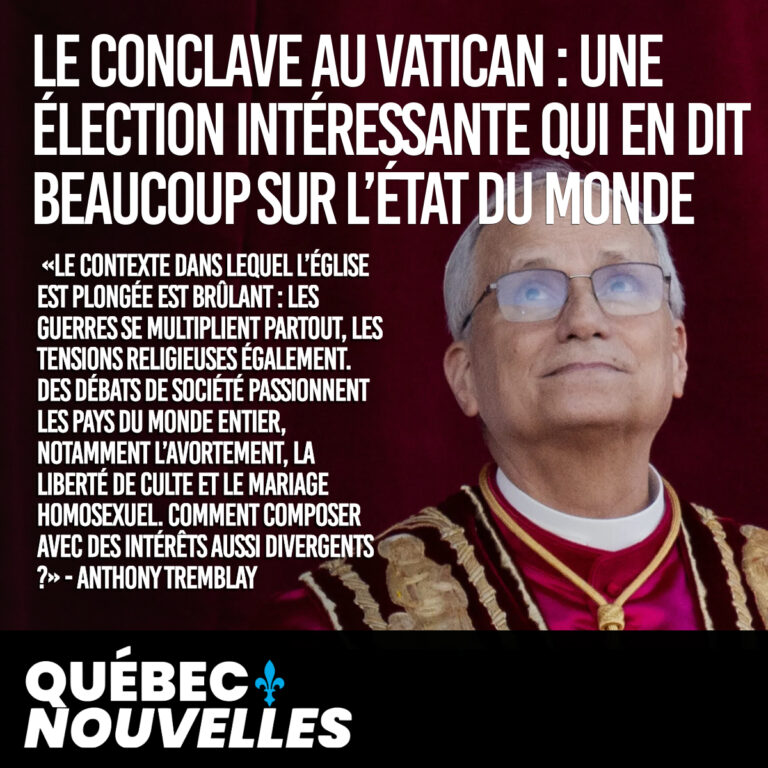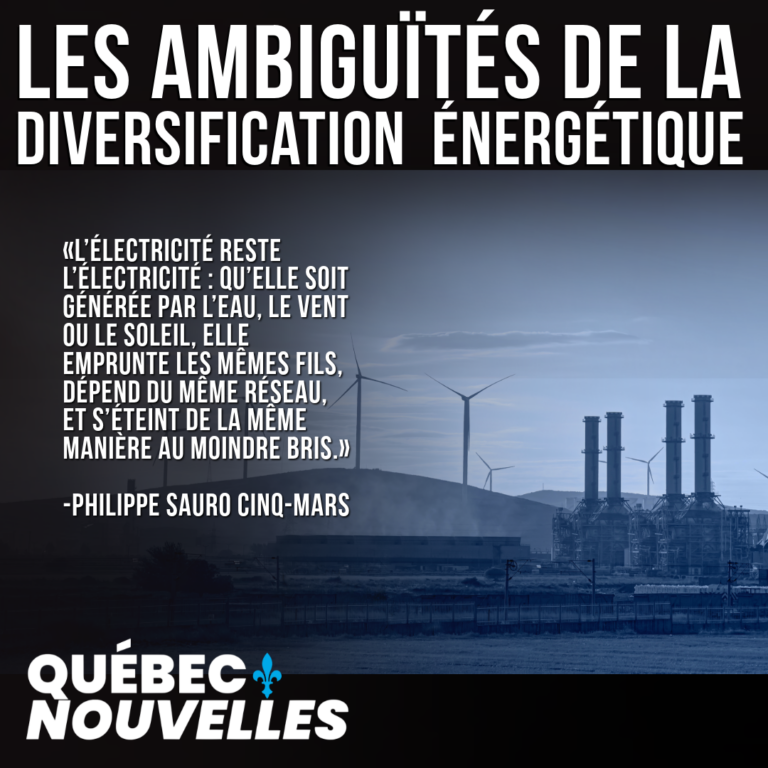Pendant que le gouvernement peaufine ses chiffres, les producteurs paient — et la population aussi
Nous avons appris récemment dans un article de La Presse que les agriculteurs québécois auraient versé 480 millions de dollars en taxes carbone au cours des quatre dernières années, une somme qui, selon l’Union des producteurs agricoles (UPA), dépasserait largement les 290 millions reçus du gouvernement pour faire face aux défis climatiques. Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, conteste ces chiffres, évoquant plutôt une contribution de 140 millions. Quelle que soit la version retenue, cette confusion comptable est inacceptable, surtout dans un contexte où les prix des denrées alimentaires continuent de grimper.
Désaccord sur les chiffres
Le débat oppose la vision gouvernementale à celle de l’UPA. D’un côté, l’organisation agricole affirme que ses membres ont versé près d’un demi-milliard de dollars depuis 2020 via le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE), notamment à travers les taxes sur les carburants. De l’autre, le ministre André Lamontagne soutient que le calcul est erroné, citant un mémoire du ministère des Finances évaluant la contribution agricole à seulement 140 millions.
Cette divergence souligne une problématique plus profonde : l’absence de transparence et de clarté dans la gestion des fonds liés à la taxe carbone. Pendant que les autorités débattent des chiffres, les agriculteurs, eux, subissent les conséquences financières, et les consommateurs voient leur facture d’épicerie augmenter.
La vache à lait pour d’autres industries?
« On aimerait que le secteur agricole ne soit pas utilisé comme la vache à lait de la Bourse carbone », a plaidé le député libéral André Fortin. Une image brutale, mais qui résume parfaitement la situation. Le SPEDE, tel qu’il est structuré, fonctionne sur le principe du marché : les pollueurs achètent des crédits d’émissions dans une logique d’incitation économique. Mais dans les faits, les agriculteurs n’ont pas le luxe d’ajuster instantanément leurs pratiques ou d’investir massivement dans des équipements électrifiés, encore trop chers ou inadaptés aux réalités rurales.
Pendant ce temps, les revenus générés par leurs contributions sont redirigés vers des projets jugés plus « innovants », souvent urbains, expérimentaux, parfois carrément déconnectés du terrain. Le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), qui recueille les recettes du SPEDE, finance une multitude de programmes, sans que l’agriculture n’y obtienne sa juste part. Pendant que des millions sont versés dans l’électrification des transports ou l’efficacité énergétique des édifices publics, nos producteurs doivent payer pour continuer à nourrir la province.
Ce modèle de redistribution, sous couvert de vertu climatique, ressemble de plus en plus à un mécanisme de transfert de richesse de la terre vers le béton, des campagnes vers les villes. Ce sont les producteurs qui paient les unités d’émissions, mais ce sont les startups vertes et les centres de recherche urbains qui en récoltent les fruits. Est-ce cela, la transition équitable?
Un enjeu global?
Ce déséquilibre ne touche pas que le Québec. Depuis quelques années, des soulèvements agricoles ont eu lieu en Europe, notamment aux Pays-Bas et en France, où les politiques environnementales sont perçues comme des attaques déguisées contre le monde rural. À La Haye, des convois agricoles ont bloqué les routes pour dénoncer une politique d’émission qui mettait en péril l’agriculture nationale au nom d’objectifs imposés de réduction d’azote. En France, la colère a grondé contre une fiscalité verte jugée injuste et contreproductive.
Bien que ces manifestations datent de quelques années, la grogne persiste. Les agriculteurs ne réclament pas le droit de polluer à volonté. Ils demandent un traitement juste, proportionné à leur rôle. Ils dénoncent le fait d’être les seuls à devoir s’adapter aussi rapidement, souvent sans soutien adéquat, pendant que les grandes industries et les élus profitent de passe-droits ou de délais.
Le Québec semble suivre la même pente glissante. Si les protestations y sont encore timides, l’impatience grandit. Et à juste titre : peut-on vraiment se permettre de reproduire les mêmes erreurs que les gouvernements européens, en refusant d’écouter ceux qui travaillent la terre?
Un enjeu canadien
À l’échelle canadienne, la taxe carbone a été un sujet de discorde. Le plan de carboneutralité de Justin Trudeau avait déclenché une levée de boucliers dans l’Ouest canadien, où les producteurs dénonçaient la hausse des coûts d’exploitation liée à la tarification du carbone. Certes, des exemptions existaient sur certains carburants agricoles, mais dans les faits, de nombreux postes de dépenses y échappaient, et les hausses de prix se répercutaient sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Récemment, le nouveau premier ministre, Mark Carney, a suspendu la taxe carbone pour les consommateurs, reconnaissant ainsi son impopularité et son impact sur le coût de la vie. Cependant, cette suspension ne s’applique pas au Québec, qui maintient son propre système de tarification via le SPEDE. Ainsi, les agriculteurs québécois continuent de supporter des coûts supplémentaires, accentuant leur désavantage concurrentiel par rapport aux autres provinces.
Achetez québécois… et plus cher
En conclusion, le gouvernement aime nous rappeler l’importance de soutenir nos producteurs locaux. « Achetez québécois », entend-on à la moindre occasion. Mais ce bel impératif moral se heurte à une réalité de plus en plus brutale : acheter local coûte cher, et c’est en bonne partie à cause des politiques gouvernementales elles-mêmes.
Dans une période d’inflation galopante, où les familles doivent choisir entre les légumes ou le loyer, on ne peut plus se permettre ce genre de contradictions. L’État exige des producteurs des efforts titanesques sans leur offrir les moyens de s’y conformer, et pendant ce temps, la population paie la facture à l’épicerie. Il n’est plus acceptable que l’État québécois tergiverse sur des calculs budgétaires pendant que les citoyens et les producteurs s’appauvrissent. Le besoin de « rodage » du SPEDE est un luxe que ni les familles ni les fermes ne peuvent se permettre.
Le bon sens exige une pause. Non pas une pause dans la lutte environnementale, mais une pause dans les politiques aveugles qui font de l’agriculture une variable d’ajustement. Les producteurs ne sont pas des pollueurs : ce sont les piliers de notre survie collective. Les taxer comme des pétrolières n’est pas seulement absurde : c’est dangereux.