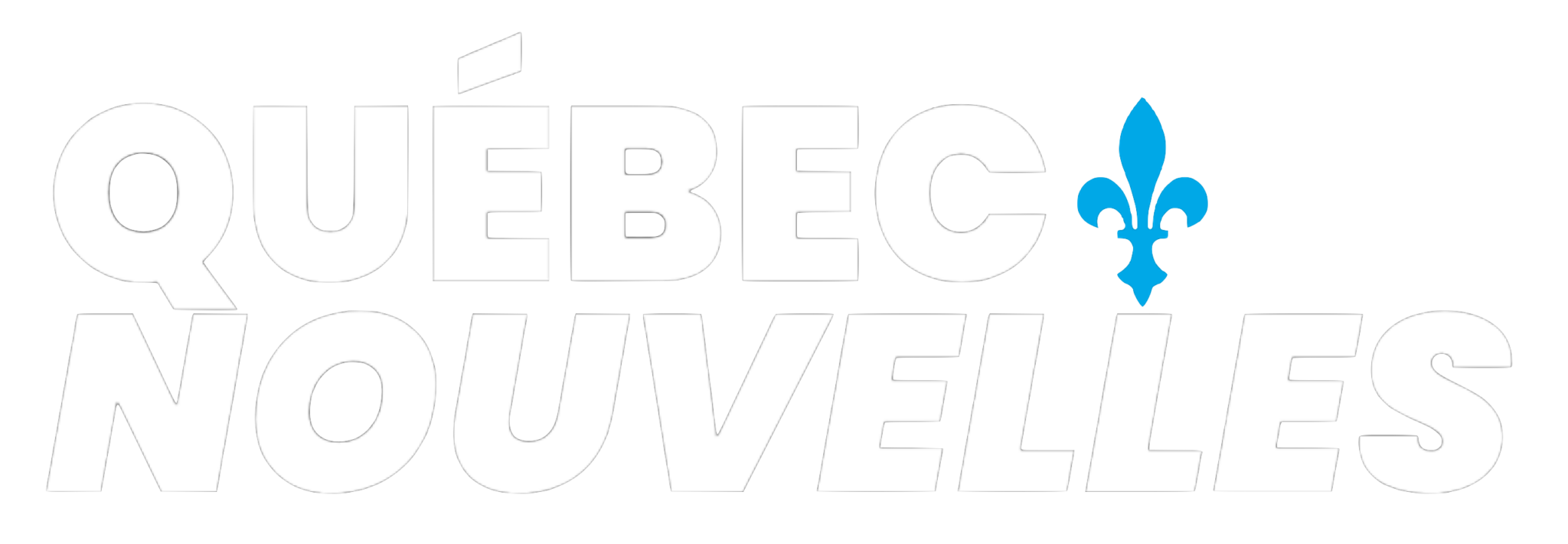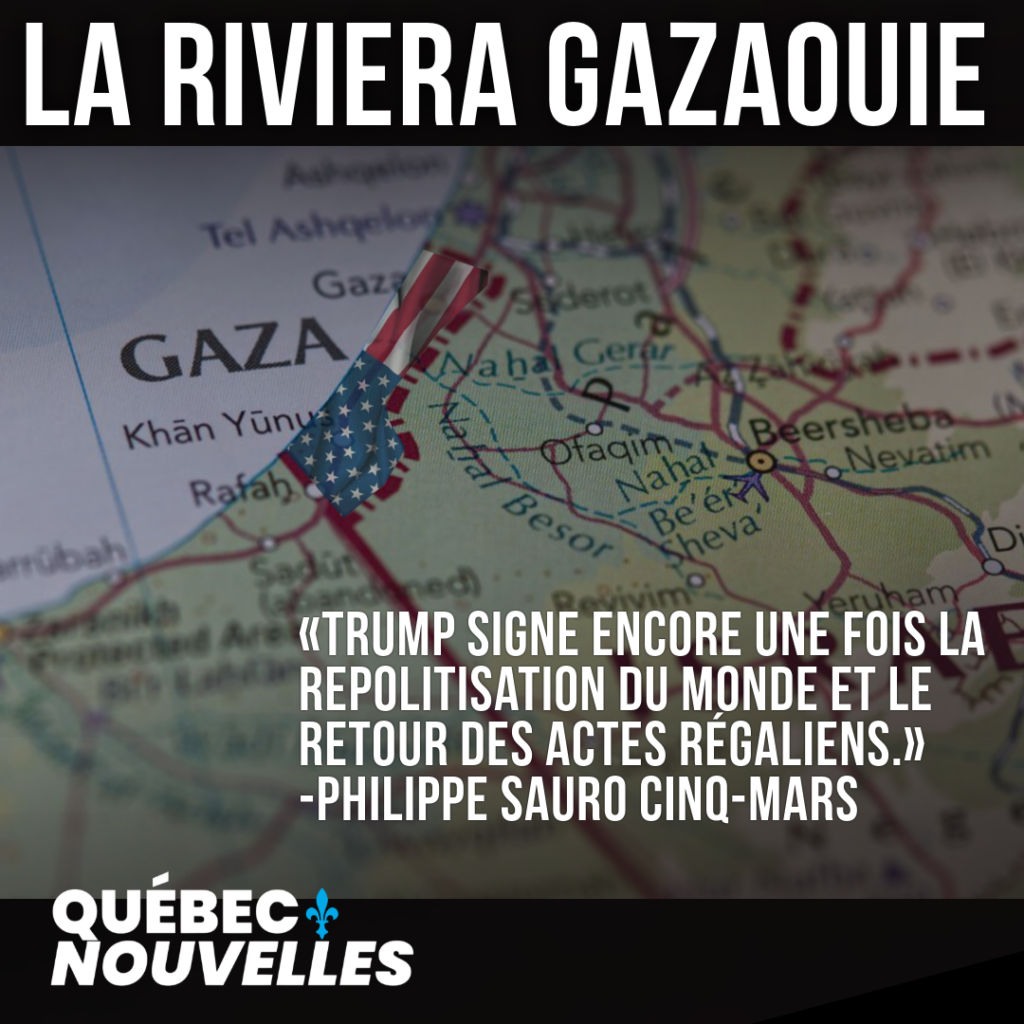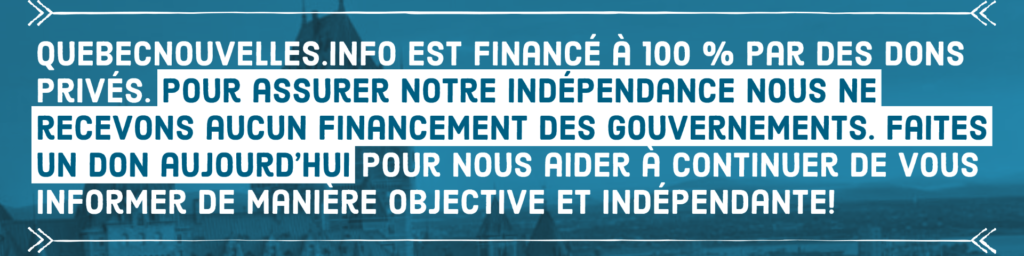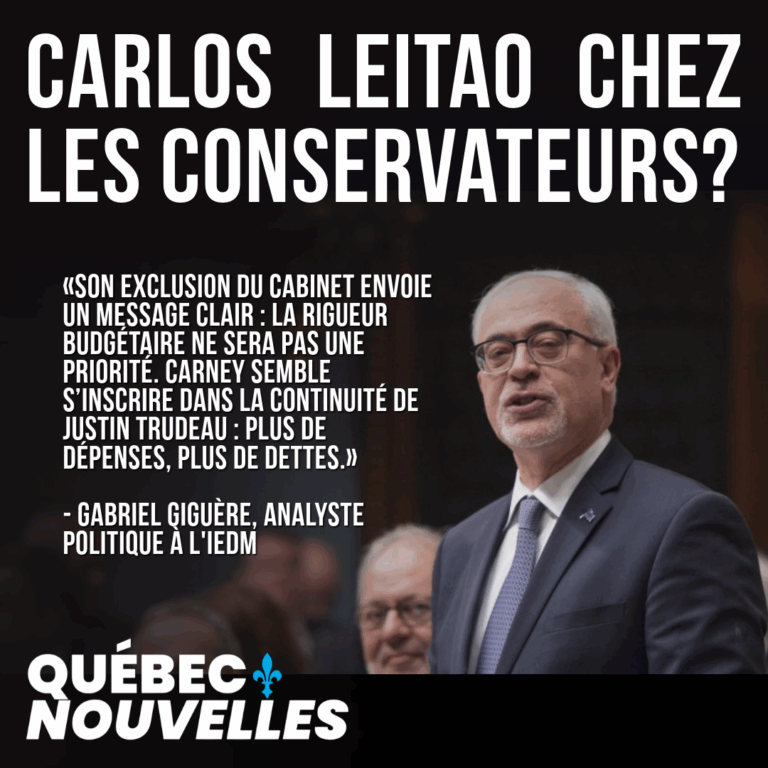Trump signe encore une fois la repolitisation du monde et le retour des actes régaliens. Après des années de stagnation civilisationnelle sous des institutions supraétatiques mondialistes et idéologiquement orientées, il ramène le pouvoir politique brut de la fonction présidentielle sur la scène mondiale, et refaçonne le monde à la manière des empereurs d’antan.
Face à Poutine, qui a profité de son absence pour lancer son « opération spéciale » sur l’Ukraine, Trump pense probablement que la violation de la frontière de cet « étranger proche » est une limite de trop franchie par Poutine, et qu’il doit offrir une réponse équivalente dans une intense reconfiguration géostratégique en Amérique du Nord. Il avait déjà évoqué l’idée d’une intervention militaire au Venezuela, et sous sa première présidence, il avait envisagé le rachat du Groenland, territoire stratégique d’une importance majeure dans l’Arctique. La doctrine trumpienne semble donc s’inscrire dans une logique de revendications territoriales et d’élargissement du pré-carré américain, comme l’attestent ses critiques régulières du manque de contribution militaire du Canada et de son intérêt ouvert pour le canal de Panama.
Maintenant, cependant, c’est différent. Trump a franchi une ligne de plus, une ligne à peine croyable. Il ne s’agit plus simplement de « repolitisation du monde », mais bien de « réhistorisation ». Car Trump brise désormais le plus grand des tabous en intervenant directement dans l’histoire. C’est au tour de Gaza de se voir « offrir » une annexion américaine et un projet de rénovation en « Riviera » touristique… et aux Gazaouis insatisfaits, un sauf-conduit vers l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, etc.
En effet, Trump aurait proposé de transformer Gaza en une « zone spéciale » sous administration américaine, avec un plan de développement inspiré de Dubaï et de Singapour. Il aurait déclaré lors d’un meeting : « Pourquoi Gaza devrait-elle rester une plaie ouverte alors qu’elle pourrait devenir la perle de la Méditerranée ? » Ce projet s’appuierait sur des investissements privés massifs, une politique d’exemption fiscale et une ouverture aux entreprises occidentales et arabes. L’idée, bien que radicale, s’inscrit dans sa vision pragmatique d’une « revanche par le succès économique », où la prospérité éclipserait les conflits idéologiques.
Trump va donc jusqu’à quitter la stricte défense des intérêts nord-américains et démontre désormais l’extension de cette politique au Moyen-Orient. Par la même occasion, il sécurise son allié israélien en établissant une présence américaine permanente sur le flanc sud d’Israël, un moyen de contrer les ambitions iraniennes et de contenir l’influence russe et chinoise dans la région. En agissant ainsi, il oppose une stratégie de développement et de stabilisation aux tactiques agressives et militaires employées par Moscou en Ukraine et par Pékin en mer de Chine.
Mais là où l’audace de Trump devient carrément choquante, c’est qu’on parle tout de même de l’un des territoires les plus convoités de l’histoire de l’humanité ; d’une partie de la fameuse « Terre-Sainte ». Bien que Gaza ne soit qu’une bande de terre aride et pauvre donnant sur la Méditerranée, on est bien conscient que la région a des milliers d’années d’histoire. En allant mettre son doigt là-dedans, Trump réactive des mécaniques historiques anciennes qui sont un pensez-y bien. En effet, l’idée de transformer Gaza en une entité autonome sous protection américaine rappelle étrangement les États latins d’Orient créés après les croisades. Une enclave occidentale en plein Moyen-Orient, où le contrôle politique et économique serait exercé par une puissance extérieure, pourrait raviver des tensions profondes et provoquer une résistance féroce.
Maintenant, la réaction d’outrage est compréhensible, considérant qu’on la voit comme une manière d’effacer la Palestine, mais d’une autre côté, il est curieux qu’on s’outrage d’espérer pacifier la région et la rendre prospère au point de devenir une luxueuse riviera. On disait autrefois que le Liban était la « Côte d’Azur du Moyen-Orient », et il n’y a pas de raison pour que ces pays ne se restabilisent pas autour de tels projets. Manifestement, les politiques guerrières des dernières décennies ne fonctionnent pas. Trump, en campagne, prônait la « revanche par le succès », l’idée qu’un pays ou une région pouvait surmonter ses traumatismes historiques par l’opulence et la prospérité économique. Son projet pour Gaza s’inscrit dans cette logique, qui consiste à étouffer les ressentiments par l’abondance plutôt que par les armes.
Car au-delà de la simple ambition de transformer Gaza en un centre de luxe et de tourisme, une question cruciale demeure : celle de la reconstruction. Gaza est aujourd’hui un territoire ravagé par les conflits, miné au sens propre comme au figuré. La première étape d’un tel projet nécessiterait un effort colossal de déminage, de stabilisation des infrastructures et de remise en état des services publics. Un parallèle évident peut être établi avec le plan Marshall, qui avait permis de reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre mondiale grâce à des investissements américains massifs. Un projet de cette ampleur nécessiterait des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, et devrait impliquer une coopération internationale pour garantir sa viabilité. Une telle entreprise permettrait non seulement d’éteindre le foyer de tensions actuel, mais aussi de redonner une dynamique économique durable à la région, tout en assurant un ancrage stratégique pour Washington.
Cette dynamique de repolitisation et de réhistorisation du monde marque une rupture nette avec l’illusion d’une stabilité permanente sous la gouvernance des institutions internationales. L’intervention de Trump à Gaza pourrait inaugurer une nouvelle ère de géopolitique assumée, où les grandes puissances n’hésiteront plus à redessiner la carte du monde à l’aune de leurs intérêts et ambitions. Or, si l’annexion américaine de Gaza se concrétisait, elle ouvrirait un précédent, non seulement pour Washington, mais aussi pour d’autres puissances régionales et mondiales qui pourraient y voir une légitimation de leurs propres projets expansionnistes.