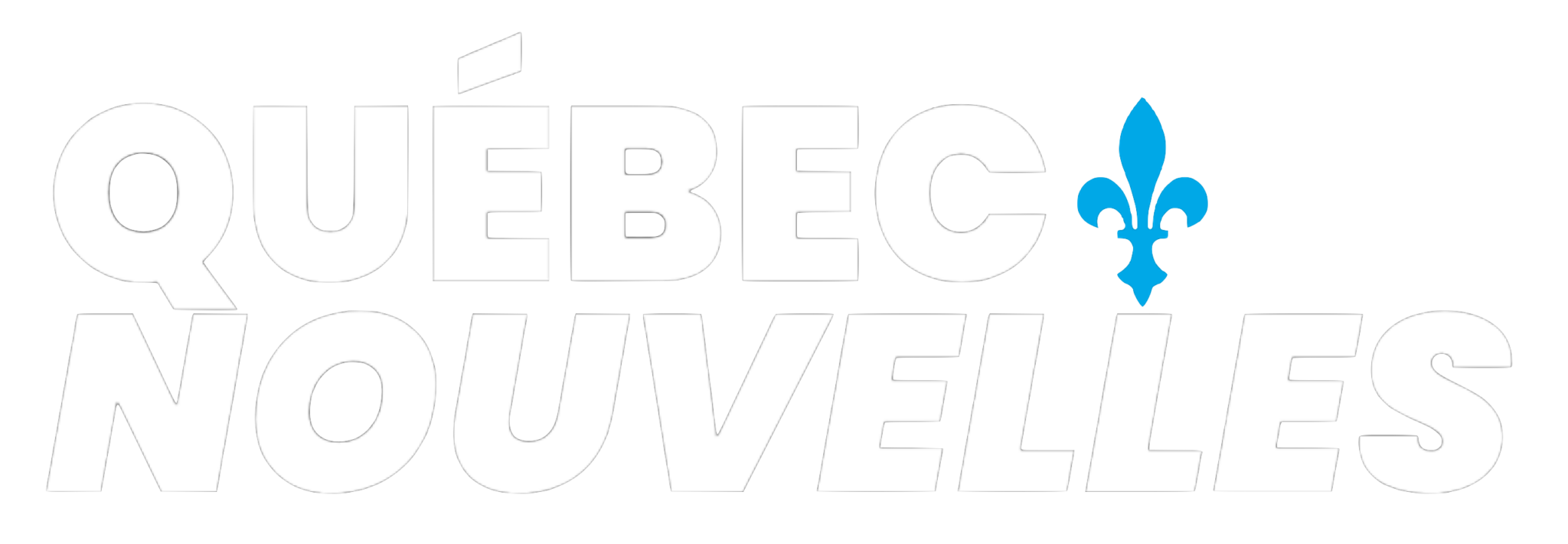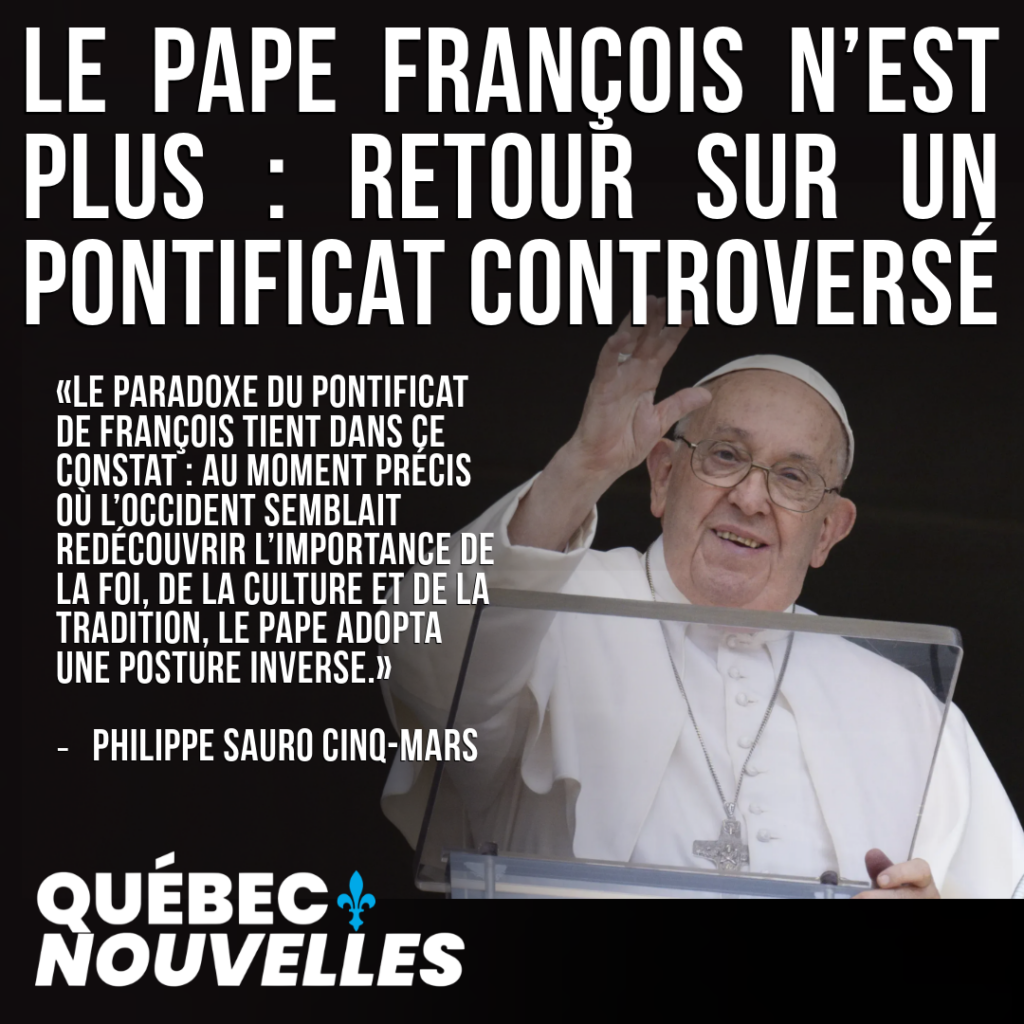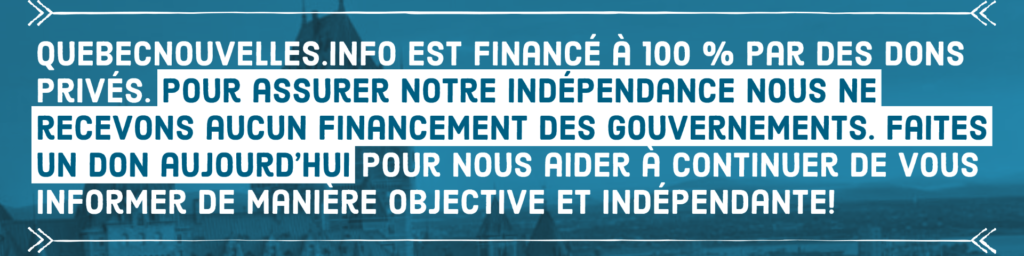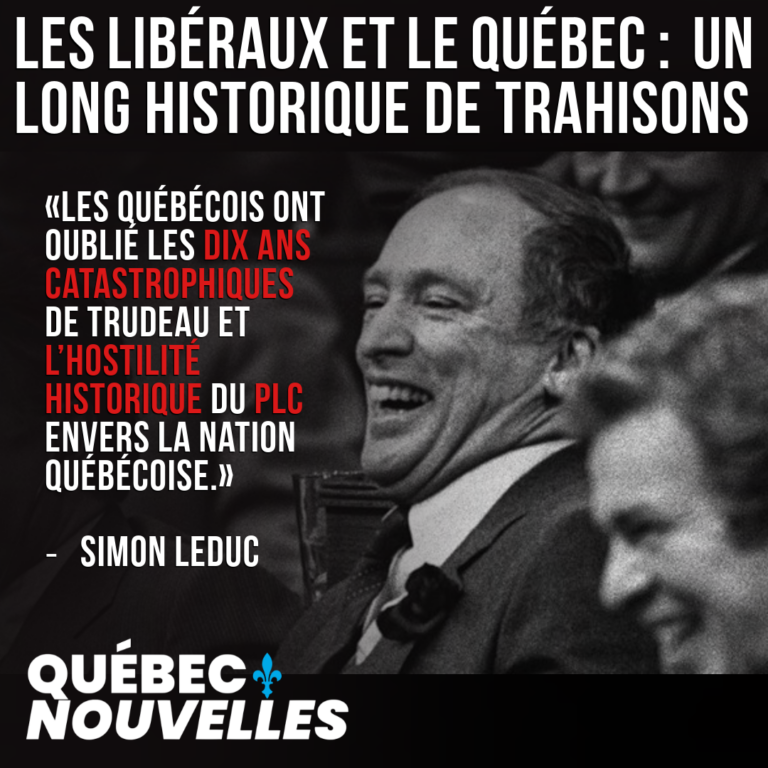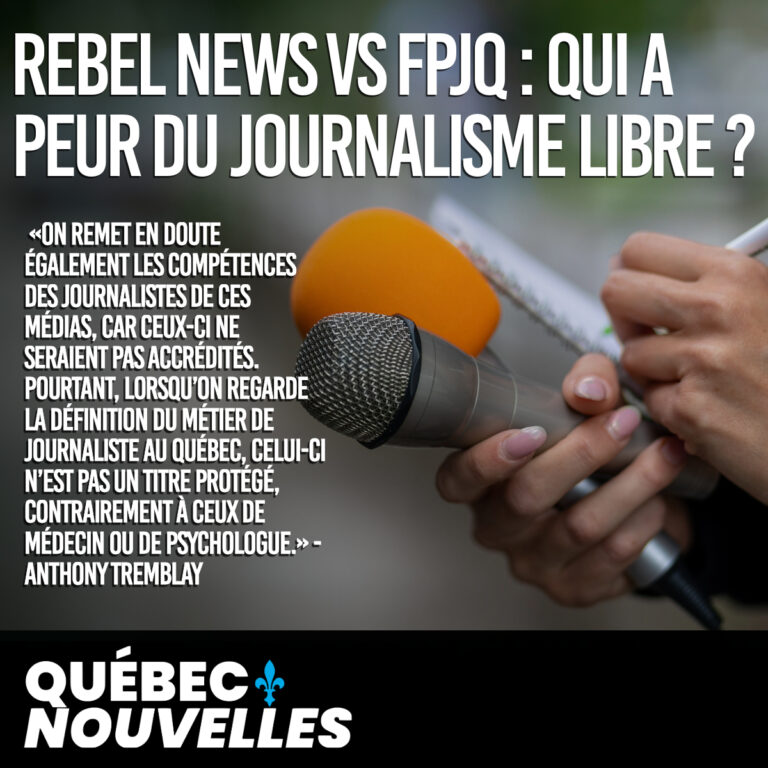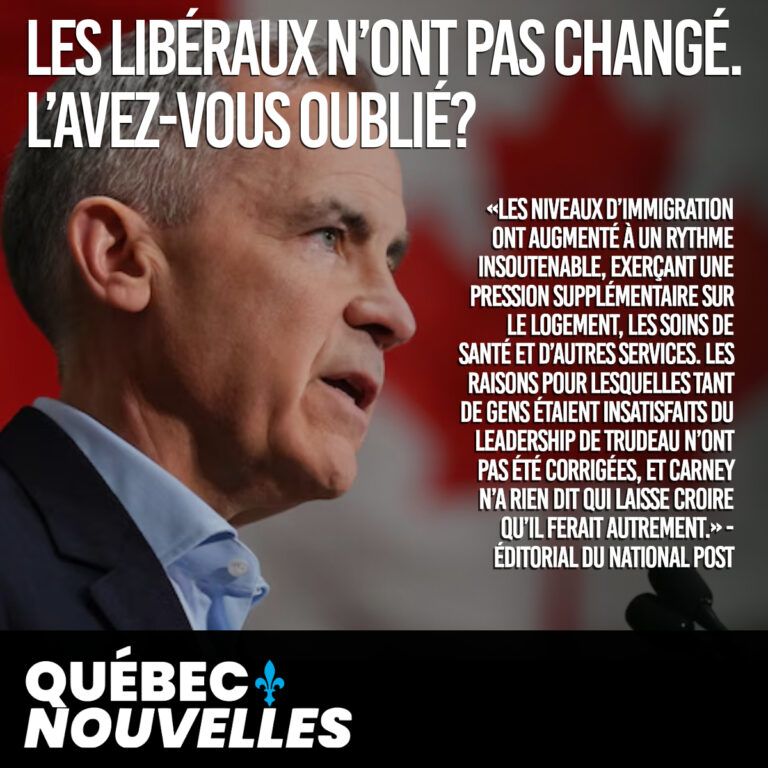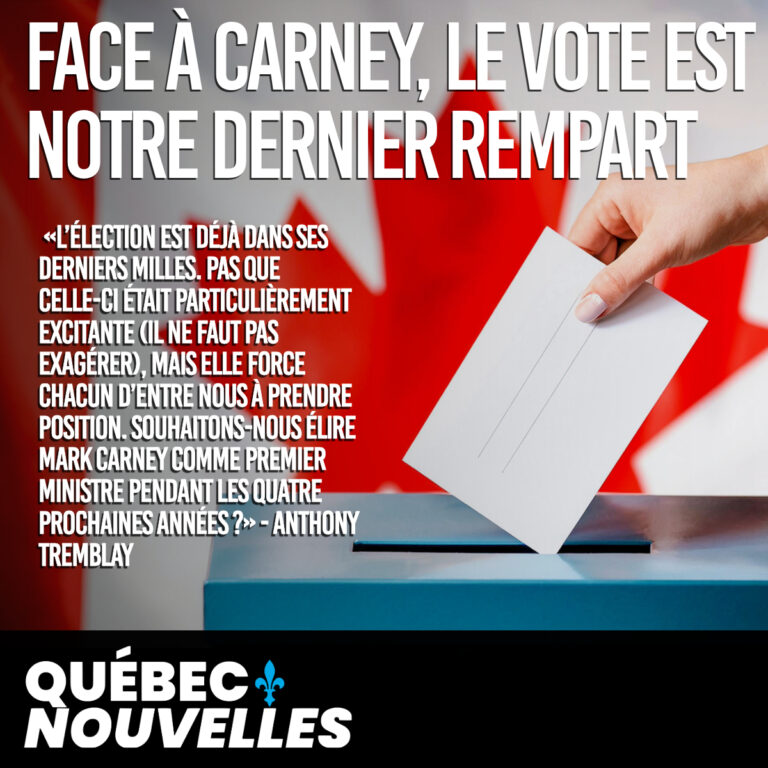Tôt ce matin, le pape François 1er, né Jorge Mario Bergoglio, s’est éteint à Rome à l’âge de 88 ans. Le souverain pontife, affaibli depuis plusieurs mois, a succombé à un accident vasculaire cérébral ayant provoqué une insuffisance cardiaque. Cette disparition survient moins de vingt-quatre heures après sa dernière bénédiction « Urbi et Orbi » du dimanche de Pâques — un geste chargé de solennité, prononcé d’une voix éteinte, comme si le monde entier avait été invité à ses adieux. L’Argentin laisse derrière lui une Église divisée, ébranlée par des années de controverses doctrinales, de prises de position politiques, et d’efforts de réforme à contre-courant d’un monde catholique de plus en plus tenté par le retour aux sources.
Ce premier pape latino-américain, élu après la renonciation de Benoît XVI, a très tôt cherché à briser les codes et les protocoles. Refusant les dorures du Vatican, troquant la limousine papale contre une Ford Focus, il s’est imposé comme le pape de la proximité — mais aussi, pour beaucoup, comme le pape de la rupture. Sa mort ne marque pas seulement la fin d’un pontificat : elle ouvre une ère d’incertitude dans une Église à la croisée des chemins.
2013 : une élection papale inédite
L’élection de Jorge Mario Bergoglio au trône de Pierre, en mars 2013, fut à elle seule un séisme. D’abord parce qu’elle succédait à un événement rarissime : l’abdication volontaire de Benoît XVI, qui invoqua son âge avancé et son incapacité à gouverner efficacement. C’était la première renonciation papale depuis Grégoire XII en 1415, et la première de plein gré depuis Célestin V en 1294. À l’époque, cette décision provoqua la stupeur dans le monde catholique : la fonction papale, jusque-là perçue comme un engagement jusqu’à la mort, devenait soudain révocable. Ce geste, éminemment humble mais lourd de conséquences, créa une brèche dans l’idée même de pérennité apostolique.
La renonciation de Benoît XVI laissa place à un conclave sous tension. L’Église était alors secouée par les affaires de pédophilie, des scandales financiers au sein de la Banque vaticane, et un désarroi croissant face à la sécularisation de l’Occident. Le cardinal argentin Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, apparaissait comme un outsider, mais jouissait d’une réputation de simplicité et de rigueur morale. Son style contrastait fortement avec l’intellectualisme théologique et la raideur doctrinale de Joseph Ratzinger. Les cardinaux cherchèrent un homme de rupture, un pontife en mesure de restaurer la crédibilité de l’Église. Ils choisirent un homme du bout du monde.
L’élection d’un jésuite latino-américain, premier pape non-européen depuis plus d’un millénaire, envoya un message clair : celui d’un aggiornamento radical. Bergoglio, perçu comme progressiste, se distingua rapidement de ses prédécesseurs par une posture moins dogmatique, moins portée sur la liturgie et davantage tournée vers l’action sociale. Dès ses premiers gestes, il montra sa volonté d’apparaître comme un « serviteur des serviteurs », refusant les atours pontificaux traditionnels et appelant l’Église à sortir de ses murs.
Le pape des pauvres
En choisissant le nom de « François », en référence explicite à saint François d’Assise, Bergoglio envoyait un signal fort : celui d’un retour aux fondamentaux évangéliques, à la pauvreté, à la fraternité et à la simplicité. L’image du cardinal austère, se déplaçant en transport en commun à Buenos Aires, se superposa immédiatement à celle du saint italien dépouillé de ses richesses. Le nouveau pape affirma vouloir « une Église pauvre pour les pauvres », reprenant une expression longtemps marginalisée dans les cercles ecclésiaux.
À Rome, plusieurs anecdotes circulèrent sur ses sorties nocturnes, déguisé en simple prêtre, pour porter des repas aux sans-abris. Il refusa d’habiter les appartements pontificaux du palais apostolique, leur préférant la résidence modeste de la Maison Sainte-Marthe. Son choix ne fut pas que symbolique : il incarnait une théologie sociale ancrée dans l’expérience latino-américaine des périphéries. Pour les médias occidentaux, ce fut un souffle nouveau ; pour certains catholiques traditionnels, une inquiétude : le pape ne devenait-il pas un militant politique ?
Les critiques ne tardèrent pas à surgir. L’accent mis sur la justice sociale, les appels incessants à l’accueil des migrants, les dénonciations du capitalisme mondialisé et des inégalités économiques valurent à François des accusations récurrentes de « socialisme spirituel ». Aux États-Unis, certains commentateurs conservateurs l’associèrent même à la gauche radicale. Là où Jean-Paul II avait combattu le communisme avec une rigueur doctrinale, François paraissait en dialogue constant avec les courants altermondialistes. La doctrine sociale de l’Église devenait l’axe central de son magistère — au risque de diluer le contenu théologique et sacramentel au profit du discours humanitaire.
Ingérences politiques ?
Le pontificat de François fut sans doute l’un des plus politiques de l’histoire moderne. Là où Jean-Paul II avait influencé les équilibres géopolitiques par sa présence morale, et où Benoît XVI s’était replié dans les hauteurs de la pensée théologique, François s’invita dans le débat public mondial avec une ardeur quasi militante. Il dénonça vigoureusement les politiques migratoires des États-Unis, notamment sous l’administration Trump, critiquant la construction du mur à la frontière mexicaine et la séparation des familles. Il qualifia le populisme de « peste », en l’associant aux logiques des années 1930.
Sur le front climatique, il publia l’encyclique Laudato si’, dans laquelle il fustigea la destruction de la planète, le consumérisme et les logiques de croissance illimitée. Il alla jusqu’à qualifier les climatosceptiques de « stupides », se posant en acteur engagé de l’écologie politique. Ce texte, applaudi par la gauche internationale, fut critiqué par ceux qui voyaient dans cette prise de position une rupture avec la prudence d’usage du Saint-Siège en matière de politique temporelle.
Mais c’est sur la question islamique que François heurta profondément une partie de la chrétienté. Après l’attentat de Charlie Hebdo, il déclara qu’« on ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres », insinuant qu’une partie de la responsabilité morale revenait aux caricaturistes eux-mêmes. Ce discours de conciliation, perçu comme une forme d’apologie, choqua profondément dans un contexte où les martyrs de la liberté d’expression étaient encore à peine inhumés. Pour certains catholiques européens, ce fut la goutte de trop : le pape semblait défendre l’étranger plus que ses propres ouailles.
Une décennie catastrophique pour la Chrétienté
Durant les douze années de son pontificat, la chrétienté vécut une série de crises sans précédent. L’exode des chrétiens d’Orient s’accéléra dramatiquement après la guerre en Syrie et l’avènement de Daech. Des villages chrétiens plurimillénaires furent rayés de la carte. En Égypte, au Nigeria, au Pakistan, les attentats ciblant des églises se multiplièrent. En Europe, des centaines d’édifices religieux furent profanés, incendiés, ou transformés en centres culturels sans que le Vatican ne manifeste de réaction proportionnelle à la gravité des faits.
En parallèle, l’Occident entamait un glissement culturel inquiétant. La montée de l’idéologie woke, la redéfinition du genre et de la famille, et l’institutionnalisation de la culture de l’avortement, se heurtèrent à une Église peu offensive. François, loin de condamner frontalement ces dérives, préféra employer le langage de l’inclusion, de l’écoute et du discernement. Il multiplia les gestes d’ouverture envers les homosexuels, allant jusqu’à déclarer : « Qui suis-je pour juger ? » — une phrase emblématique de son approche, mais profondément ambiguë sur le plan doctrinal.
Cette absence de ligne claire affaiblit considérablement l’autorité du magistère. Au lieu de se poser en rempart contre l’apostasie moderne, François sembla parfois accompagner le mouvement, espérant peut-être le rediriger de l’intérieur. Ce fut un pari risqué, dont les fruits, pour l’instant, ne sont guère visibles. Les églises d’Europe continuèrent à se vider, les vocations à s’effondrer, et le sentiment d’abandon gagna de nombreux fidèles attachés à la tradition.
Un rendez-vous manqué ?
Le paradoxe du pontificat de François tient dans ce constat : au moment précis où l’Occident semblait redécouvrir l’importance de la foi, des frontières, de la culture et de la tradition, le pape adopta une posture inverse. La jeunesse catholique qui revient à la messe n’est pas celle de la réforme, mais celle du rite tridentin. À Paris, New York ou Varsovie, ce sont les chapelles de la messe en latin qui débordent, pas les églises modernistes. Et pourtant, François décida en 2021 de restreindre sévèrement l’accès à l’ancien rite, dans un motu proprio (Traditionis Custodes) vécu comme une provocation.
L’idée de « moderniser » l’Église est devenue une sorte de totem idéologique. Or, cette modernisation ne cesse d’éloigner les fidèles. Depuis Vatican II, chaque réforme a entraîné une perte d’autorité, une chute de la pratique religieuse, et un affaiblissement du sacré. Les générations montantes n’ont pas besoin d’une Église qui épouse les slogans du temps ; elles cherchent du mystère, du dogme, une transcendance. En ce sens, le pontificat de François apparaît comme un rendez-vous manqué avec l’Histoire.
Le langage technocratique, les gestes humanitaires et les sourires médiatiques n’ont pas suffi à raviver la foi. Pire : ils ont parfois donné l’impression d’un reniement. Lorsque les églises brûlent en France et qu’un pape reste silencieux, le doute s’installe. Lorsque les dogmes fondamentaux sont relativisés, les fidèles s’égarent. Et lorsque l’Église semble s’excuser d’exister, elle cesse d’être un phare.
Un retour des conservateurs ?
La mort de François ouvre donc une ère de recomposition. Le conclave qui s’annonce s’organise dans un climat de tension, mais aussi d’optimisme. La majorité des cardinaux électeurs ont été nommés par François lui-même — mais beaucoup d’entre eux, au fil des années, se sont montrés critiques de sa gouvernance, notamment sur la liturgie et la discipline sacramentelle. Le retour d’une ligne conservatrice est une hypothèse sérieuse, presque naturelle après un cycle de réforme controversée.
Parmi les noms qui circulent, le cardinal guinéen Robert Sarah revient souvent. Défenseur de la messe traditionnelle, il incarne un catholicisme enraciné, sobre, mystique. Le cardinal Raymond Burke, malgré sa mise à l’écart par François, reste une figure influente dans les milieux conservateurs. Le cardinal Matteo Zuppi, plus modéré mais attentif à la tradition, pourrait aussi faire office de compromis.
Quel que soit le choix du conclave, une chose est certaine : l’Église catholique devra trancher entre deux visions du monde. Poursuivre l’ouverture et le dialogue à tout prix, au risque de s’y dissoudre? Ou revenir à une foi affirmée, incarnée, visible, enracinée dans la tradition? Le décès de François marque la fin d’un cycle. Le prochain pape devra, tôt ou tard, répondre à cette question que tant de fidèles portent désormais dans le silence de leur cœur : l’Église peut-elle encore redevenir un roc ?