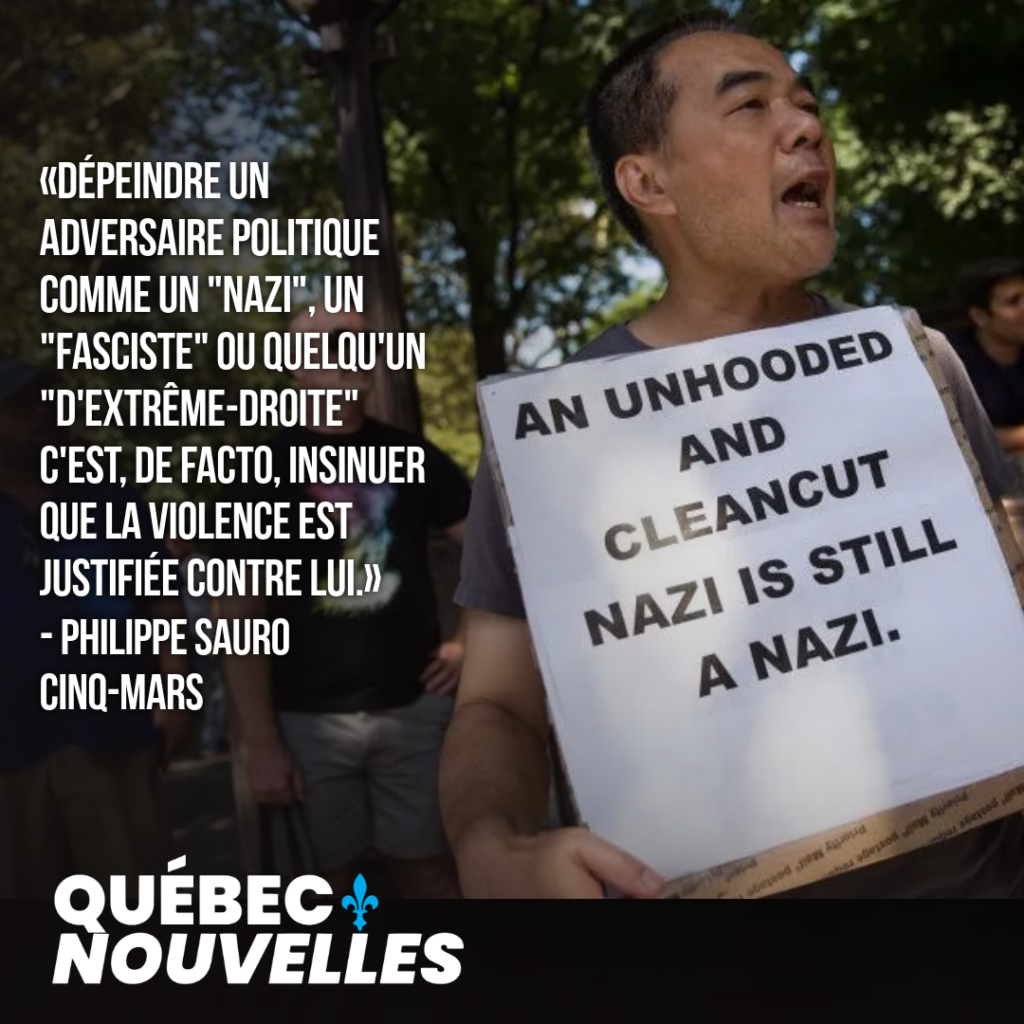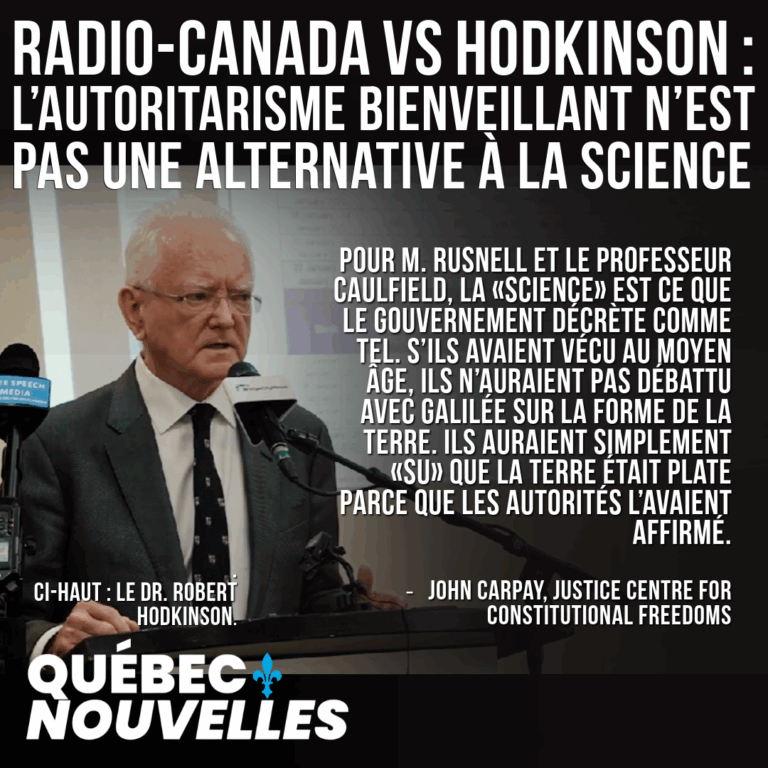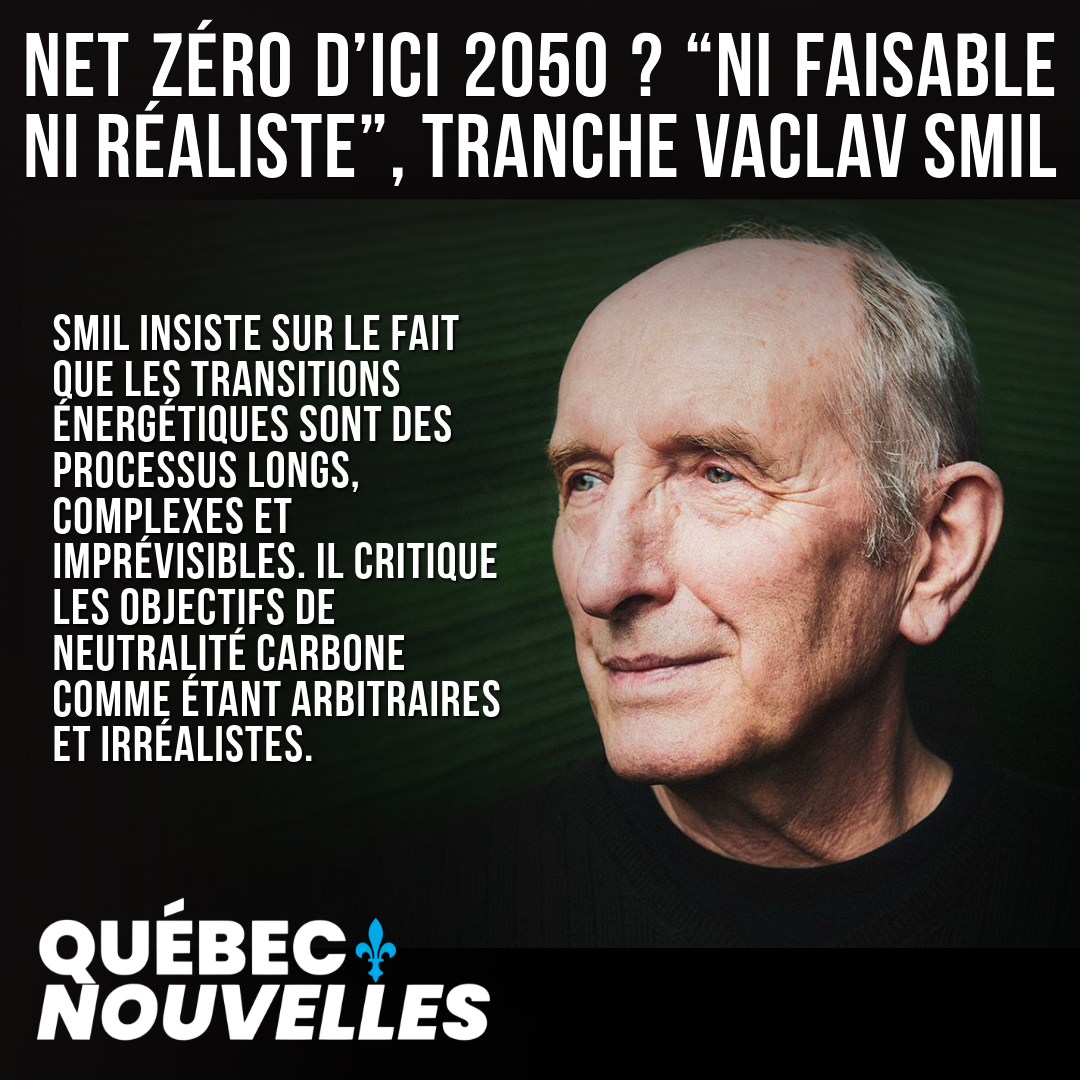Avec la récente tentative d’assassinat contre Donald Trump, le sujet de la violence envers les élus est de retour de ce côté de la frontière. Le ministre fédéral François-Philippe Champagne, notamment, a déclaré qu’il était nécessaire de se pencher sur la sécurité des élus au Canada. La première ministre de l’Alberta, pour sa part, a tenu à rappeler de manière tout à fait justifiée qu’on la présentait constamment, avec Pierre Poilievre, comme « un danger », et que ça n’aidait clairement pas à leur sécurité personnelle. François Legault, pour sa part, a balayé du revers de la main l’idée que ce soit un enjeu au Québec, oubliant au passage l’attentat raté contre Pauline Marois en 2012…
Mais l’analyse qui semble généralisée dans les médias, c’est celle selon laquelle cette violence politique serait le résultat du « ton » utilisé par des politiciens aux « idées toxiques » – Inutile de chercher de midi à quatorze heures pour savoir qu’on fait ici référence à n’importe quelle mouvance de droite qu’on pourrait associer de près ou de loin au style populiste de Donald Trump. Ainsi, d’une manière extrêmement tordue, on tente encore une fois d’attribuer la responsabilité de l’émergence de cette violence à Trump… qui est carrément la victime dans cette situation! On dit que « le ton doit changer » en politique, insinuant que ce sont les attaques personnelles et les « débats toxiques » qui ont mené à cette tentative d’assassinat.
Foutaise. Ce n’est pas « le ton des débats » qui mène à la violence politique actuelle, mais la diabolisation décomplexée de la droite par de soi-disant « experts » qu’on n’ose jamais remettre en question.
Novlangue : quand les mots perdent leur sens.
Les insultes et les tweets méchants de Donald Trump ont définitivement le dos large. On accuse constamment la droite d’intolérance et de « fomenter la haine » en raison de débats difficiles sur l’immigration et une panoplie d’enjeux sociaux que d’aucuns qualifient de « wokes ». Mais on excuse systématiquement le camp adverse et l’establishment médiatique et politique qui, en parallèle, a multiplié des enflures verbales beaucoup plus significatives dans le débat public.
Une caste de soi-disant experts, technocrates, chroniqueurs et militants ont passé les dernières années à changer radicalement la définition des mots les plus lourds de sens en politique. « Fascisme », « extrême-droite », « nazisme », « misogynie », « racisme », « génocide » : en instrumentalisant les théories sociologiques de la déconstruction et en échafaudant tout un tas de théories farfelues sur les micro-agressions ou les « intersections » des marques de domination, on a vidé ces expressions de leur sens originel et normalisé leur usage pour tout un tas de situations tout à fait inappropriées.
Dans bien des cas, la gauche a fait de la normalité une marque de fascisme et de haine…
Ainsi, on parle constamment de fascisme et d’extrême-droite comme si ça faisait partie de notre réalité – et dans un manque flagrant de respect pour ses véritables victimes – alors que nos partis de droite sont à des années lumières de ça. Les expressions font partie du langage courant, et ça a ses conséquences.
« Punch a Nazi »
Si la majorité voit clair dans le jeu de la gauche et se moque de ces théories à coucher dehors, une minorité y adhère de manière fanatique. Selon elle, l’Occident serait en train de tomber dans le fascisme. Littéralement.
De la sorte, il est tout à fait logique que dans leur compréhension des choses, empêcher le retour de Hitler – par tous les moyens – est la chose la plus morale qui soit.
C’est assez simple à comprendre : la civilisation occidentale est demeurée tellement traumatisée par la Deuxième Guerre mondiale, les totalitarismes et l’holocauste que la figure de Hitler a été élevée au même rang que le diable lui-même. Le nazisme, dans l’imaginaire populaire, c’est tout simplement le mal. Et tout est permis contre le mal incarné ; même la violence la plus extrême ; c’est alors considéré comme de la légitime défense.
Ainsi, dépeindre un adversaire politique comme un « nazi », un « fasciste » ou quelqu’un « d’extrême-droite » c’est, de facto, insinuer que la violence est justifiée contre lui.
La gauche n’est pas aussi naïve : elle est très consciente que mobiliser la puissance symbolique du combat contre le nazisme a le potentiel de justifier l’usage de la force. C’est précisément pour cette raison qu’elle utilise ces termes. La gauche a désespérément besoin d’un ennemi diabolisé pour faire avancer ses idées insurrectionnelles ; et diaboliser les riches capitalistes ne suffit plus. Elle a besoin d’un enjeu existentiel pour justifier son propre extrémisme, quitte à inventer de toutes pièces une « montée de l’extrême-droite ».
Et toutes ces années, c’est la rhétorique de gauche qui s’est montrée de plus en plus violente ; celle de la droite n’a pas réellement changé.
Déjà en 2016, un grand débat agitait la toile à savoir s’il était justifié de « frapper un nazi » (punch a nazi). Bien que tout le monde comprends que la chose ne se fait pas dans un État de droit, l’opinion majoritaire était quand même que c’était tout à fait justifié. Cette acceptation de la violence dans cette situation est tellement normalisée, en fait, que même des célébrités ont alors osé encourager les gens à « frapper des gens au visage » pour combattre la montée du trumpisme…
Hitler, à toutes les sauces
Au-delà du fameux point Godwin, Hitler est désormais le meilleur épouvantail (strawman) : il ne suffit que de dépeindre un adversaire comme un nazi pour légitimer toute pression ou violence contre lui. Et malheureusement, aucun pays occidental n’échappe à cette tendance.
Au Québec, quelques mois seulement après un attentat raté contre Pauline Marois, les activistes de gauche partageaient encore des photos de la première ministre apparaissant sous les traits d’Adolf Hitler. Sa Charte des valeurs, qui visait à instaurer la laïcité dans les institutions publiques, était qualifiée de politique raciste digne des régimes fascistes… Ils savaient pertinemment que cette analyse ferait peur aux immigrants au point d’en pousser certains à la radicalisation.
Nos militants de service ont fait la même chose, récemment, suite à l’attentat barbare du Hamas le 7 octobre 2023. Dans les mois suivants, la gauche a martelé qu’un « génocide » était en cours, et que quiconque défendait Israël en était complice. Traduction : supporter Israël fait de vous l’équivalent des nazis qui acceptaient les camps de la mort, et donc, quelqu’un qui mérite de mourir.
En France, on parle du Rassemblement National comme du retour du fascisme et de « l’extrême-droite » ; on compare l’éventuelle élection du parti à un retour de la France de Vichy. Même concept ; on fait de cette mouvance politique très populaire une cible à abattre.
Même chose pour Trump.
Bref, chers médias, analystes et experts, que pensez-vous qui a le plus de potentiel de violence : parler sans filtre de sujets difficiles et parfois de manière choquante, ou bien faire croire de manière malicieuse à une population entière que le fléau Hitlérien, contre lequel des millions ont sacrifié leurs vies par le passé, est de retour?