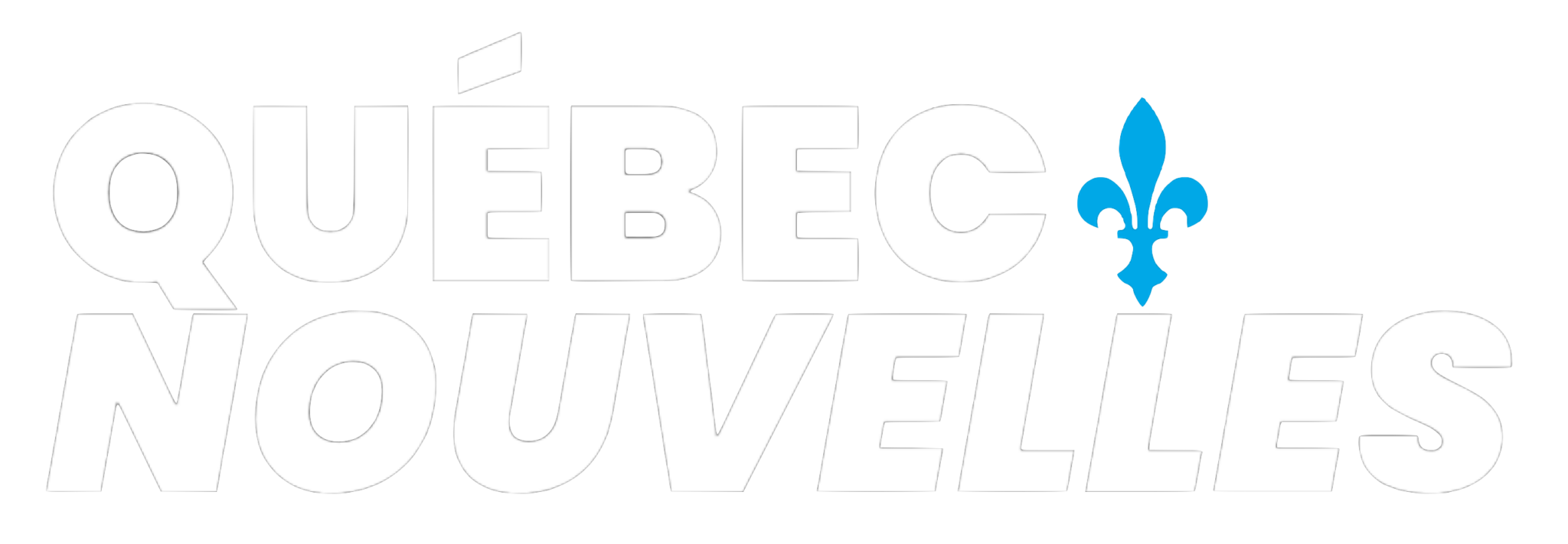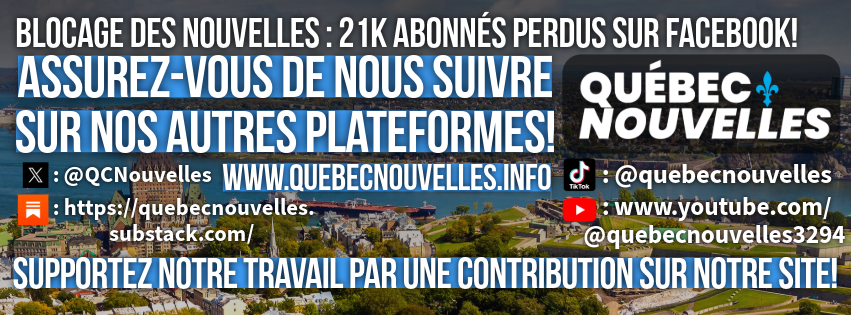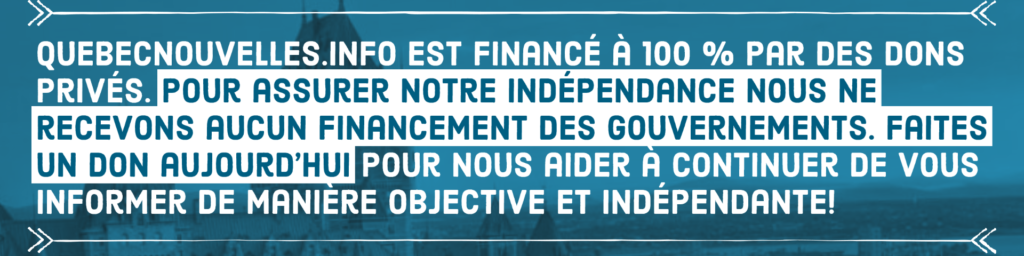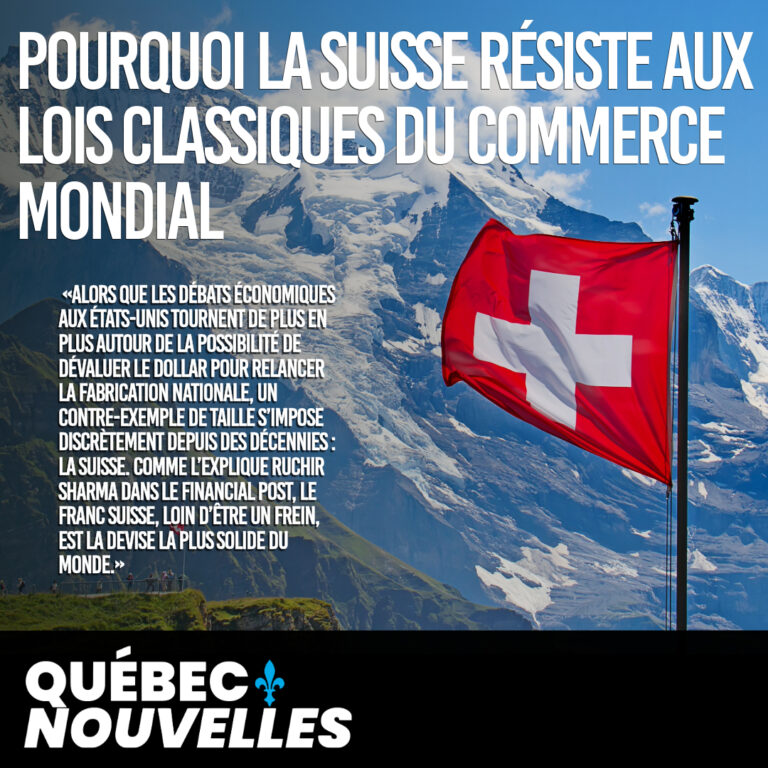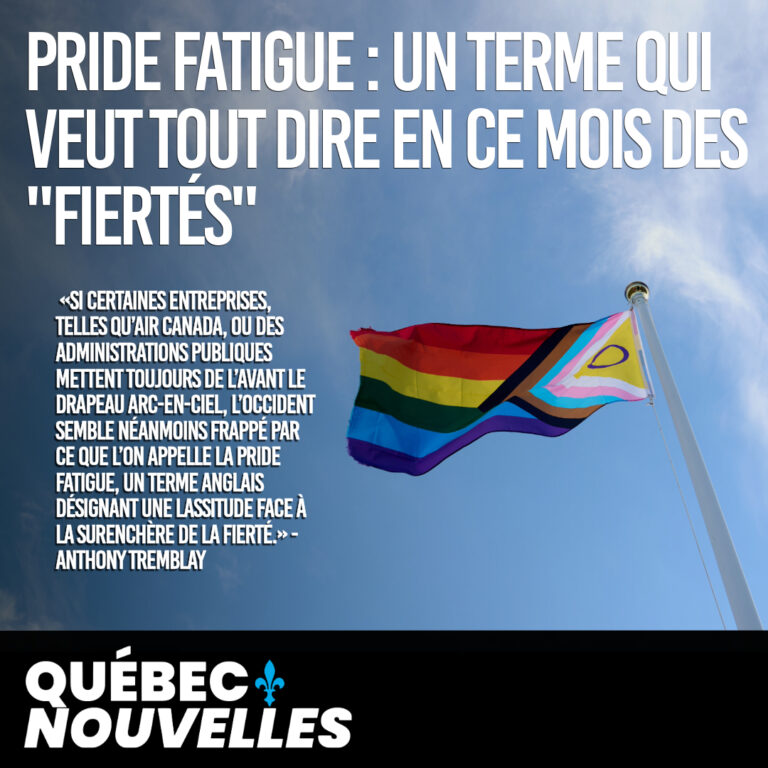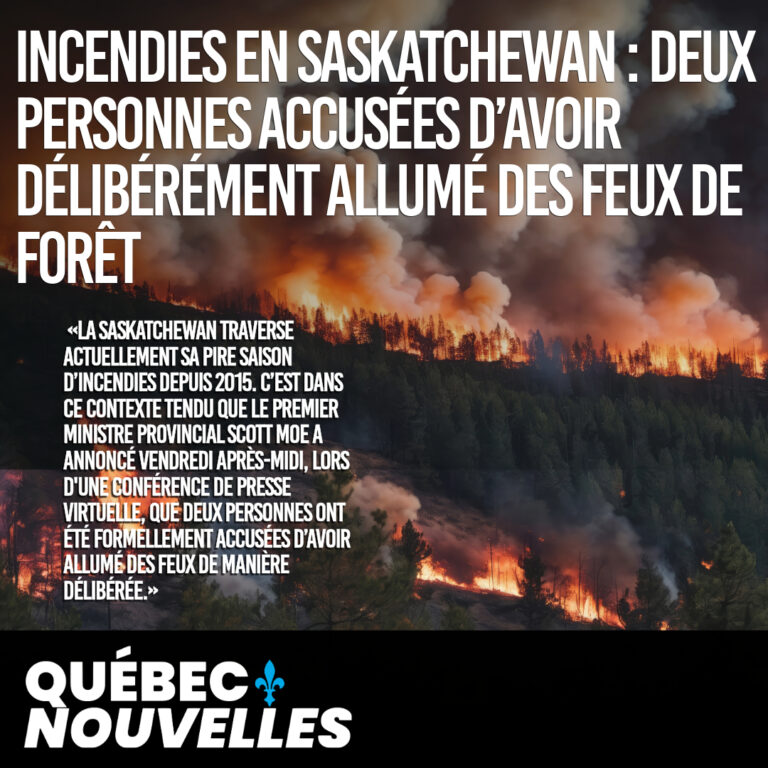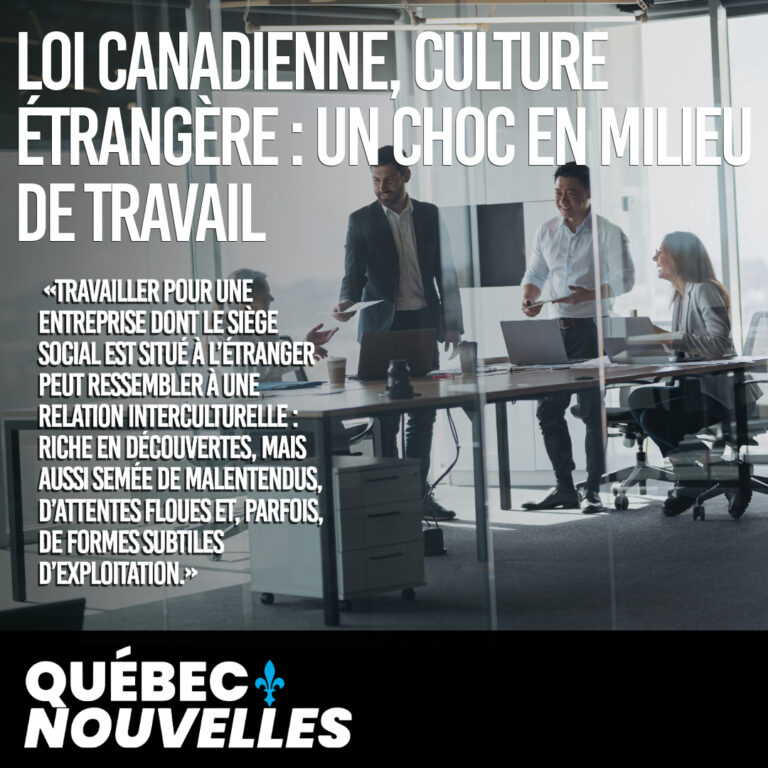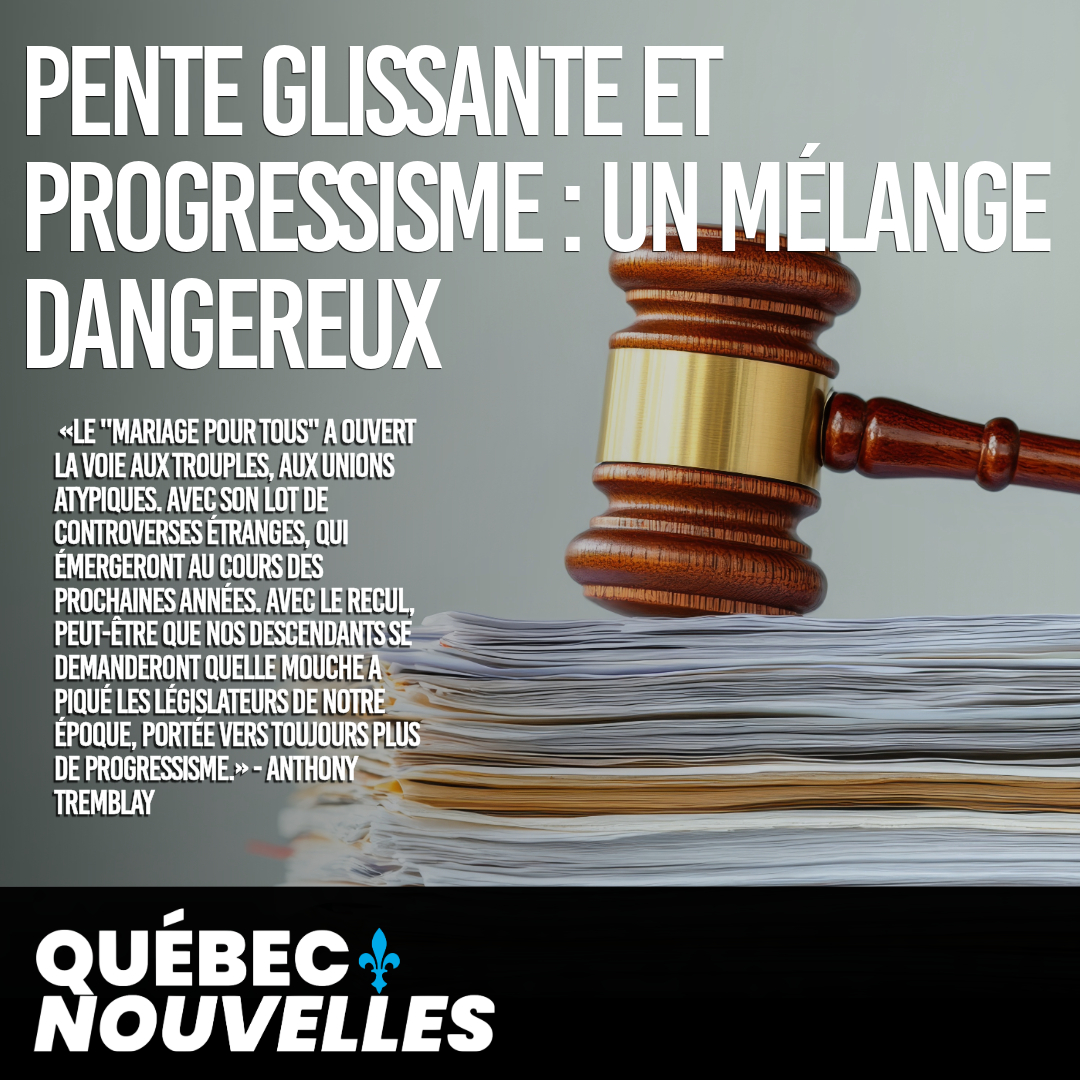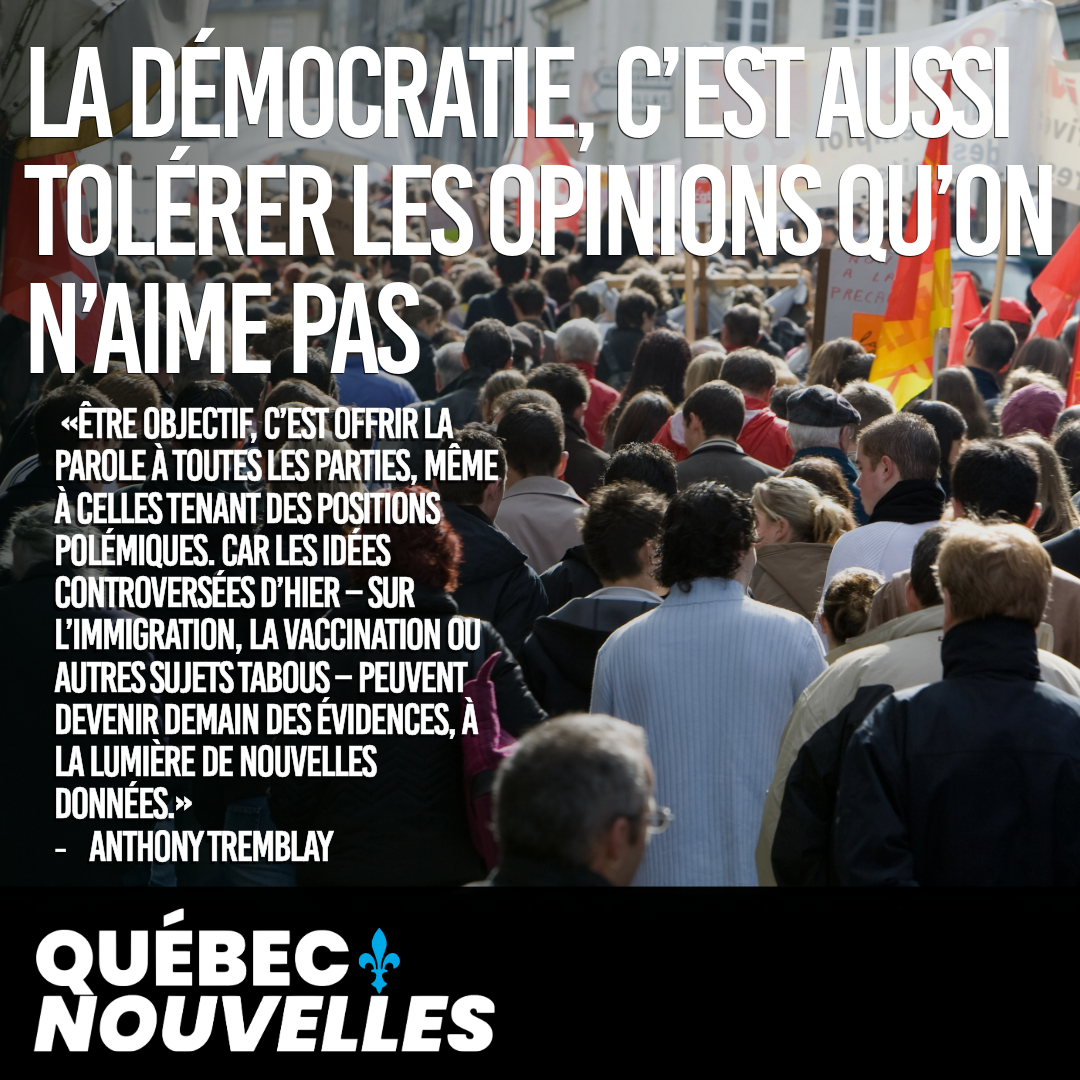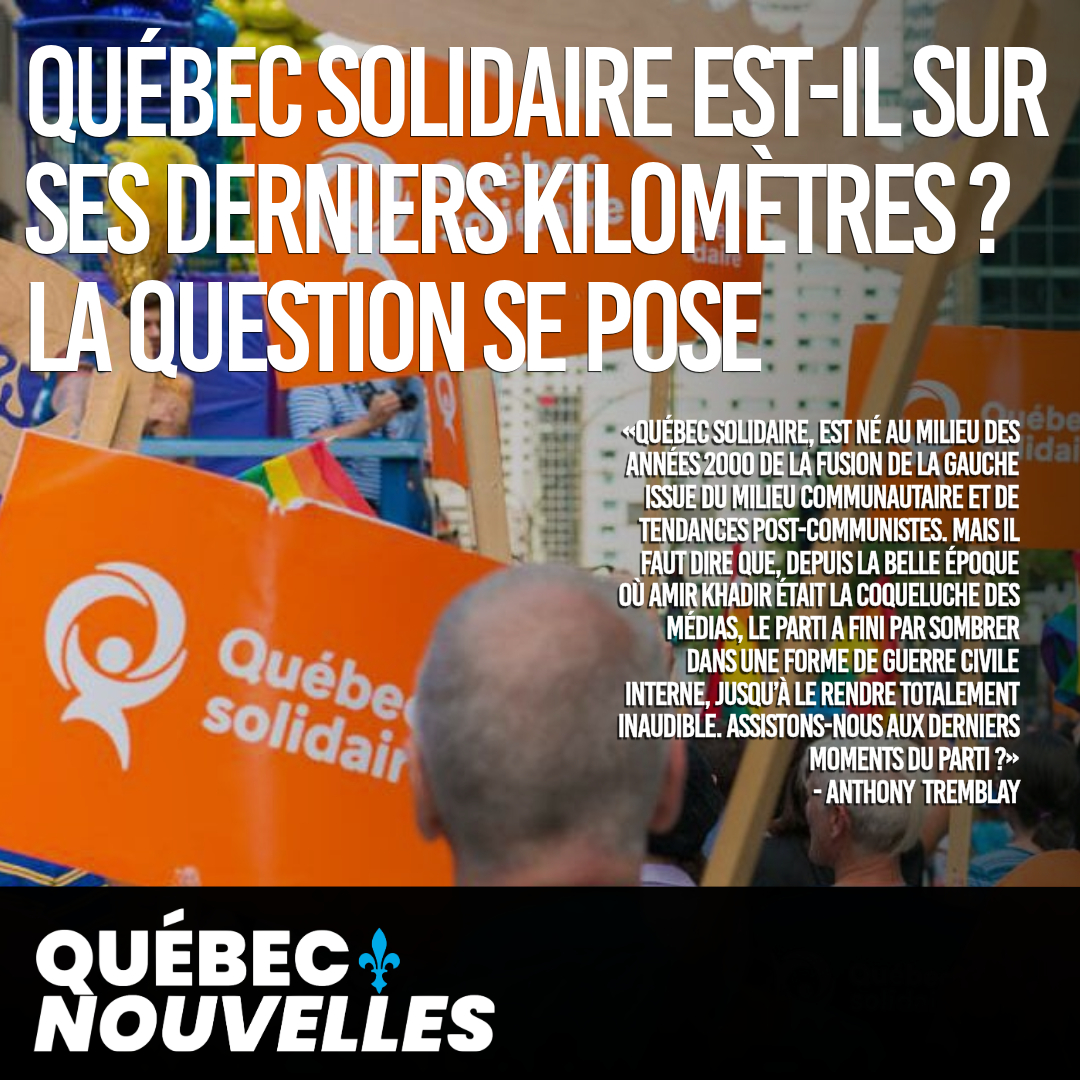Le déclin du wokisme n’étonne personne. Qui peut encore éprouver de la sympathie pour des militants toujours plus criards, dogmatiques et omniprésents dans nos institutions culturelles ? Après avoir imposé leur vision à coups de censures et de réécritures historiques, voilà qu’ils se retrouvent face à un rejet grandissant. C’est une opportunité que les nationalistes et les conservateurs doivent saisir s’ils veulent inscrire durablement leurs idées dans l’espace public.
Dans le camp conservateur, il est courant de critiquer Radio-Canada, souvent perçu comme un bastion de la gauche idéologique. Pourtant, cette institution publique appartient à tous et ne doit pas être laissée entre les mains d’un seul courant de pensée. Avec l’érosion des cotes d’écoute et la disparition d’émissions phares comme À la semaine prochaine, le terrain est plus propice que jamais pour une reconquête médiatique.
Parallèlement, il est crucial de développer des alternatives médiatiques solides. QUB Radio a amorcé un virage intéressant en s’implantant sur les ondes du 99,5 à Montréal. En France, l’empire Bolloré illustre bien cette dynamique : acquisition de maisons d’édition, expansion dans la radio, et surtout, transformation de CNews en la chaîne d’information la plus suivie du pays. Ces stratégies doivent inspirer une droite québécoise et canadienne qui cherche encore son modèle en matière de communication culturelle.
L’importance de la bataille culturelle n’est pas une idée nouvelle. Antonio Gramsci, théoricien communiste du XXe siècle, l’avait bien compris en développant le concept d’hégémonie culturelle. Il expliquait que pour imposer un projet politique, il faut d’abord s’emparer des institutions culturelles : médias, écoles, universités, salles de spectacle. Une fois ces leviers sous contrôle, on pourra convaincre plus facilement. Et offrir autre chose qu’un narratif victimaire de déconstruction.
C’est exactement ce qui s’est produit au fil des décennies. La gauche, après l’échec du marxisme classique, a déplacé son combat vers d’autres terrains. Abandonnant la classe ouvrière, jugée trop « réactionnaire », elle a concentré ses efforts sur les minorités identitaires : immigration, genre, féminisme radical. La lutte des classes a été remplacée par la lutte contre un système de domination présumé, où l’homme blanc hétérosexuel occuperait la place du « bourreau ».
Cette transformation idéologique s’est accompagnée d’une mainmise sur l’éducation, les médias et les institutions culturelles. Québec Solidaire exerce aujourd’hui une influence notable sur les campus universitaires. Radio-Canada, avec son impressionnante machine médiatique – télévision, radio, site internet – demeure un puissant outil de diffusion idéologique. Face à cette réalité, les conservateurs et les nationalistes ne peuvent plus se contenter de critiquer : ils doivent se réapproprier ces espaces.
Un premier pas serait d’exiger plus d’objectivité dans la couverture médiatique des sujets sociaux, notamment à Radio-Canada. Pourquoi ne pas imposer une diversité idéologique parmi les animateurs et chroniqueurs ? Un Stéphan Bureau, par exemple, incarnerait parfaitement une voix dissidente et crédible au sein de cette institution.
Mais au-delà des médias, il faut reprendre les universités. L’enseignement de l’histoire du Québec a été dilué au fil du temps, alors qu’il reste encore tant à explorer sur notre passé, notre anthropologie, notre géographie, notre patrimoine musical et artistique. Le Québec n’a pas à calquer ses programmes universitaires sur les préoccupations américaines pour exister.
Notre culture est suffisamment riche pour justifier l’existence de facultés entièrement dédiées à son étude et à sa transmission. Mais pour cela, il faut que les conservateurs et les nationalistes prennent part activement à la production culturelle, plutôt que de la laisser à une gauche qui ne tolère plus la contradiction.
L’enjeu n’est pas d’exclure la gauche, mais de l’obliger à reconnaître la légitimité de notre existence. Car il ne faut pas l’oublier : au Québec comme au Canada, les partis bleus dominent électoralement. Le mépris médiatique et institutionnel ne pourra pas durer éternellement.
La gauche culturelle veut-elle vraiment attendre d’être balayée par une purge brutale, comme on l’observe déjà aux États-Unis avec des licenciements massifs ? Au Québec, nous n’en sommes pas encore là. Mais il est temps qu’elle entame son introspection.
Faute de quoi, elle finira par être effacée de l’histoire comme un mauvais souvenir.