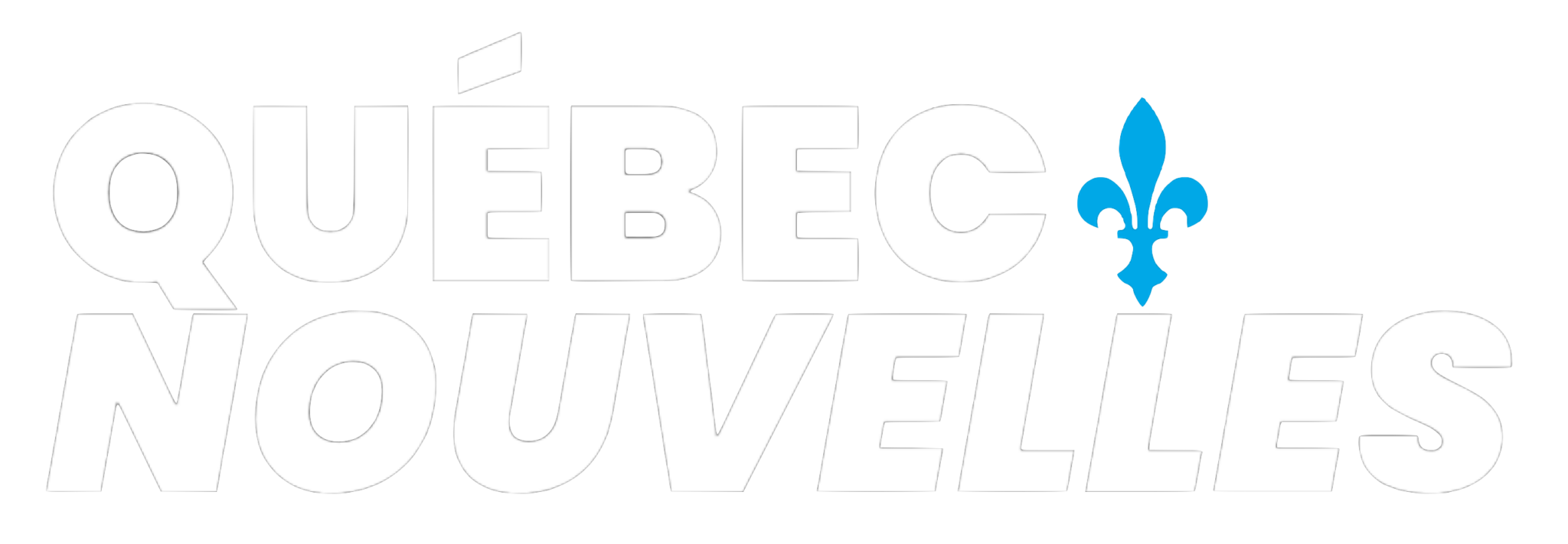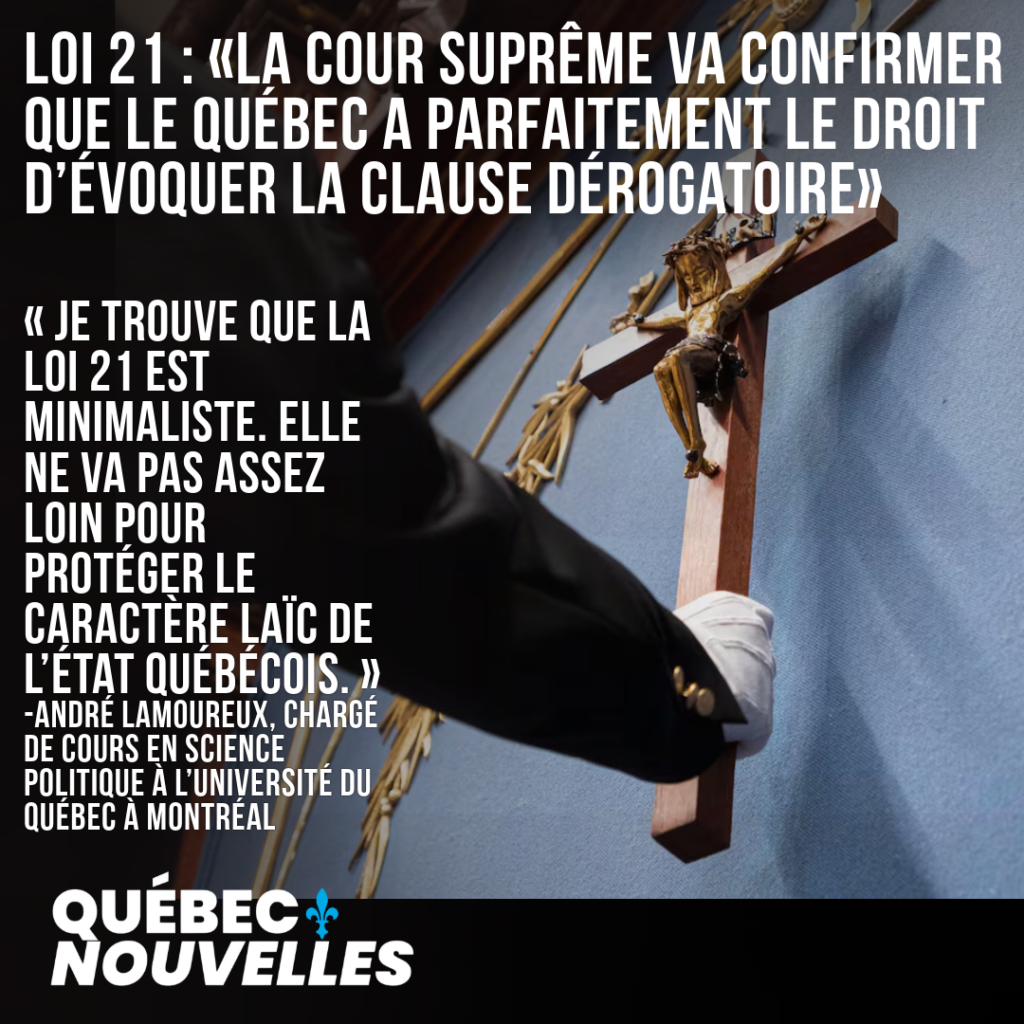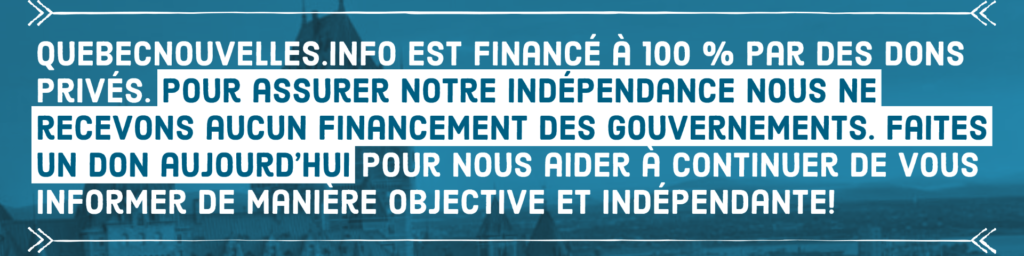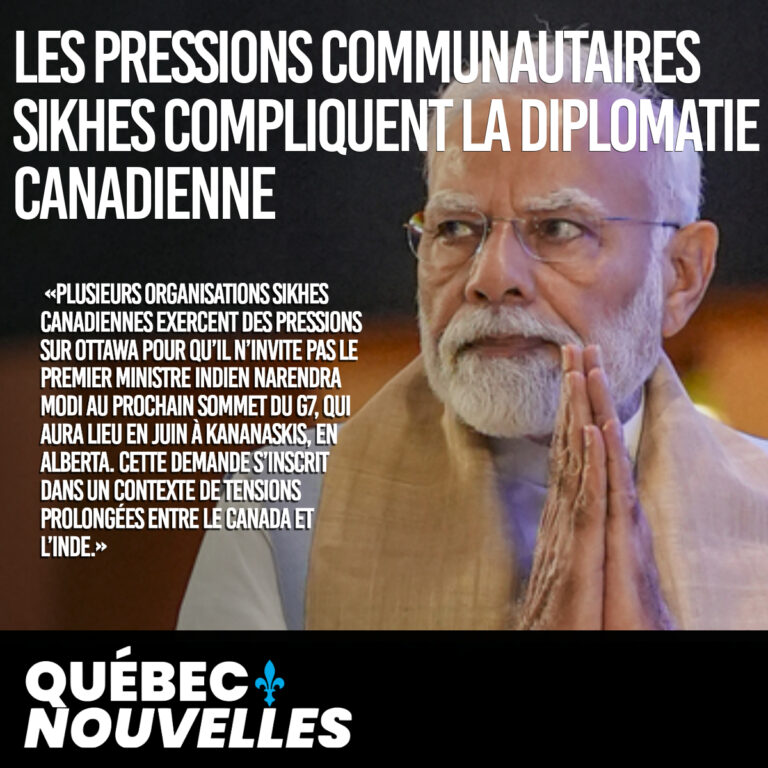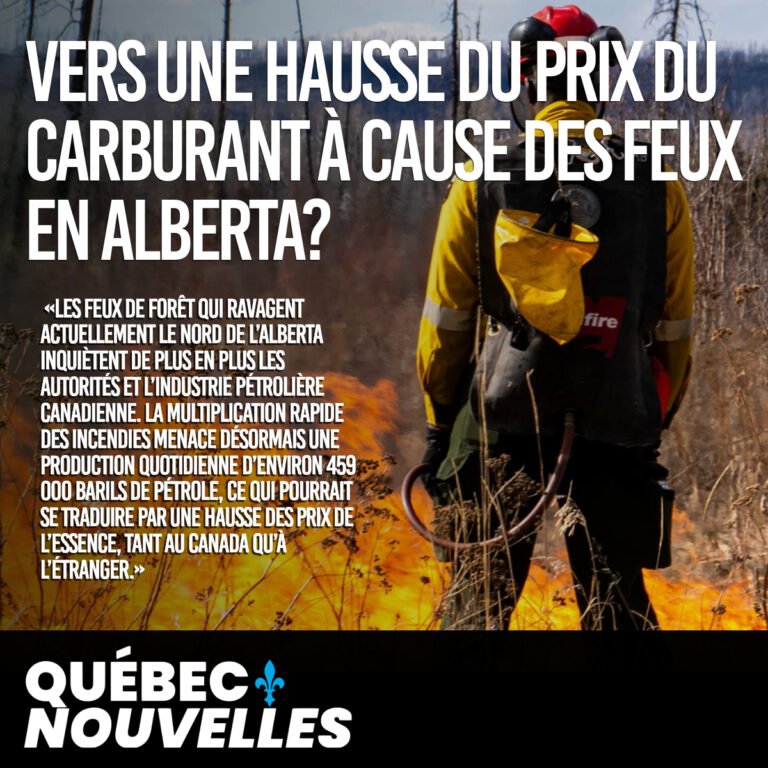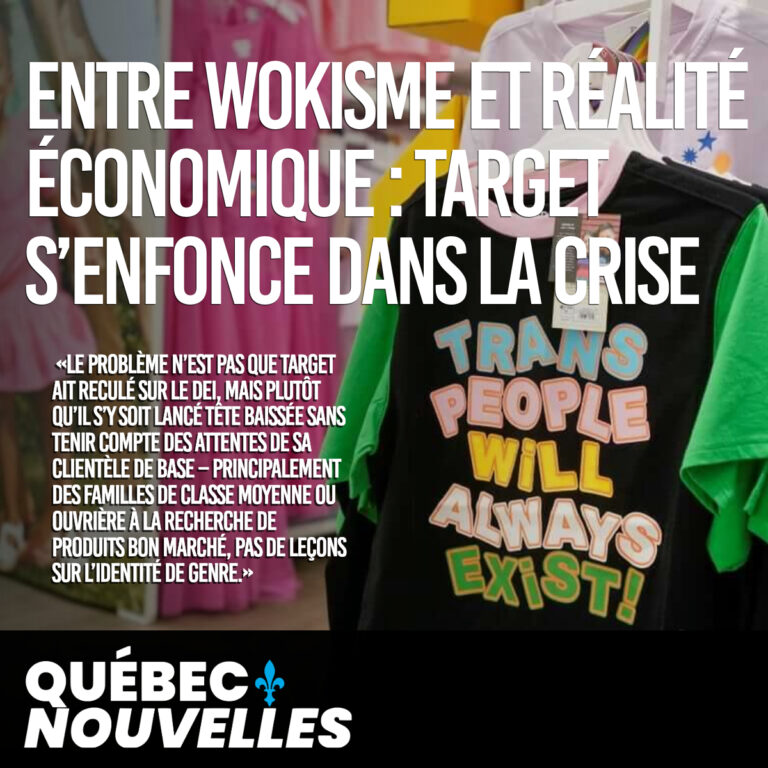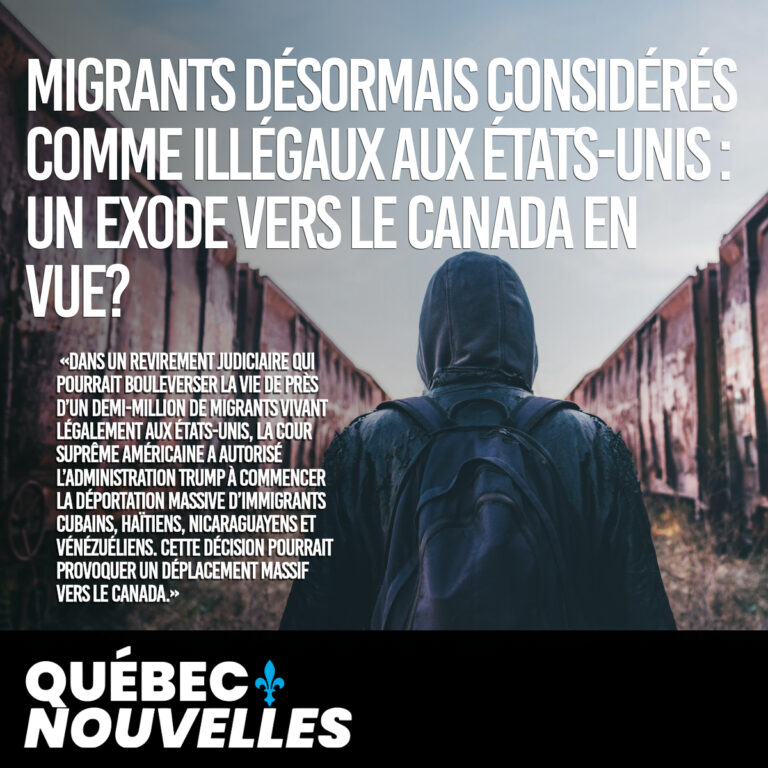Lors de son premier mandat, le gouvernement Legault a fait adopter la loi 21 afin d’assurer la neutralité de l’État. Cette législation interdit le port de signes religieux pour les travailleurs de l’État qui sont en position d’autorité. Il y a des organismes, comme le Conseil canadien des musulmans, qui ont contesté la loi depuis le début. Alors, Québec a utilisé la clause dérogatoire pour protéger la loi 21 contre les disputes devant les tribunaux. La cause est rendue devant la Cour suprême. André Lamoureux estime que cette dernière va confirmer que Québec a le droit d’utiliser la clause nonobstant dans le dossier car elle fait partie de la constitution canadienne.
André Lamoureux est chargé de cours en science politique à l’Université du Québec à Montréal et observateur des scènes politiques québécoise et canadienne.
Simon Leduc : La loi 21 sur la laïcité de l’État québécois sera débattue par la Cour suprême. Que pensez-vous de cela?
André Lamoureux : «C’est légitime que la plus haute cour du pays puisse entendre la cause de ceux qui s’opposent à cette législation. Il faut savoir que la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel ont dit clairement que le Québec a le droit de recourir à la clause dérogatoire parce qu’elle fait partie de la constitution canadienne. Dans le cas de la loi 21, Québec n’a pas besoin de justification pour suspendre l’application de la liberté d’expression (article 2 de la constitution) et la non-discrimination pour motif de croyance (article 15). Tous les constitutionnalistes reconnaissent le fait que la loi 21 peut être protégée avec la clause dérogatoire. Mais, le Conseil national des musulmans et la Commission scolaire English Montréal ne reconnaissent pas cela. Ils contestent cette loi en Cour suprême.»
Selon vous, quelle décision la Cour suprême va-t-elle prendre dans ce dossier?
André Lamoureux : «Je pense qu’elle va confirmer que le Québec a parfaitement le droit d’évoquer la clause dérogatoire pour protéger la loi 21 sur la laïcité de l’État. Une forte majorité de Québécois soutien le principe de la laïcité et Québec avait le droit de légiférer en la matière.
Par contre, peut-être que les juges vont juger inconstitutionnelle le fait d’interdire au président et vice-président de l’Assemblée nationale de porter des signes religieux au Parlement. Si ce scénario se concrétise, Québec pourrait changer sa loi sur l’Assemblée nationale pour que la laïcité de l’État s’applique aux élus du peuple. Après cela, les adversaires à la loi 21 pourront tenter de la désavouer en Cour suprême.»
Le gouvernement du Québec devrait-il modifier la loi 21 afin de l’élargir le principe de la laïcité dans les institutions étatiques?
André Lamoureux : «Il faut que la laïcité s’applique à l’Assemblée nationale. Québec doit modifier sa législation pour que tous les députés ne puissent pas porter de signes religieux lorsqu’ils siègent au Parlement de Québec. Ce principe fondamental de l’identité québécoise doit être respecté par les députés. Il faut savoir que la Cour suprême ne pourrait pas contredire cette décision. Elle a elle-même accepté la décision de l’Assemblée nationale de ne pas permettre que des Sikhs puissent rentrer au Parlement avec leurs couteaux. Les juges de la Cour suprême ont dit que l’Assemblée nationale est maître de ses propres règles et qu’elle pouvait prendre des décisions en ce sens.
Pour conclure, je trouve que la loi 21 est minimaliste. Elle ne va pas assez loin pour protéger le caractère laïc de l’État québécois. Le gouvernement du Québec doit élargir la loi 21. Je pense qu’elle devrait s’appliquer dans les cégeps. L’interdiction du port de signes religieux doit toucher aussi les professeurs du collégial. C’est un élément fondamental et c’est une carence de la loi 21.»