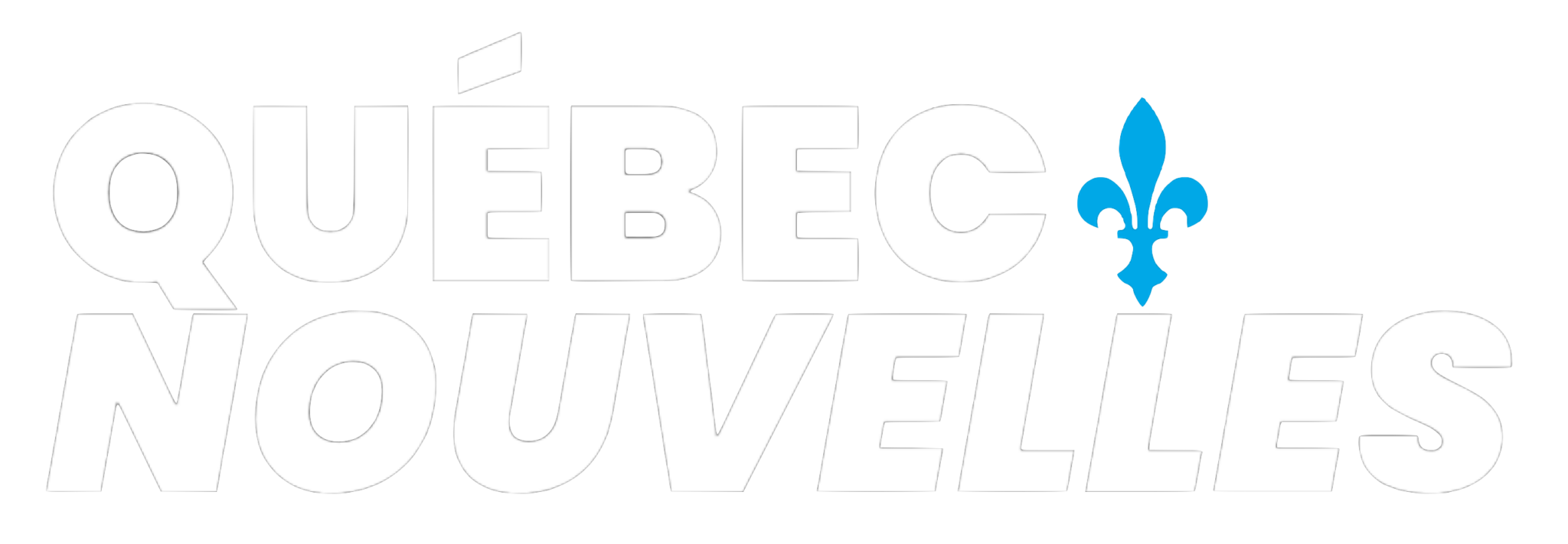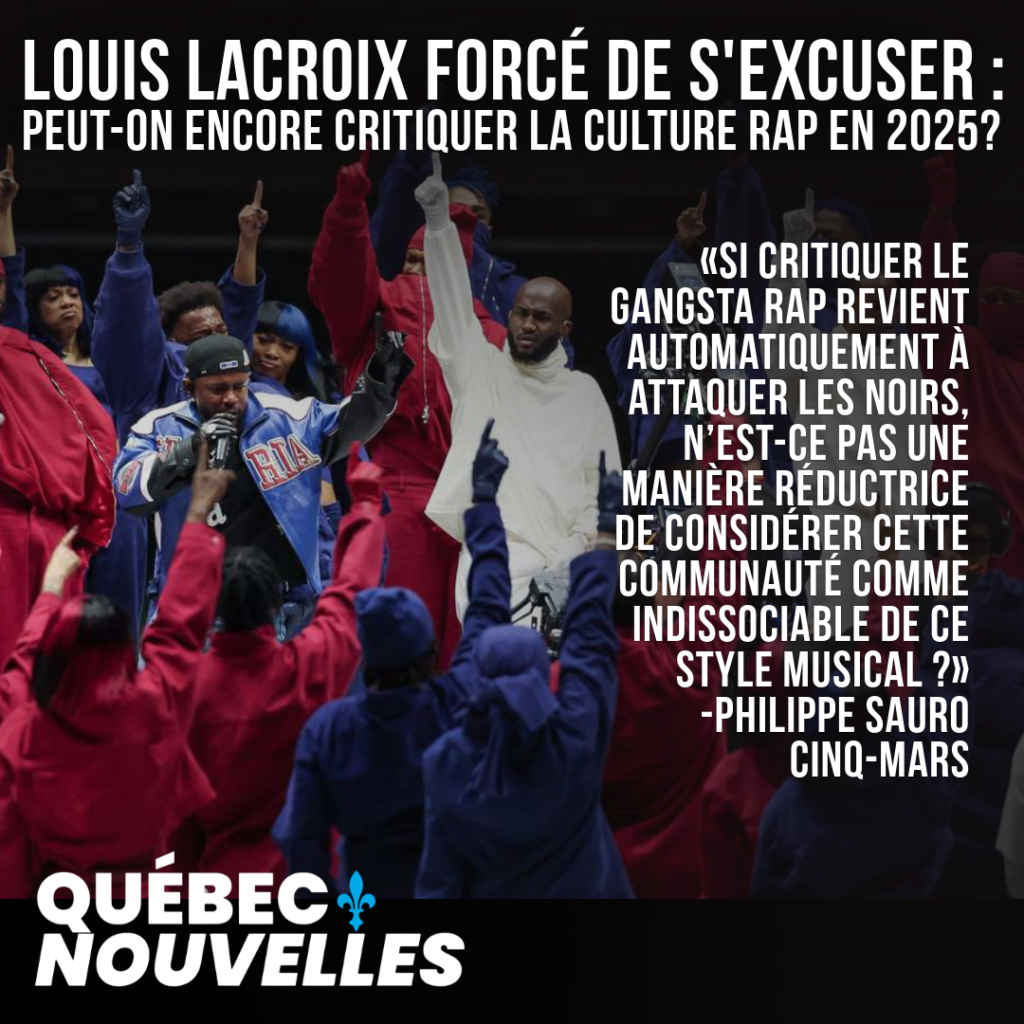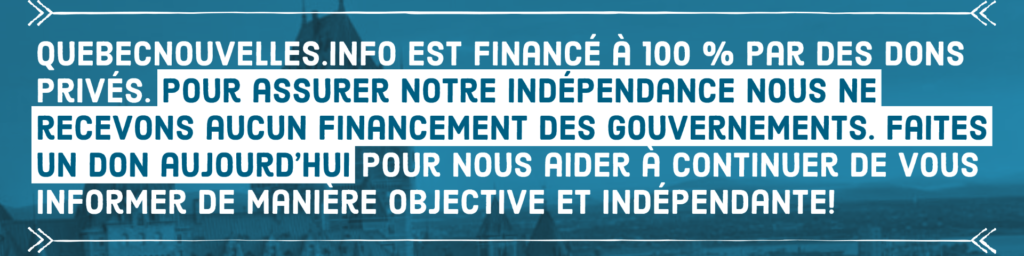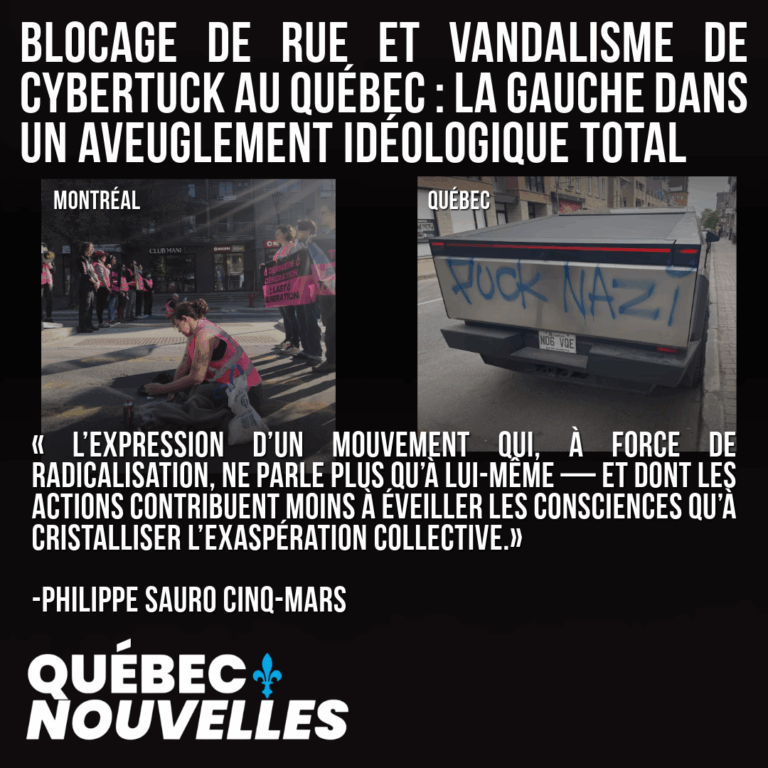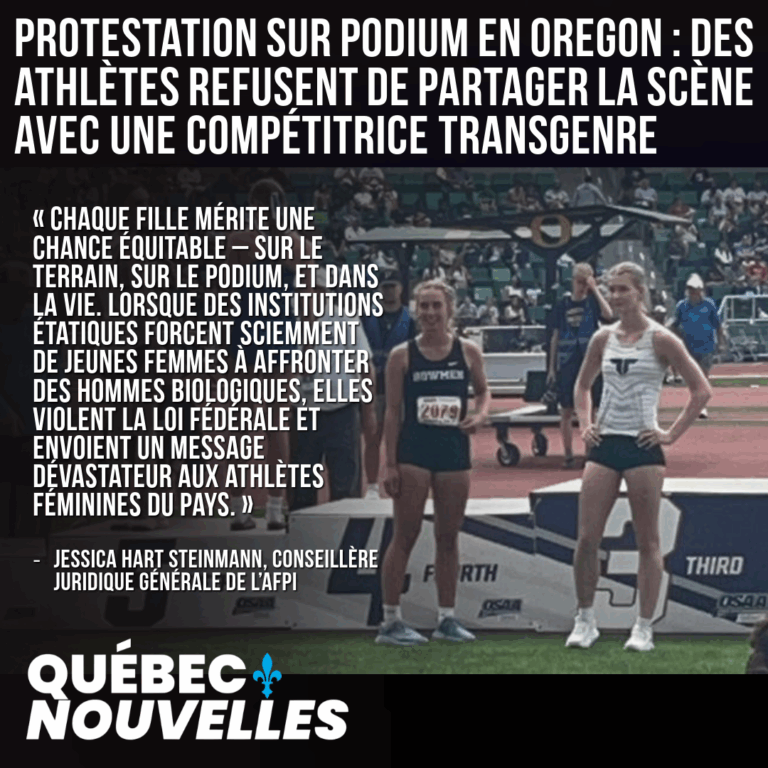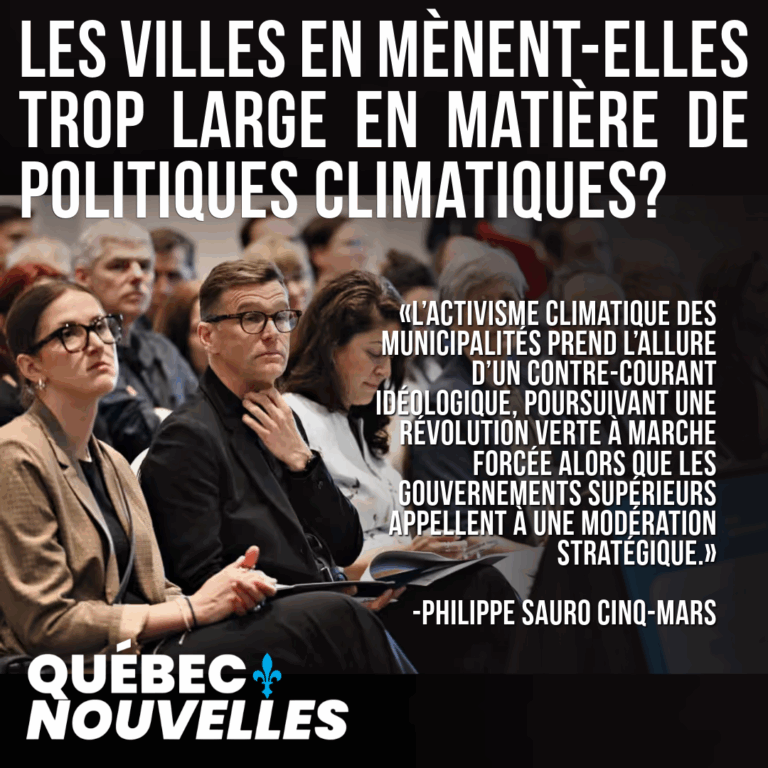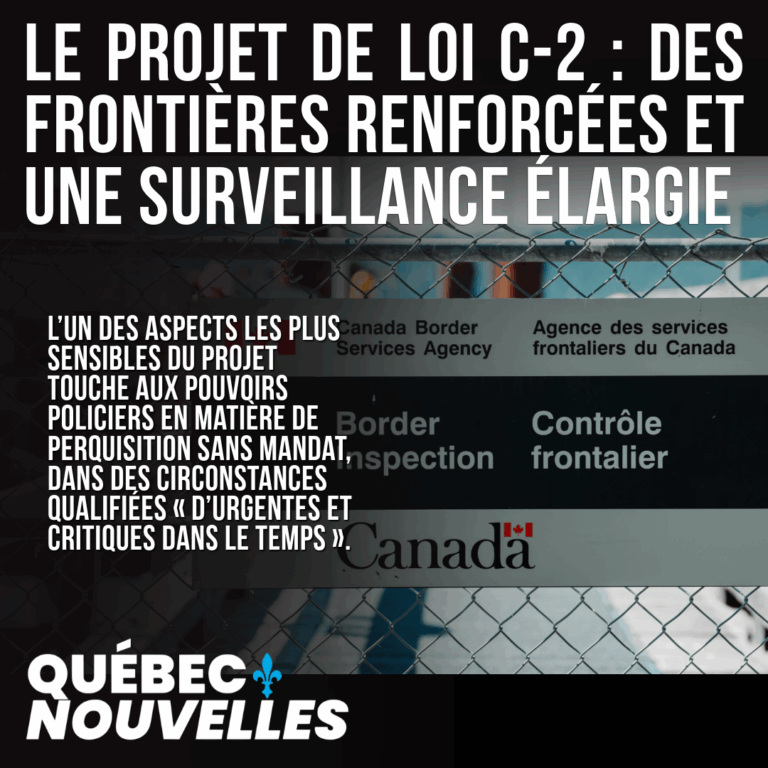Dimanche dernier, alors qu’il regardait le Super Bowl, le correspondant parlementaire pour Cogeco et animateur au 98.5, Louis Lacroix, a publié une blague sur Facebook qui a rapidement suscité la controverse. Il déclarait sarcastiquement : « [J’écoutais] le football, tranquille, pis tout d’un coup des gangs de rue ont pris le contrôle de [ma] télé. » Ce commentaire, publié lors du spectacle de la mi-temps animé par Kendrick Lamar, a été perçu par certains comme une marque de racisme, étant donné que le rap est souvent associé à la culture afro-américaine.
Or, la question se pose : est-il réellement raciste de critiquer le rap ? Ou bien est-ce ceux qui dénoncent Lacroix qui font eux-mêmes une association automatique entre ce style musical et une appartenance ethnique spécifique ?
Une controverse inutile
Face à la polémique, Louis Lacroix a rapidement supprimé son tweet et présenté des excuses publiques, déclarant qu’il regrettait ses propos. Cependant, cela n’a pas suffi à calmer l’indignation. De nombreuses personnalités québécoises, comme l’ancien joueur de hockey Georges Laraque et d’autres figures médiatiques, ont réclamé des mesures fortes contre lui, appelant à des sanctions professionnelles ou à une remise en question de son rôle de journaliste.
Mais cette indignation est-elle justifiée ? Lacroix a critiqué un spectacle qu’il percevait comme une glorification du gangsta rap, un sous-genre du hip-hop historiquement lié à la criminalité et aux gangs de rue. À aucun moment, il n’a fait mention de la race des artistes ou du public. Ce sont ses détracteurs qui ont immédiatement associé sa critique à un rejet de la communauté afro-américaine dans son ensemble. Ce raisonnement ne pose-t-il pas un problème en soi ? Si critiquer le gangsta rap revient automatiquement à attaquer les Noirs, n’est-ce pas une manière réductrice de considérer cette communauté comme indissociable de ce style musical, ou pire, du gangstérisme?
Le rap et son lien historique avec la criminalité
Depuis ses débuts, le rap, et en particulier le gangsta rap, entretient une relation complexe avec la criminalité. Dès les années 1980, des artistes comme N.W.A. (« Niggaz Wit Attitudes ») ont popularisé un discours brut sur la réalité des ghettos américains, dénonçant les violences policières, mais aussi glorifiant parfois le mode de vie des gangs. Des titres comme Straight Outta Compton ont marqué une génération, mais ont aussi contribué à ancrer une image où la violence et la rue deviennent des éléments esthétiques et thématiques dominants du genre.
De nombreux rappeurs ont eux-mêmes entretenu des liens avec le crime organisé. Suge Knight, fondateur du label Death Row Records, a été impliqué dans plusieurs affaires de violence et est actuellement en prison pour homicide volontaire. Puff Daddy (Sean Combs), malgré son succès commercial, a été impliqué dans des affaires judiciaires liées à des agressions et des trafics. Ces exemples illustrent comment l’industrie du rap, devenue une machine commerciale massive, n’a jamais complètement rompu avec son ancrage dans une culture parfois criminelle.
Une culture normalisée et glorifiée
Dans les années 1990 et 2000, le rap a été largement accepté et célébré par la culture dominante. Il est passé d’un genre underground contestataire à une forme d’expression vénérée, parfois perçue comme une poésie urbaine permettant aux jeunes des quartiers défavorisés de s’élever socialement. Des figures comme Tupac Shakur ou Jay-Z ont symbolisé cette transition, mêlant engagement politique et succès financier.
Cependant, cette popularité croissante a aussi eu des effets pervers. La glorification du gangstérisme, du proxénétisme et de la violence dans les clips et les paroles est devenue omniprésente. Certains rappeurs, même après avoir acquis une immense richesse, continuent de promouvoir un style de vie dangereux, influençant de jeunes générations qui assimilent ce discours à un idéal de réussite. Cette réalité est particulièrement visible en France et au Canada, où la montée du « rap de rue » met en avant des artistes dont les textes normalisent la criminalité et la misogynie.
Quelle place pour le rap en 2025 ?
En 2025, alors que le rap est devenu un phénomène mondial, chanté sur tous les continents et dominant les classements musicaux, peut-on encore le considérer comme un joyau culturel fragile nécessitant d’être protégé ? N’est-il pas temps d’avoir une discussion honnête sur ce que cette industrie promeut réellement ?
Il est légitime de se demander si des événements grand public comme le Super Bowl doivent offrir une tribune à un style musical qui, malgré ses qualités artistiques indéniables, porte aussi en lui des messages de violence, de domination et d’exploitation des femmes. Peut-on encore, sous prétexte de diversité et de représentativité, fermer les yeux sur ces problématiques ?
Finalement, l’affaire Louis Lacroix révèle un malaise plus large : la difficulté à critiquer un aspect d’une culture sans être accusé de racisme. Pourtant, il est essentiel de pouvoir questionner les messages que nous diffusons et célébrons collectivement, sans crainte des représailles idéologiques.