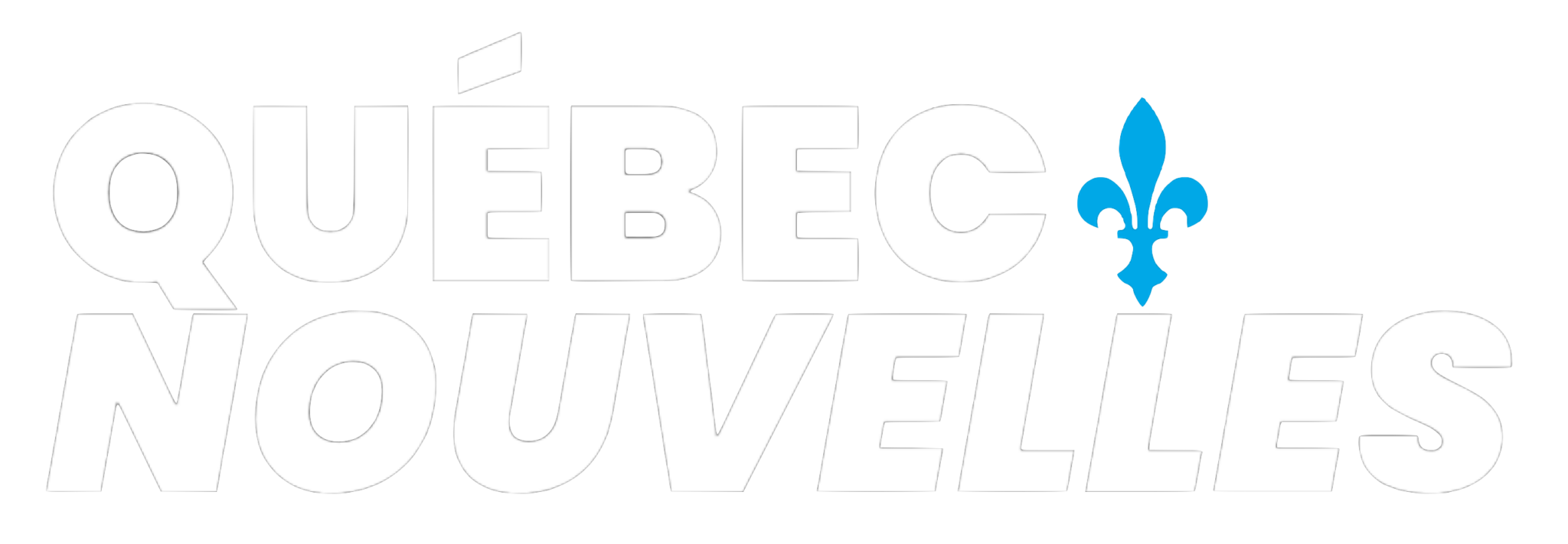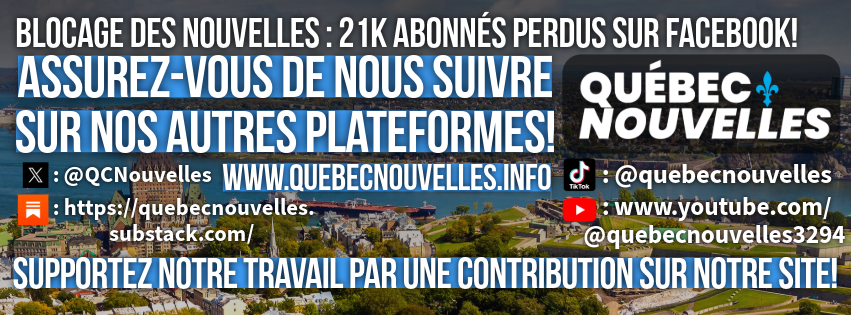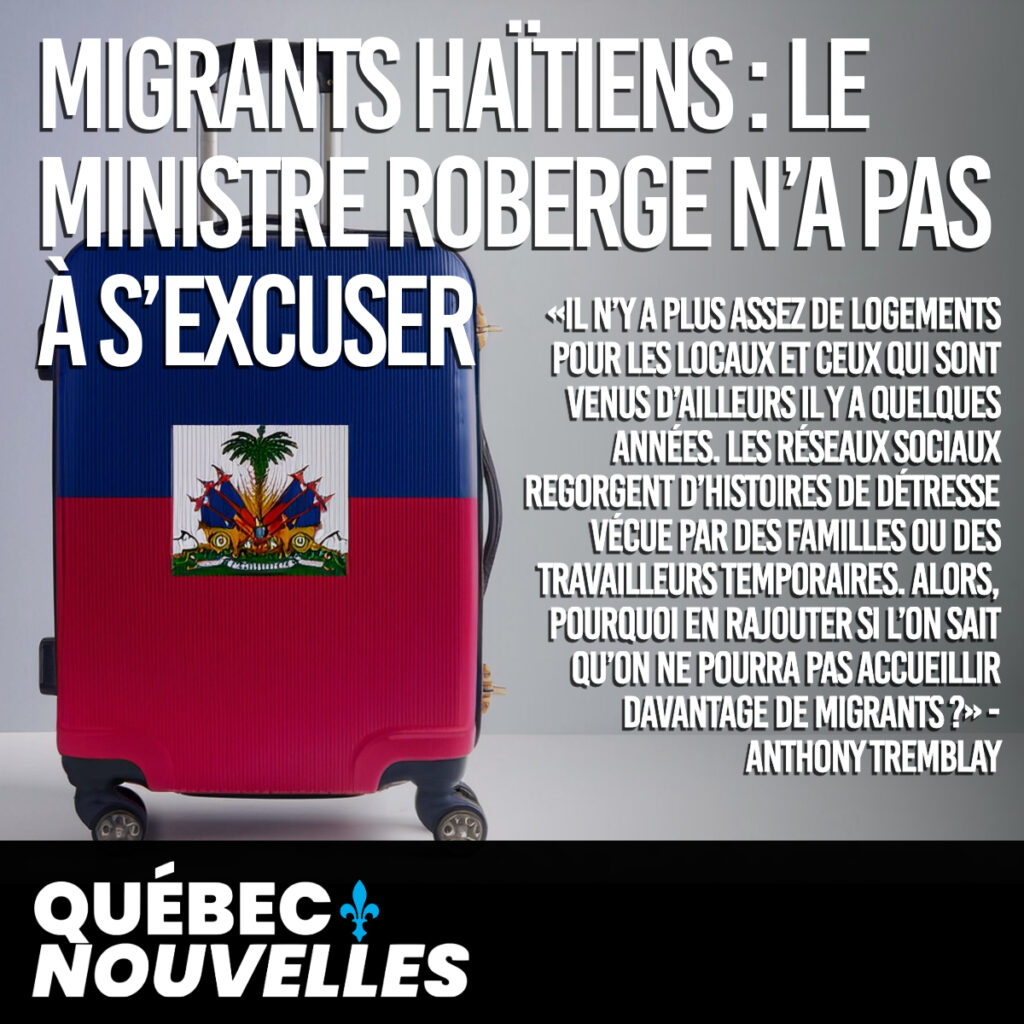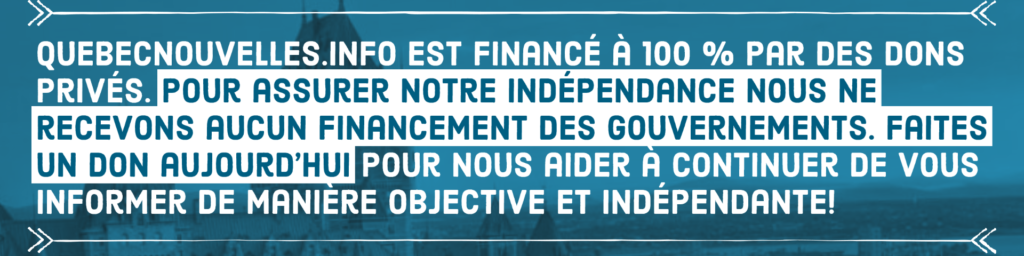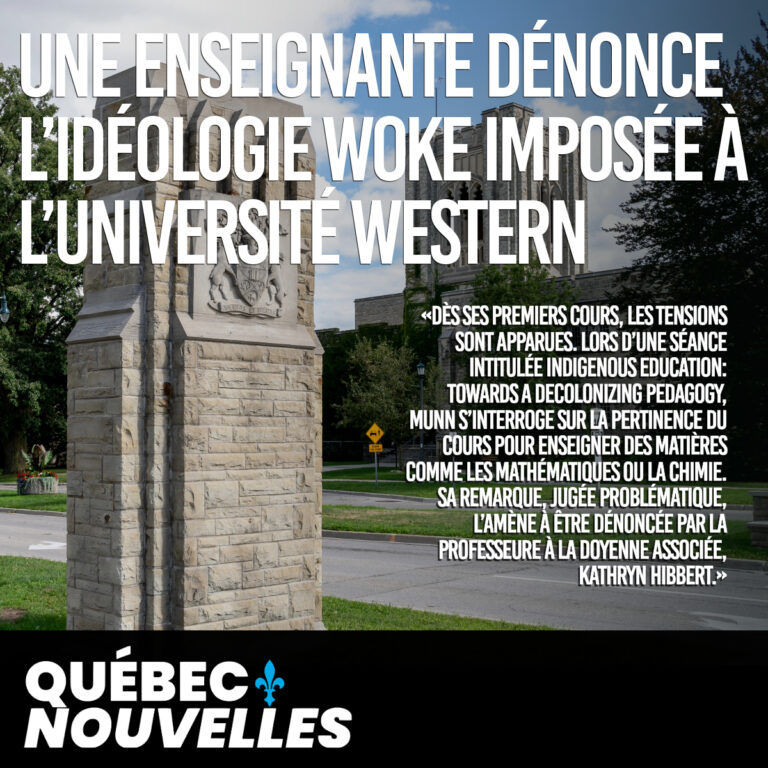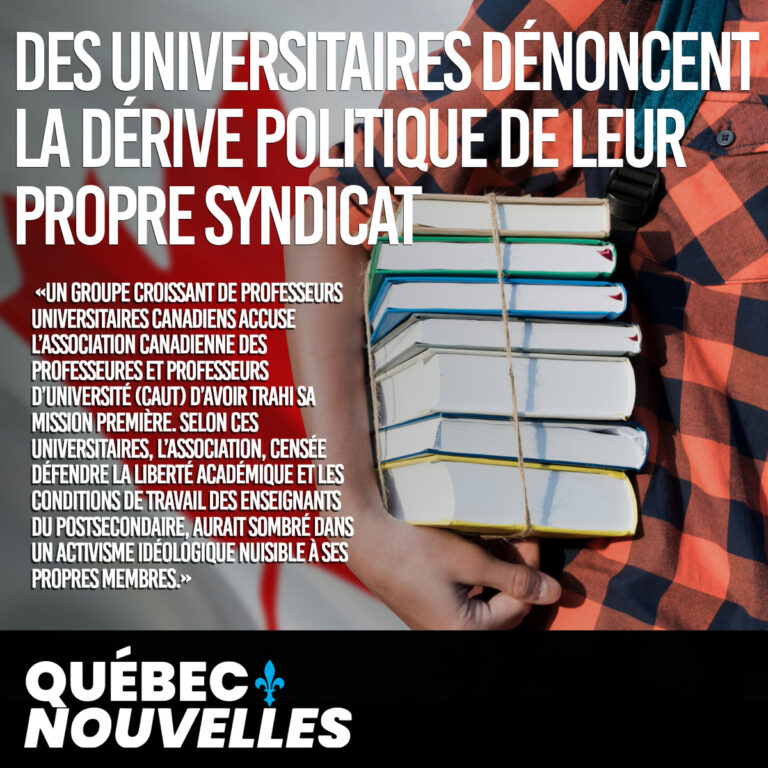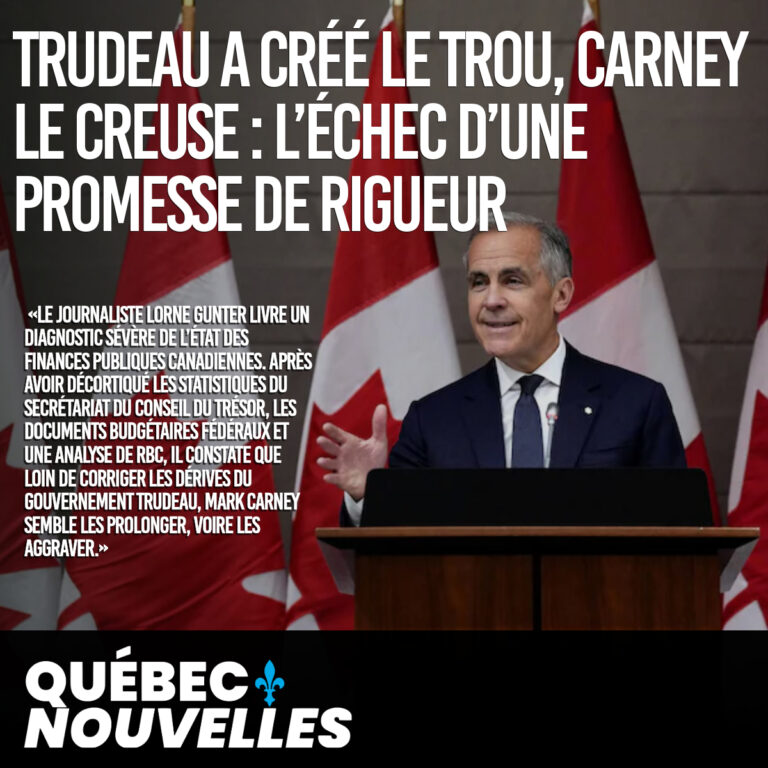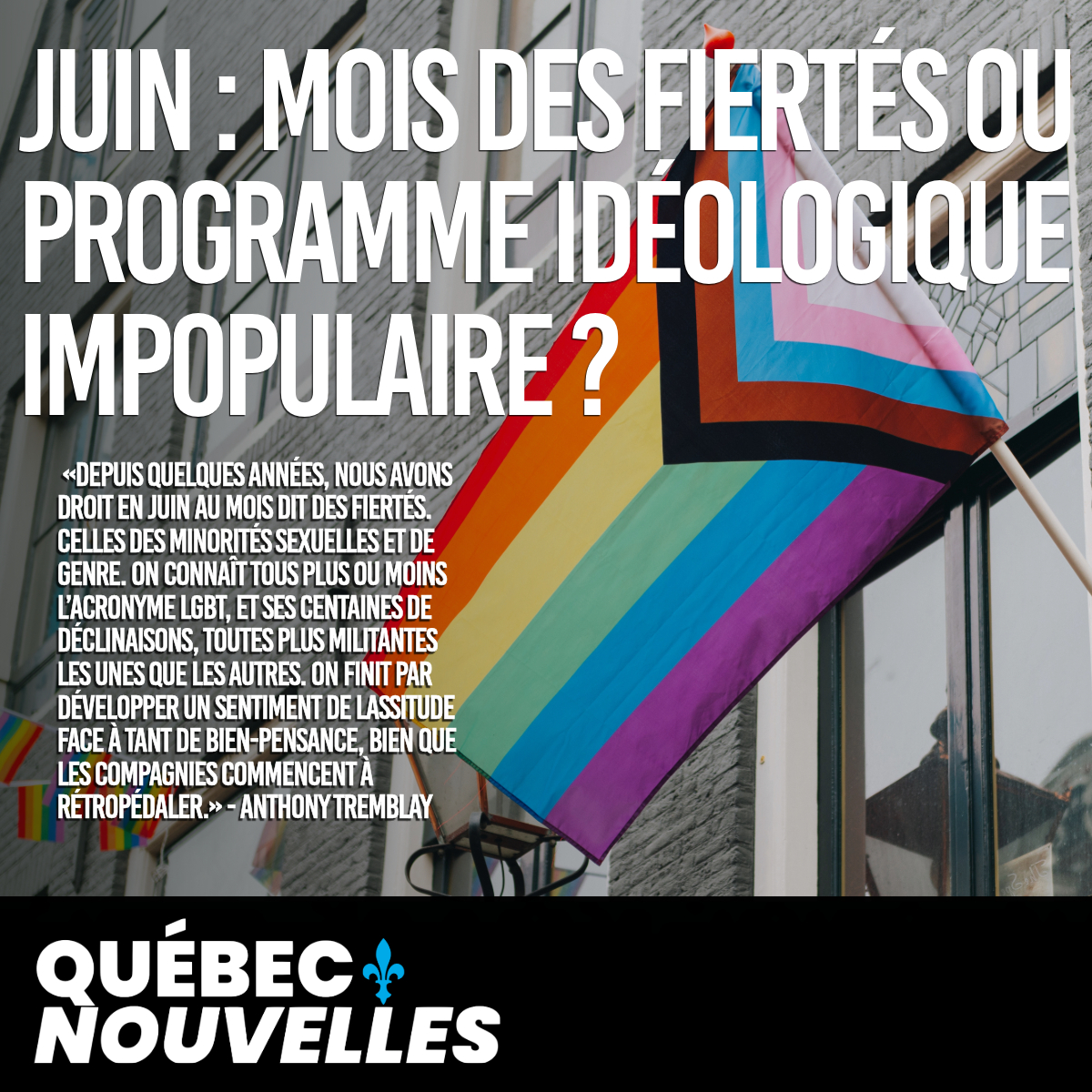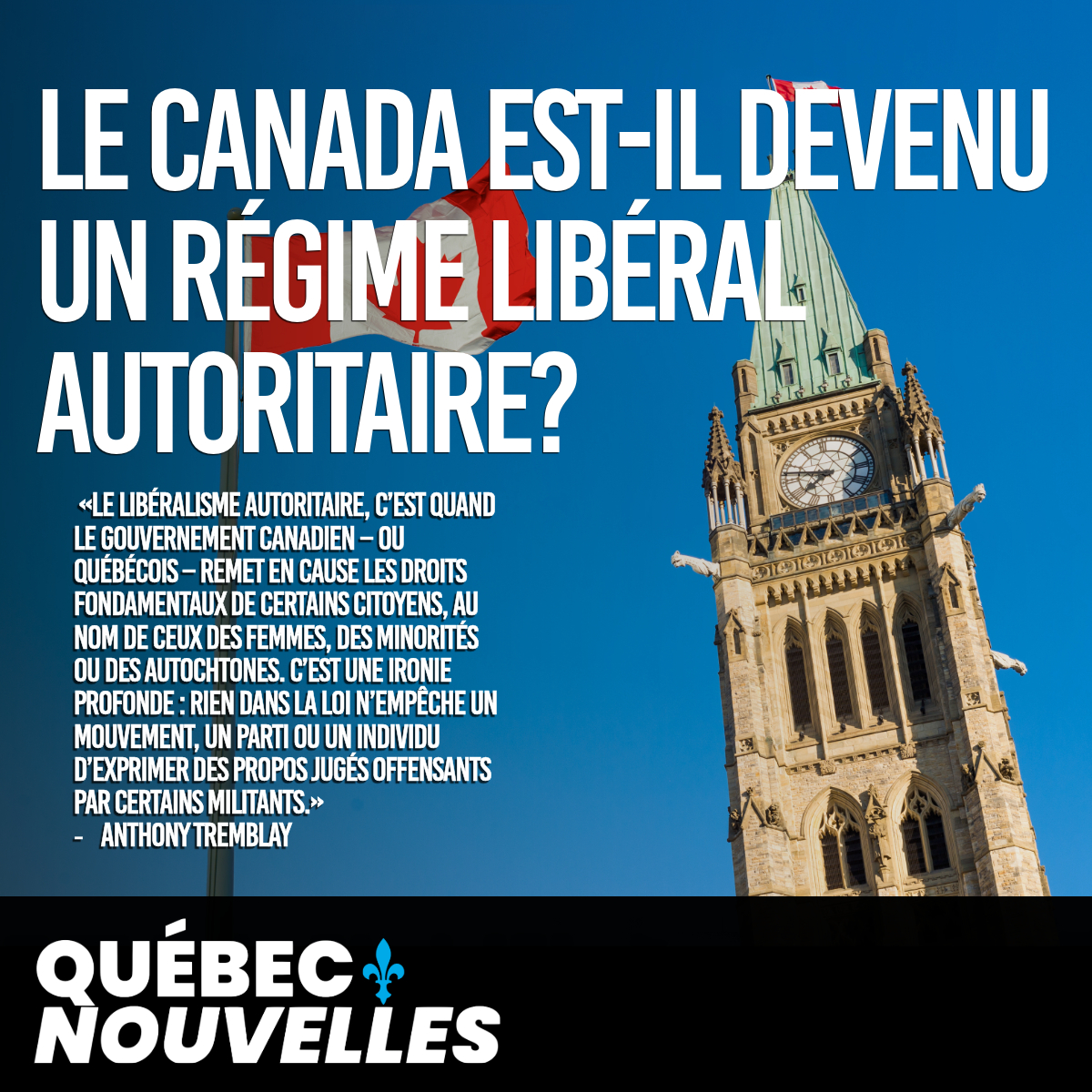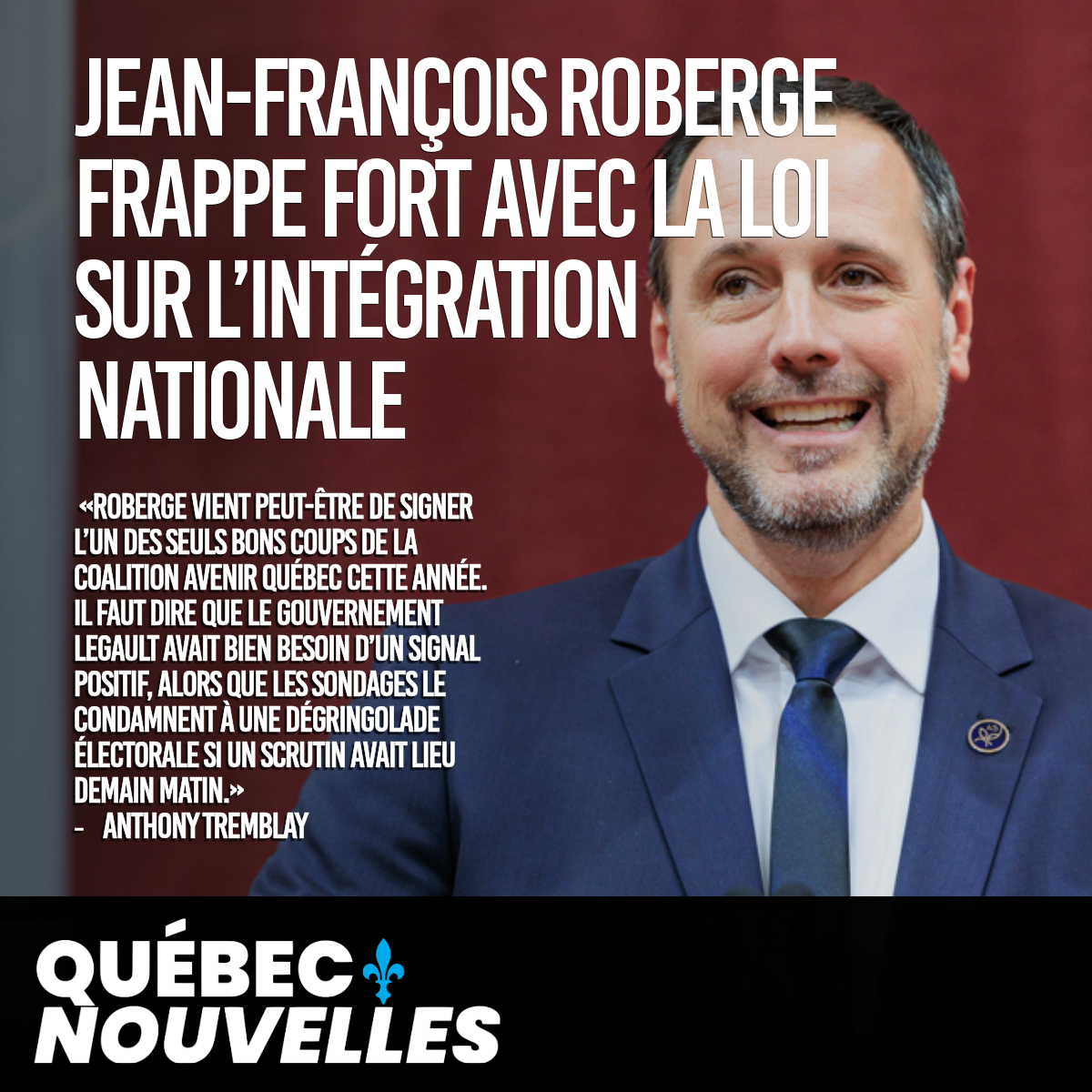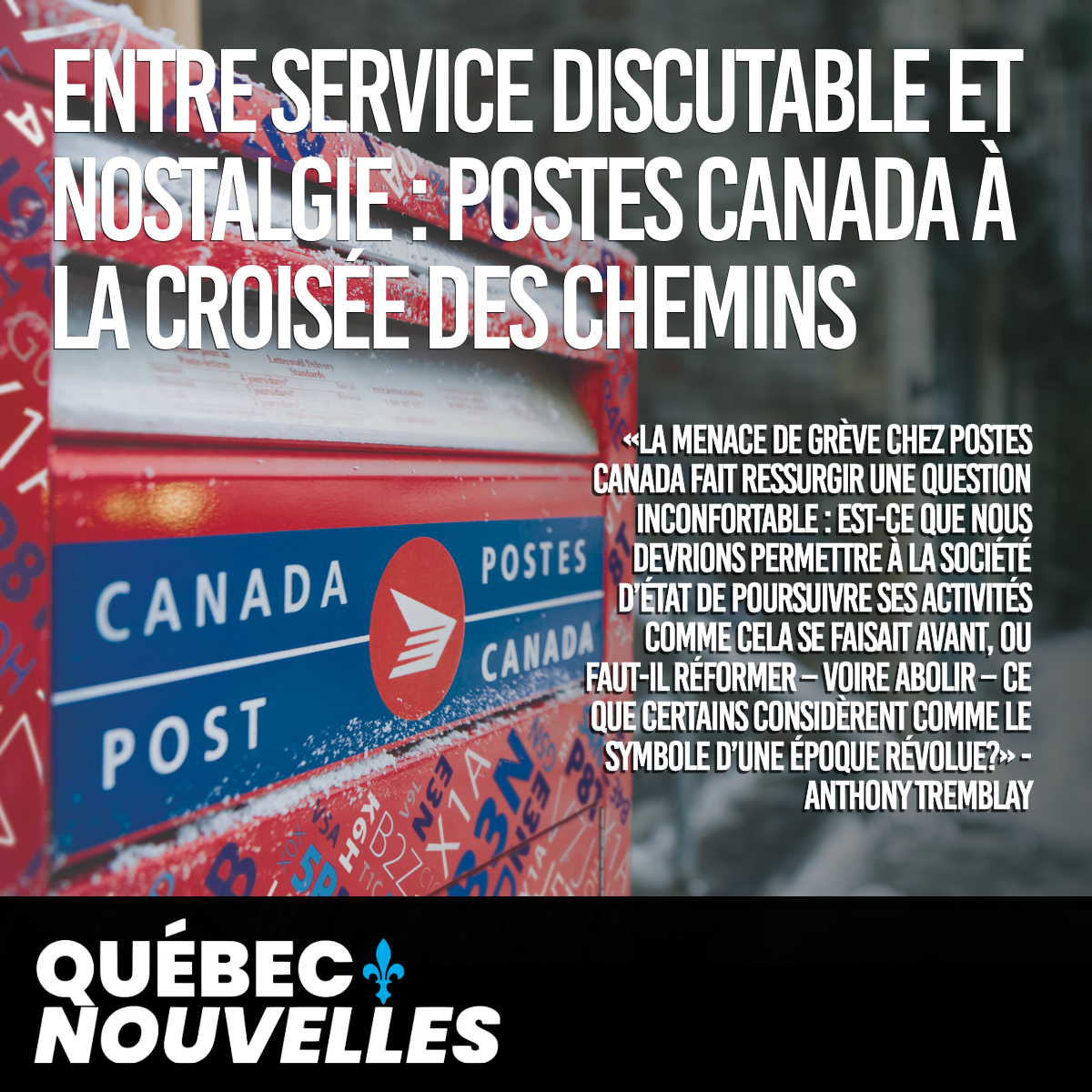Petit Québec, petite controverse encore une fois. Alors que le président des États-Unis ordonne le départ de plus de 500 000 migrants haïtiens d’ici le 24 avril, Jean-François Roberge a tenu des propos qui n’ont pas passé inaperçus. Il a affirmé que le Québec ne pouvait accueillir toute la misère du monde. Il s’en est suivi une cabale médiatique contre lui, et l’intervention de Dany Laferrière pour en rajouter. Or, le ministre Roberge n’a pas à s’excuser. Voici pourquoi.
Les postes frontaliers sont sous pression ces jours-ci : des migrants d’Haïti, qui étaient jusqu’alors dans une situation précaire aux États-Unis, comptent désormais bouger vers le Canada, vu comme une terre d’accueil moins hostile. Or, les capacités d’accueil du Canada – et du Québec en particulier – sont à leur maximum.
Il n’y a plus assez de logements pour les locaux et ceux qui sont venus d’ailleurs il y a quelques années. Les réseaux sociaux regorgent d’histoires de détresse vécue par des familles ou des travailleurs temporaires. Alors, pourquoi en rajouter si l’on sait qu’on ne pourra pas accueillir davantage de migrants ?
La formule « misère du monde » n’est peut-être pas des plus élégantes, mais il faut quand même nuancer les propos du ministre ici. Dany Laferrière, le célèbre mais prétentieux écrivain, qui a par ailleurs craché sur les Québécois en les qualifiant de consanguins, demande de la compassion pour ses compatriotes.
Il affirme que parmi eux se trouve la richesse de demain. Or, lorsqu’on analyse l’histoire de la diaspora haïtienne au Québec, il faut dire que c’est la première génération qui était constituée de médecins, d’écrivains, d’ingénieurs. Celles ayant suivi ont, au mieux, travaillé dans l’entretien ménager. Et il faut dire que les indicateurs économiques des secteurs de l’île de Montréal où ils sont concentrés ne sont guère reluisants.
Parler de richesse ici est exagéré. Dans le meilleur des cas, les migrants s’ajouteront à une armée de réserve du capital, pour reprendre une expression de Karl Marx : celle des petits salaires et des mauvaises conditions de travail. Faisant compétition aux nationaux ainsi qu’aux immigrants déjà installés qui essaient de s’en sortir.
Le chômage augmente, les commerces en arrachent. Les magasins sont incapables de compétitionner avec les produits importés de Chine sans taxe. Les gens essaient d’avoir le meilleur rapport qualité-prix pour chaque dollar dépensé. Alors, dans ce contexte, comment accueillir davantage de gens, qui pour la plupart, n’ont aucune formation ? Et encore moins de métiers spécialisés qui seraient nécessaires ici ?
Amnistie internationale affirme que la réponse du Québec n’est pas digne d’un État de droit. Mais le Québec est au bout de ses capacités. Et vouloir forcer la chose ne fera que provoquer davantage de drames humains. La solution ? La paix doit revenir en Haïti, et les migrants doivent reconstruire leur pays.
Il est surprenant de voir des vidéos de la capitale Port-au-Prince, qui a de véritables airs de Gaza, dans une telle situation. Une situation qui n’est pas provoquée par des groupes terroristes ou des armées régulières, mais par des gangs. C’est un cas rare dans l’histoire d’un chaos à l’échelle nationale, provoqué par des groupes criminalisés. Haïti doit être reconstruite par les gens qui fuient vers les États-Unis ou le Canada.
Car non, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Malgré ce qu’en pensent certaines organisations progressistes bon chic bon genre, ou encore des écrivains méprisants à l’égard du peuple québécois. La limite, pour eux, c’est quoi ? En accueillir à l’infini ? Ne mettre aucune barrière ? Ça ne peut pas marcher comme ça. Un État de droit doit pouvoir assurer des services minimaux à sa population. Pas la plonger dans la précarité pour entasser des gens venus d’ailleurs.