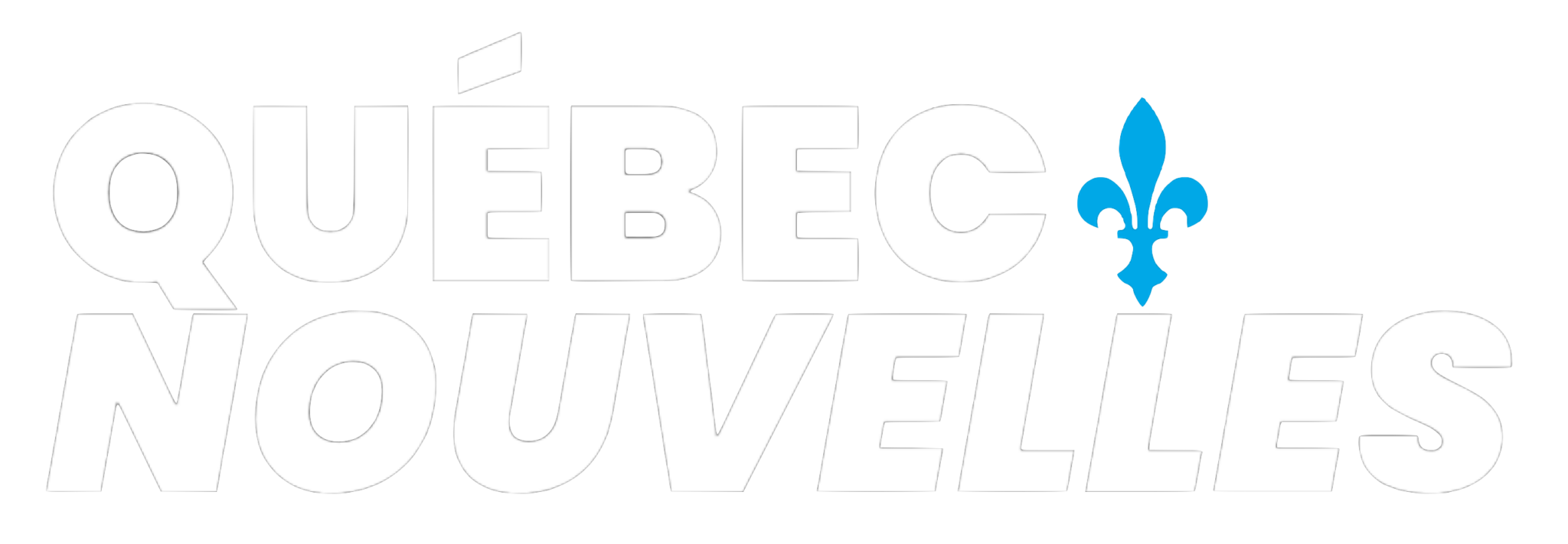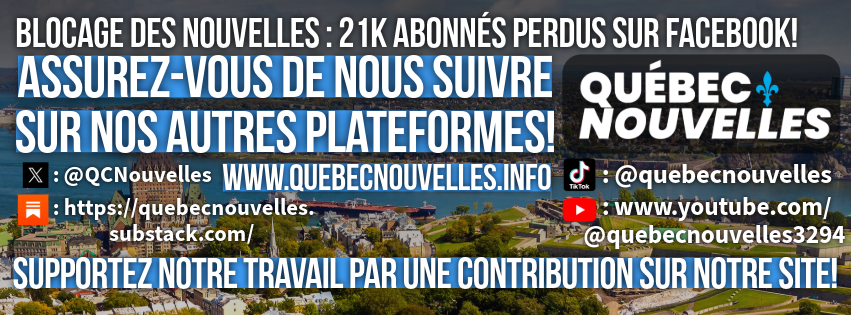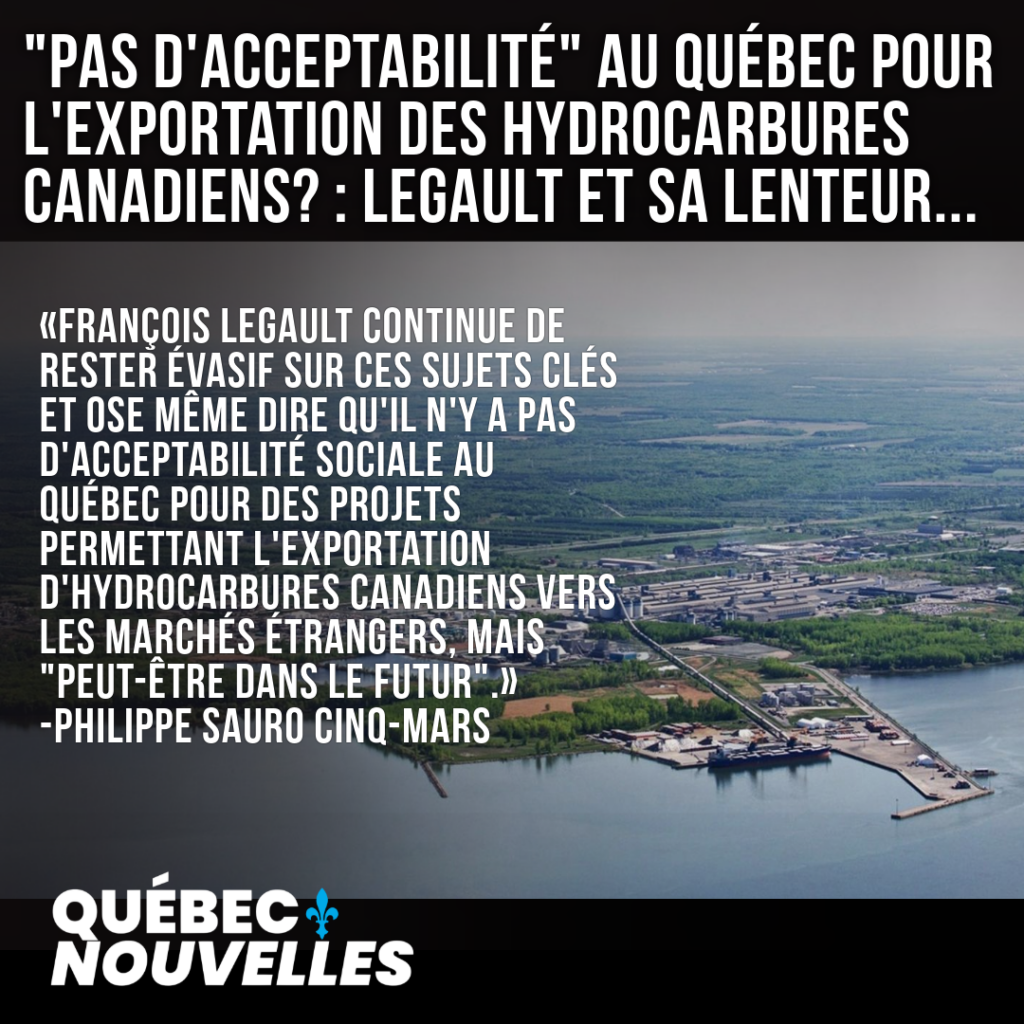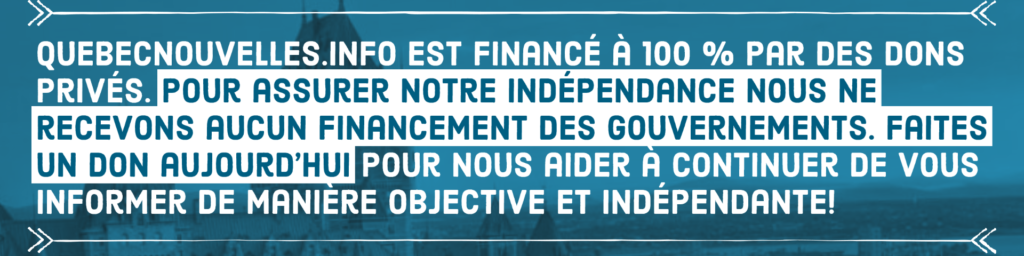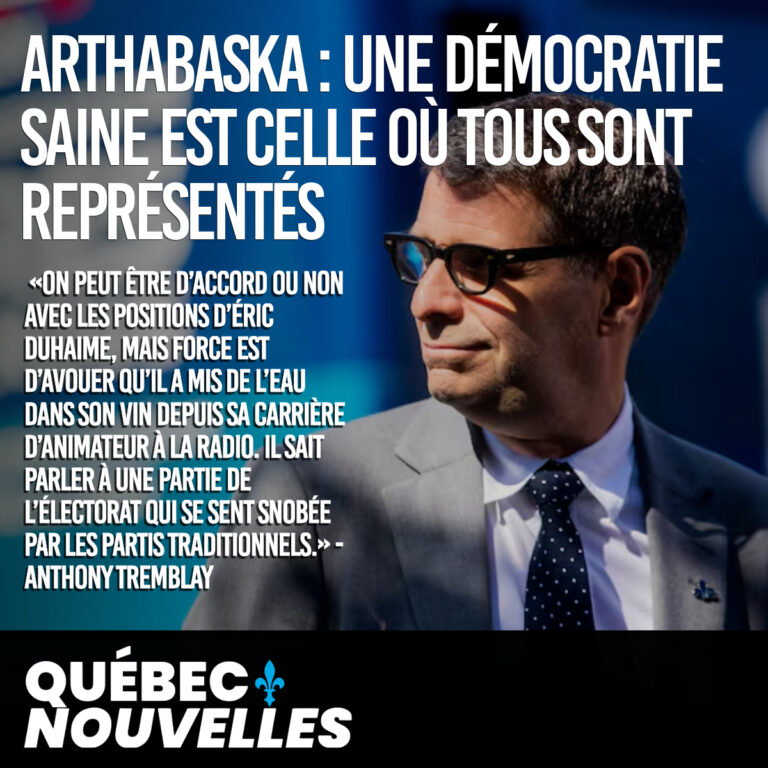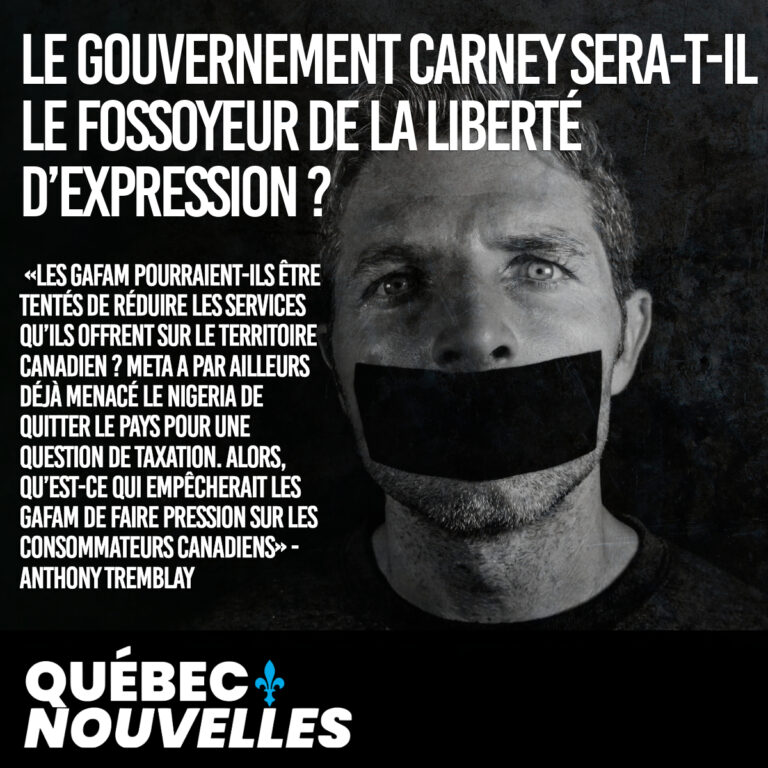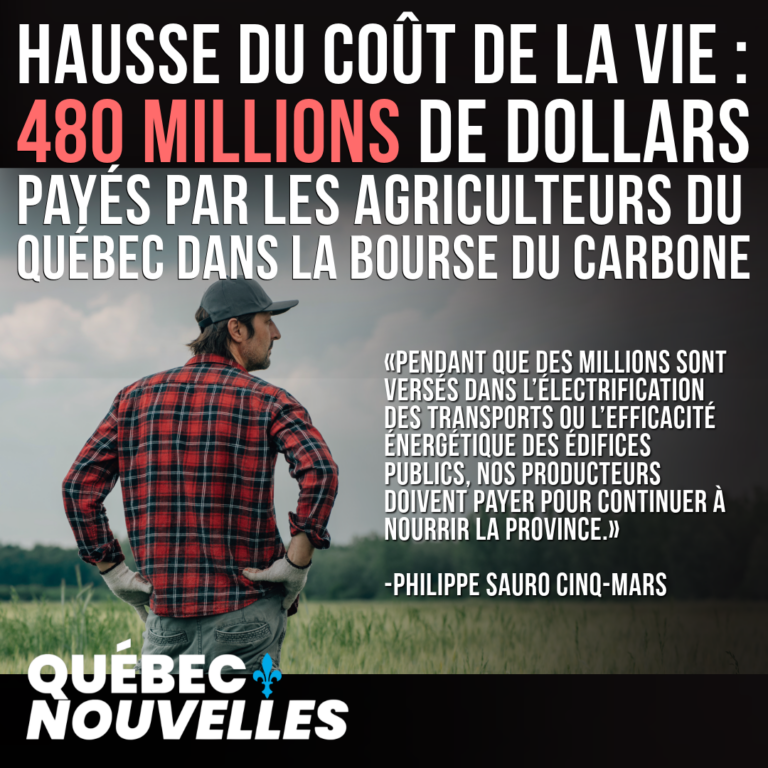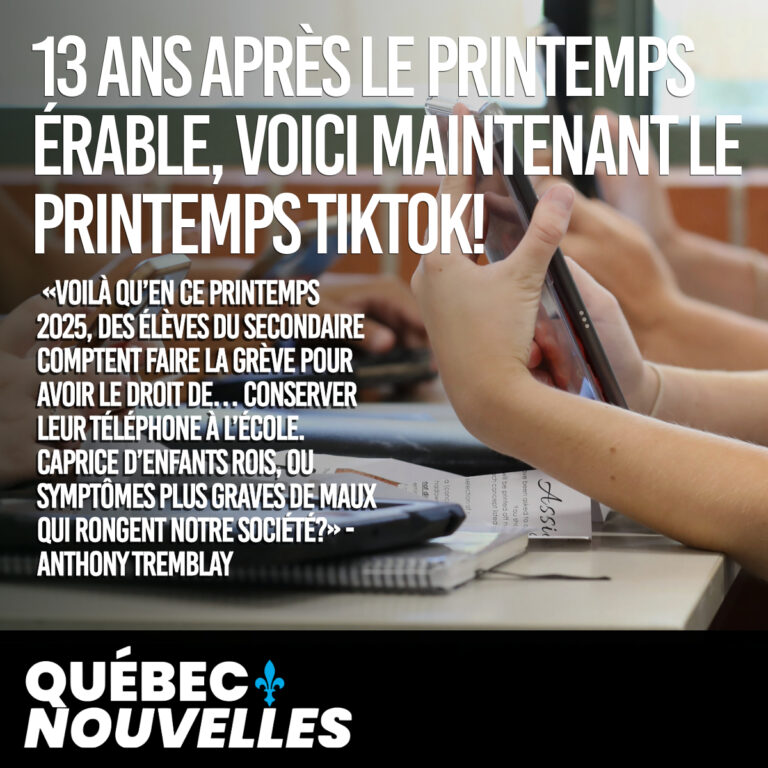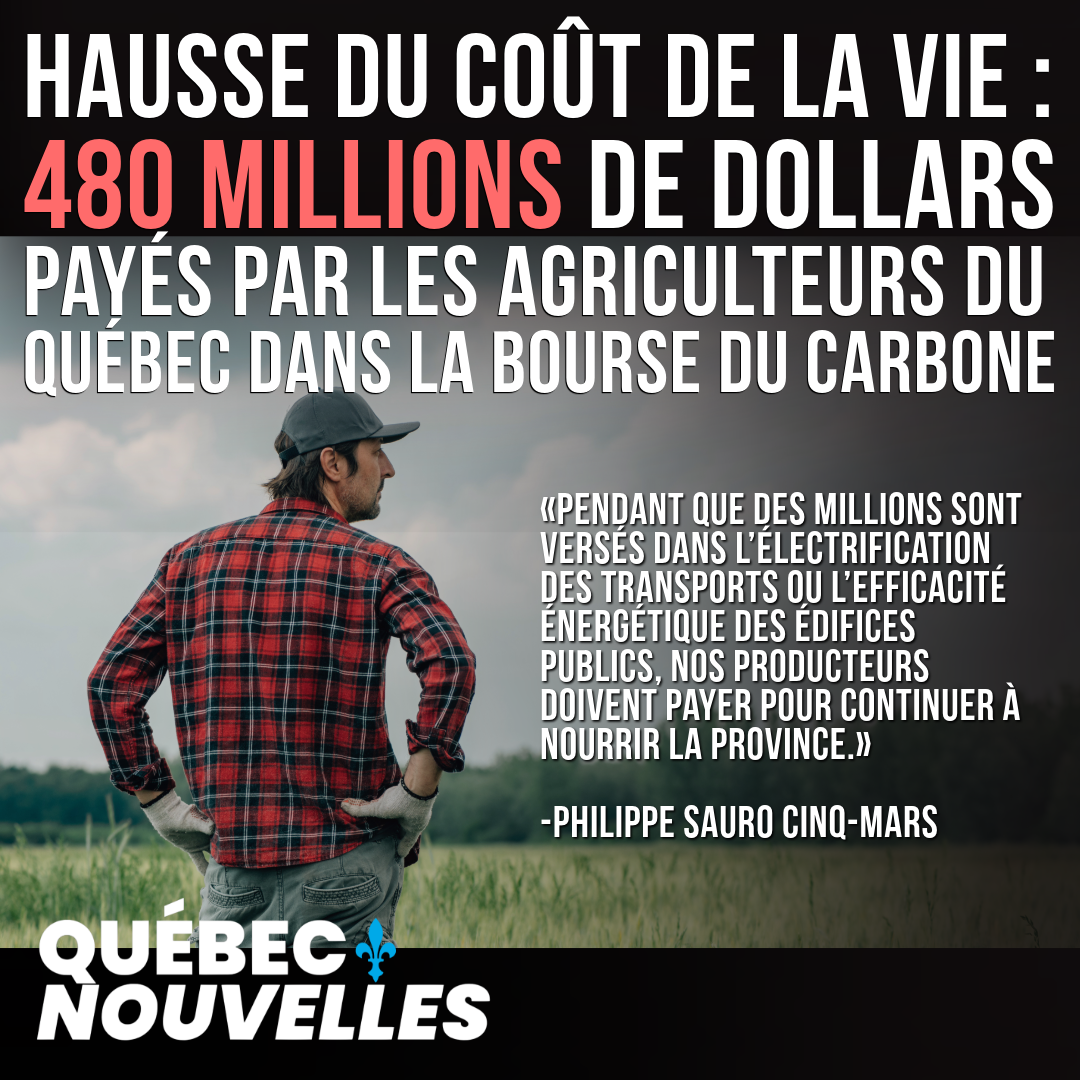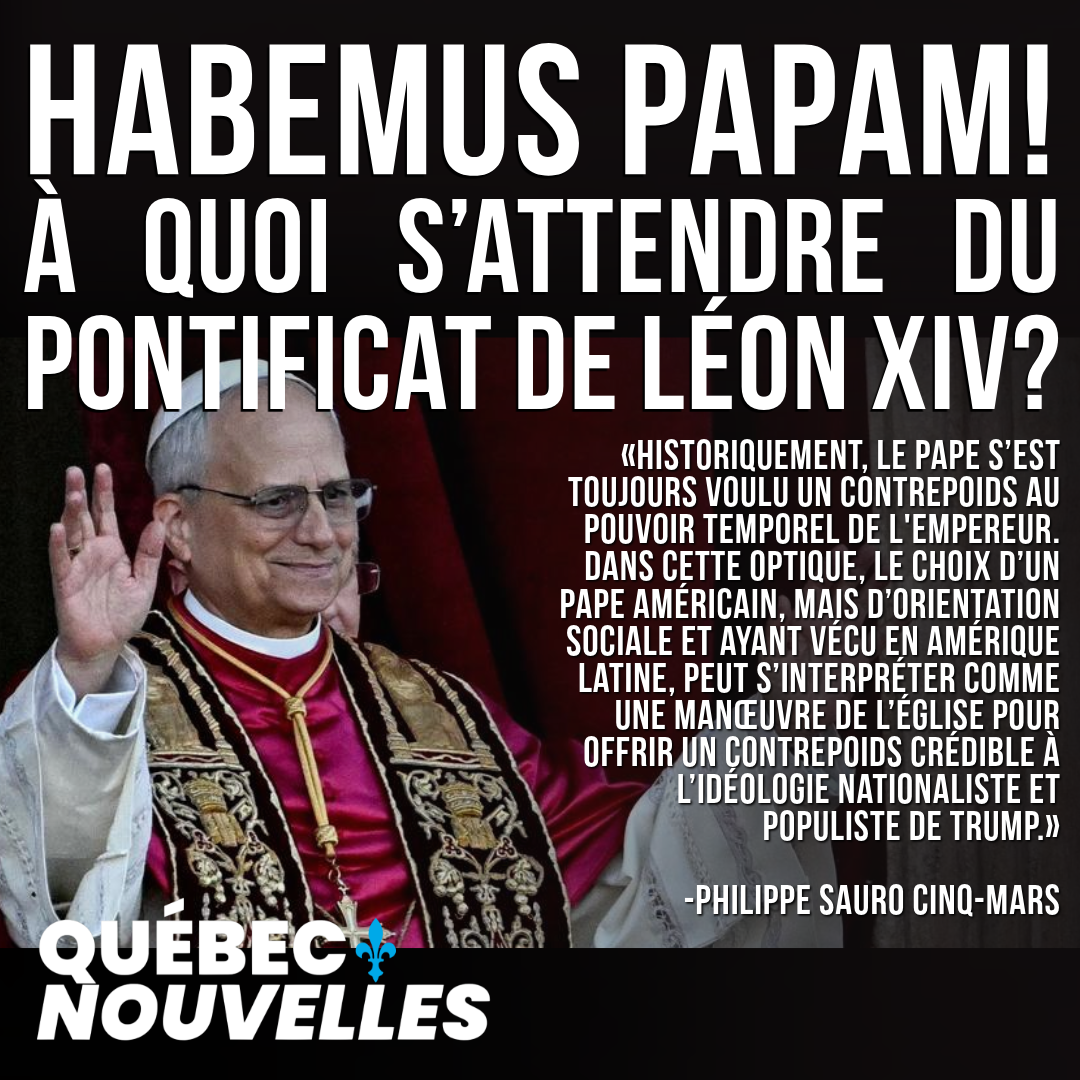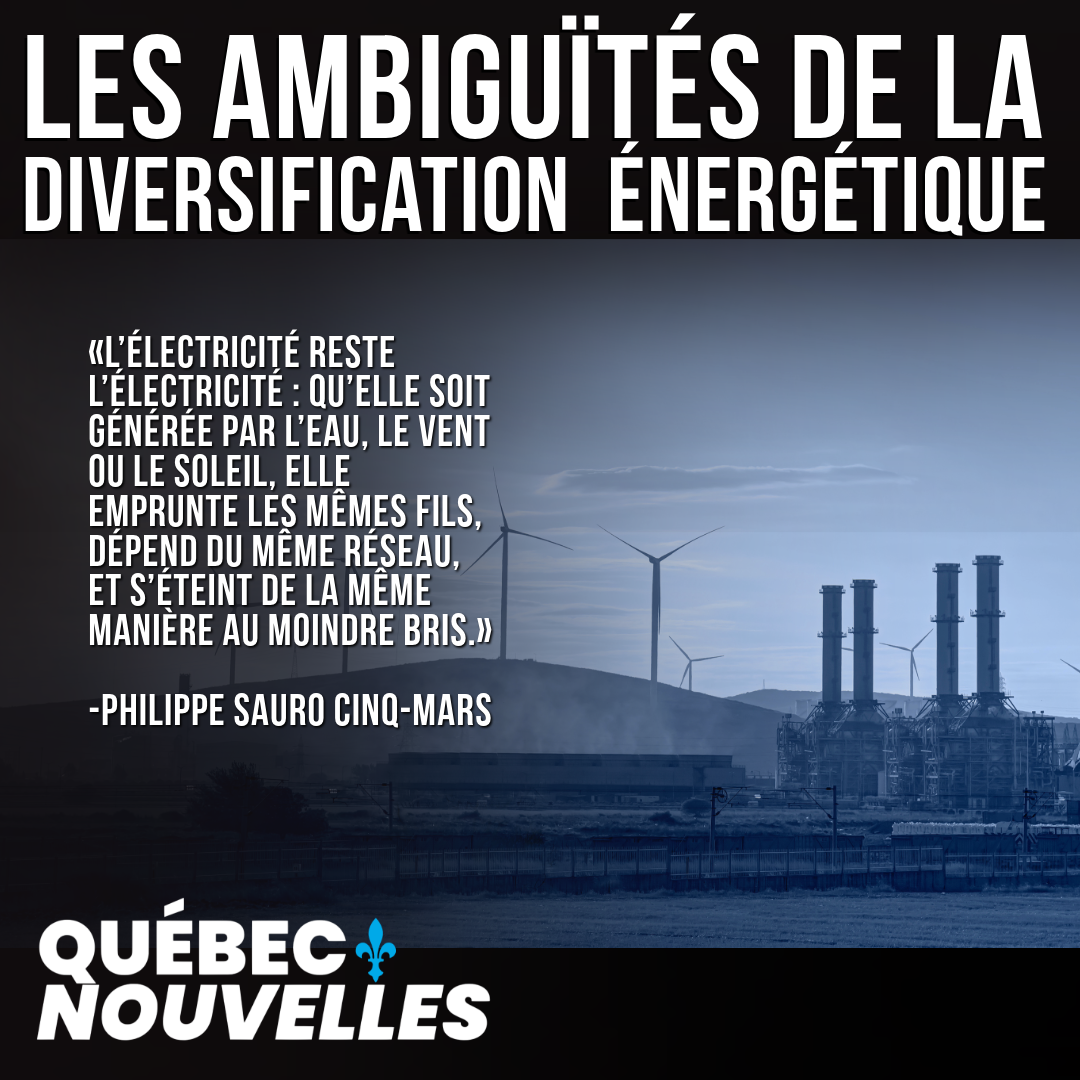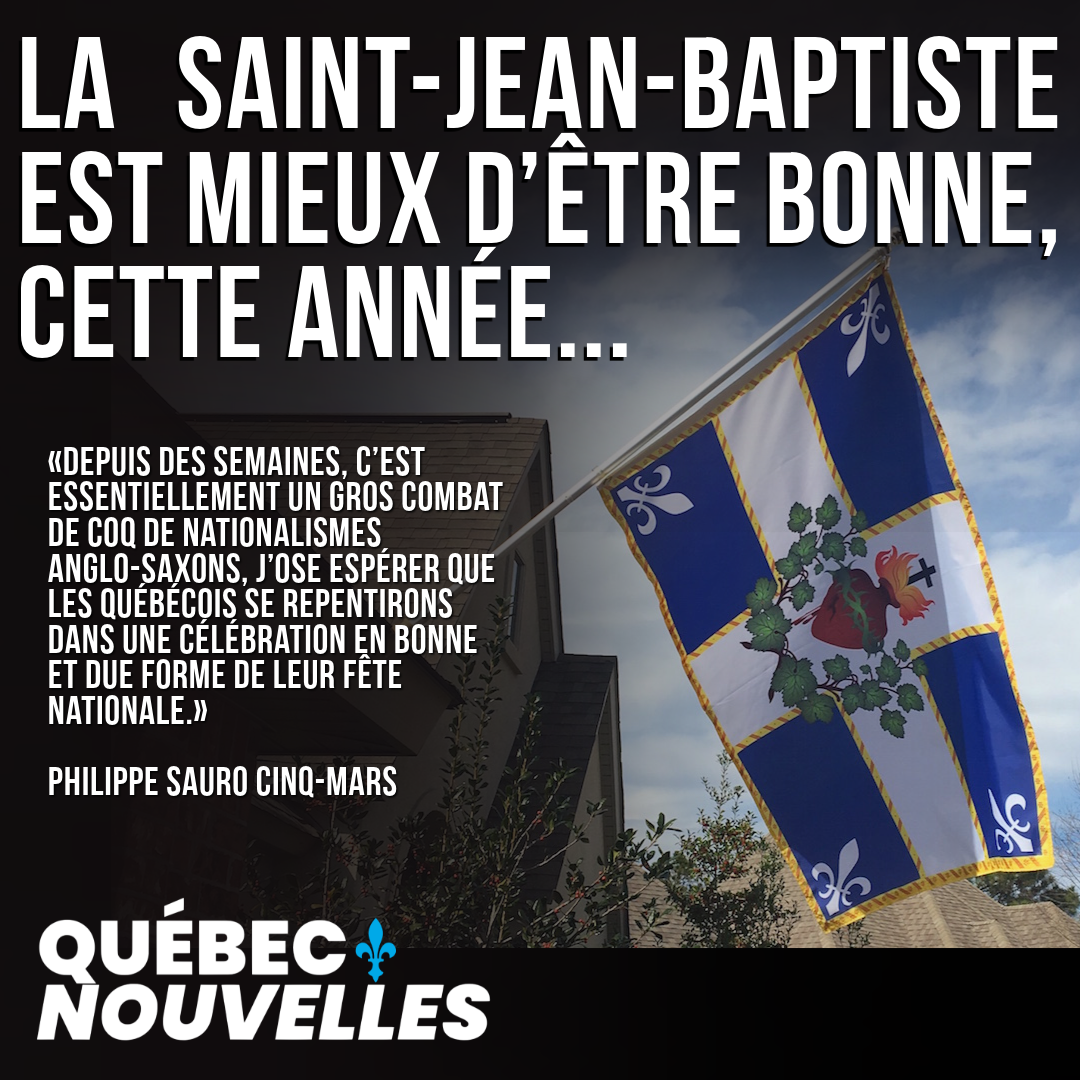Avec la crise des tarifs entre le Canada et les États-Unis, la question de l’énergie, déterminante pour l’économie, est devenue centrale. Le paradigme change à une vitesse folle, et clairement, des choix économiques difficiles s’imposent. Pourtant, François Legault continue de rester évasif sur ces sujets clés et ose même dire qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale au Québec pour des projets permettant l’exportation d’hydrocarbures canadiens vers les marchés étrangers, mais « peut-être dans le futur ».
Un levier stratégique incontournable
Rapidement après l’annonce par Donald Trump de ses tarifs de 25%, il a été déterminé que le pétrole albertain était le meilleur levier de négociation du Canada contre le président américain. Or, Danielle Smith n’était pas prête à sacrifier son économie en coupant le robinet de son pétrole aux Américains. Elle prétend même avoir aidé l’est du Canada, puisqu’en cas de réplique par les Américains, ce sont nous, qui importons près de la moitié de notre pétrole des États-Unis, qui en souffrirait.
Dans tous les cas, le protectionnisme et la brutale realpolitik de Donald Trump, qui scande haut et fort « Drill, baby, Drill », ont redéfini les relations énergétiques nord-américaines.
Un retard dans la réaction politique
Legault est toujours un peu lent dans ses réactions. La situation depuis l’élection de Trump évolue à un rythme accéléré ; le paradigme est déjà en train de changer, jour après jour. et il ne s’en tient qu’à dire qu’à cause des tarifs de Trump, peut-être, « dans le futur », l’acceptabilité sociale pour des projets d’exploitation ou de transport de gaz ou de pétrole pourrait revenir.
Il en parle comme d’un vague hypothétique, dans un horizon éloigné. Or, la crise est en ce moment, et le changement de paradigme est déjà en branle ; Legault n’a plus le luxe de méditer des hypothèses sur le long terme. Sans parler des dernières années à négliger nos alliés européens dépendant du gaz russe… Il y a des limites à feindre le sage qui attend le bon moment.
Dans ce contexte, Legault confond probablement deux choses : il y a bel et bien une acceptabilité sociale ; ce qu’il n’y a pas, c’est une acceptabilité politique et médiatique qui, ironiquement, découle beaucoup de lui-même.
Dans les faits, les Québécois supportent en majorité l’idée d’exploiter nos propres ressources en hydrocarbures. Par exemple, un sondage de 2022 a révélé que plus de 66 % des Québécois décidés appuient le développement local du gaz naturel, un appui qui atteint 74 % si de nouvelles technologies sont utilisées pour éliminer les émissions.
Or, la vision de Legault est peut-être biaisée par son univers politique et médiatique qui, lui, ne laisse aucune place à toute idée d’exploiter des hydrocarbures au Québec ou au Canada. C’est dans les partis et sur les plateaux télévisés que l’idée est une sorte de Voldemort imprononçable. Mais chez le commun des mortels, l’appui existe bel et bien.
Ce qui est le plus frustrant à propos de cette lenteur de réaction, c’est qu’après des années à tout bloquer, on se voit souvent répondre que « ça prendrait X années avant de compléter le terminal de liquéfaction X, et rendu là, on n’en aura plus besoin ». Ce qui est ridicule, considérant qu’on accumule les crises qui ne seraient pas advenues si nous avions pris des précautions des années auparavant…
Bécancour, une solution plus rapide que le Saguenay
Il y a certains projets québécois qui pourraient être réanimés. Évidemment, dans les dernières années, on a beaucoup parlé de GNL Québec dans le Saguenay, mais une manière plus efficace pour rapidement rendre opérationnel notre secteur gazier serait de ranimer le projet de terminal de liquéfaction à Bécancour.
Le projet de terminal de liquéfaction à Bécancour présente des avantages logistiques significatifs. La proximité du site avec le réseau principal de gazoducs canadiens facilite l’approvisionnement en matière première. En revanche, la construction d’un pipeline vers le Saguenay, comme proposé dans le projet GNL Québec, impliquerait la création d’une nouvelle canalisation de 780 kilomètres reliant la ligne principale existante de TransCanada en Ontario jusqu’au Saguenay, ce qui entraînerait des délais et des coûts supplémentaires.
Considérant les défis économiques auxquels est confrontée l’industrie des batteries à Bécancour et les milliards qu’on y a investis, le projet de terminal de liquéfaction de gaz naturel pourrait offrir une alternative économique en diversifiant les activités industrielles de la région. On créerait de nouveaux emplois, compensant les pertes potentielles liées à la filière des batteries.
Il est temps pour le Québec de réévaluer sa position sur l’exploitation de ses ressources énergétiques. L’acceptabilité sociale semble présente, et des projets comme celui de Bécancour offrent des opportunités tangibles pour renforcer notre autonomie énergétique et soutenir notre économie. Attendre davantage ne ferait que prolonger notre dépendance et retarder des solutions qui pourraient bénéficier à l’ensemble de la province.