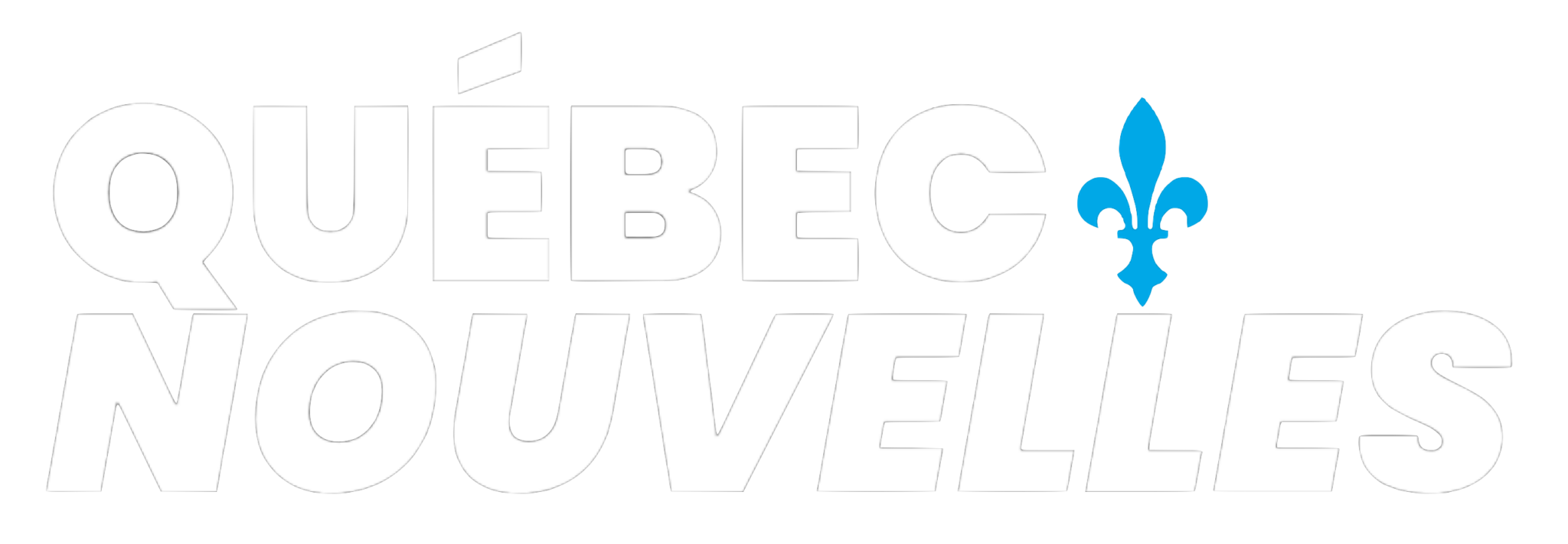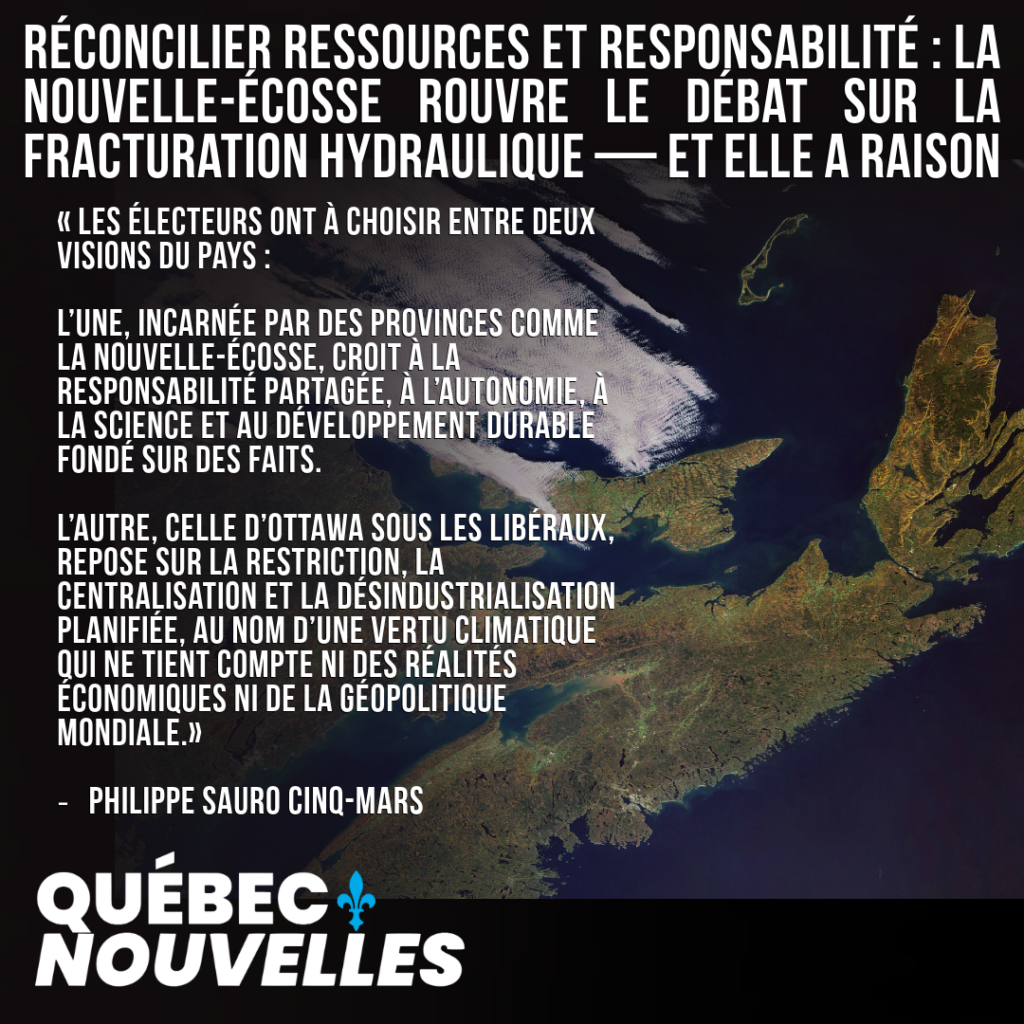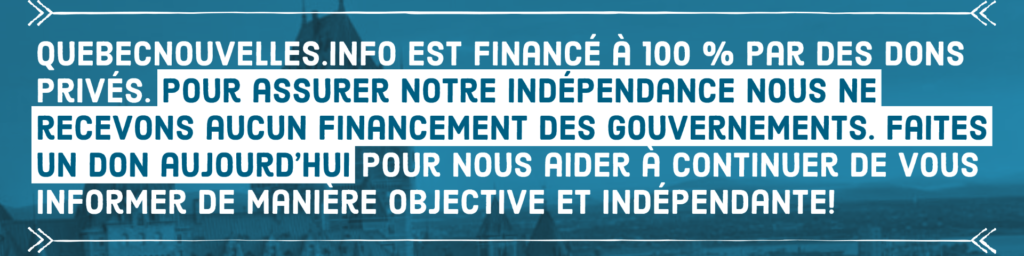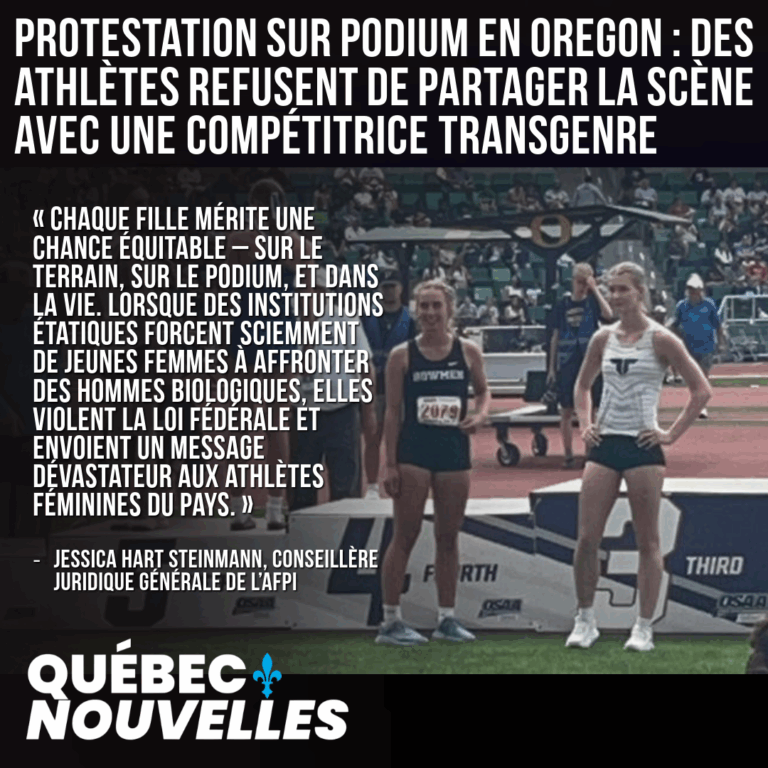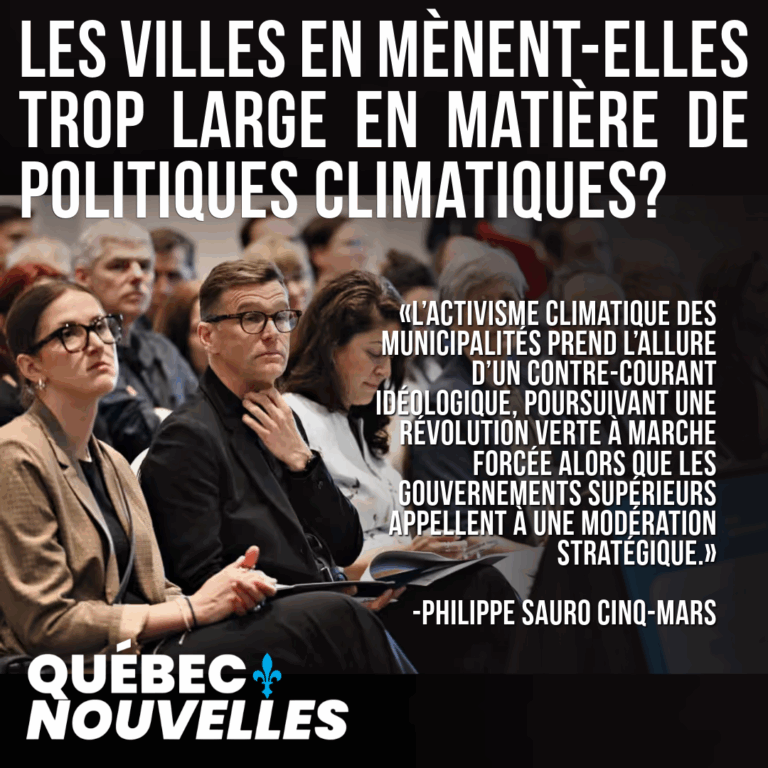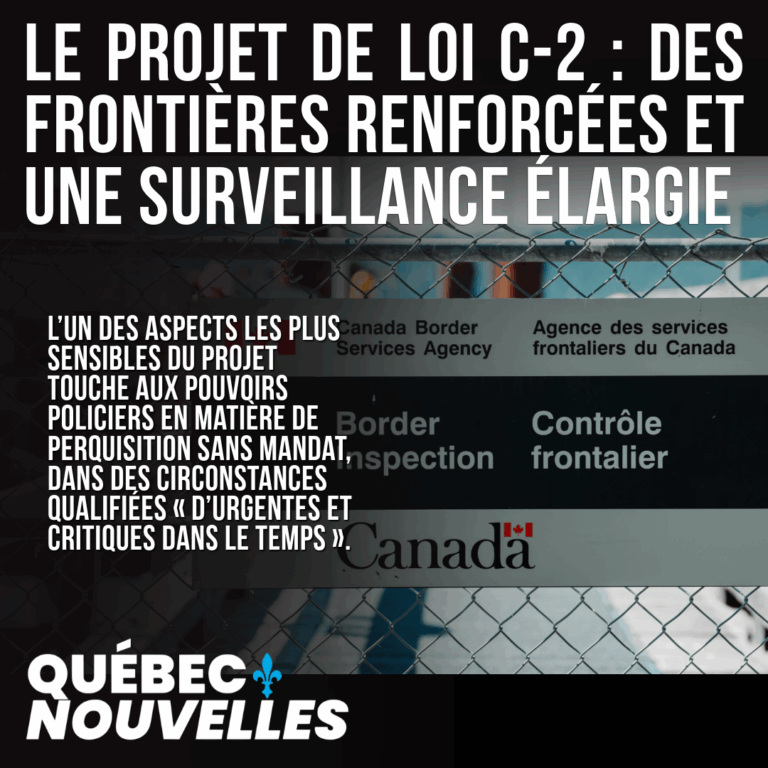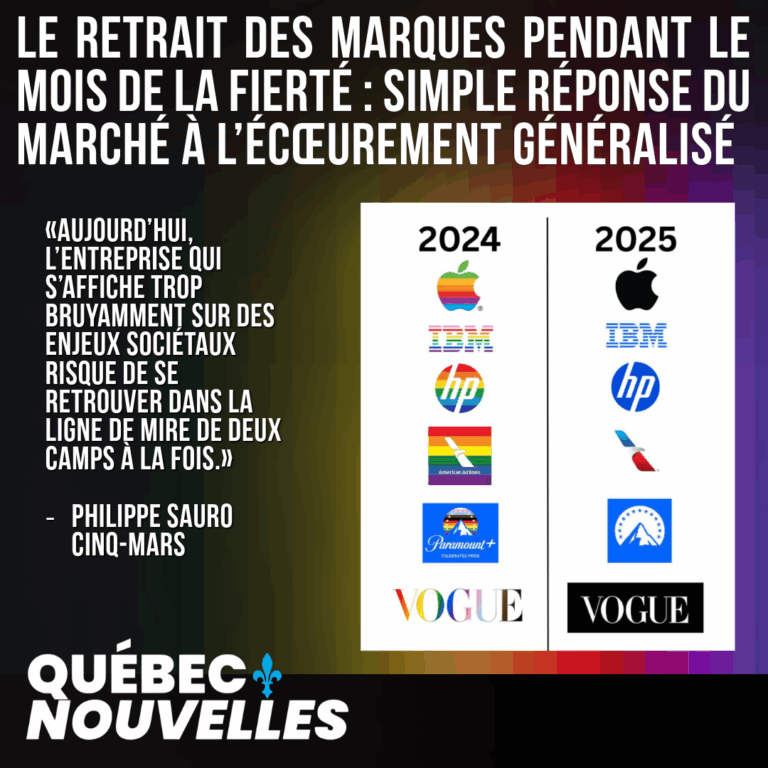Il aura fallu du courage politique et un brin de lucidité économique pour que le gouvernement de Tim Houston en Nouvelle-Écosse rompe enfin avec la paralysie énergétique qui grippe le Canada atlantique depuis plus d’une décennie. Le 13 avril 2025, Kenneth P. Green, analyste principal au Fraser Institute, saluait cette décision audacieuse de lever les moratoires sur la production d’uranium et, surtout, sur la fracturation hydraulique. Non seulement cette décision est fondée sur des faits scientifiques, mais elle trace une voie sensée vers la prospérité énergétique régionale – et, potentiellement, à l’échelle canadienne.
« Compte tenu des défis économiques auxquels nous faisons face, comme pays et comme province, il est temps d’utiliser tous les leviers à notre disposition. Nous sommes riches en ressources et nous pouvons les développer de manière sécuritaire. Il est temps d’avoir cette discussion et d’avancer. » — Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse.
À l’heure où l’économie canadienne s’essouffle sous le poids d’un fardeau fiscal croissant, de déficits structurels et de politiques énergétiques dictées par des impératifs idéologiques plutôt que par la science, la déclaration du premier ministre Houston tranche par sa franchise. Et Kenneth P. Green ne s’y trompe pas : « Un moratoire généralisé, c’est une politique paresseuse. »
Science et précaution, pas interdiction
La fracturation hydraulique, ou fracking, est une technique d’extraction de pétrole et de gaz naturel qui consiste à injecter un mélange d’eau, de sable et d’additifs chimiques sous haute pression pour fissurer la roche et libérer les hydrocarbures. Cette technologie, qui a transformé les États-Unis en géant énergétique au cours des deux dernières décennies, est au Canada victime d’un ostracisme politique largement injustifié.
Il serait absurde de nier que la fracturation comporte des risques environnementaux. Les plus fréquemment évoqués sont la sismicité induite (petits séismes) et la possible contamination ou surexploitation des nappes phréatiques. Mais ces risques sont aujourd’hui bien compris, bien encadrés, et surtout, gérables. Comme le rappelle Green dans son étude, « il existe déjà des technologies éprouvées et des méthodes de production développées pour atténuer ces risques. » Il recommande d’ailleurs une surveillance accrue de la qualité de l’air et de l’eau, et des systèmes d’alerte plus robustes pour les populations avoisinantes. Voilà une approche responsable – celle de la gestion, et non de l’interdiction.
Une manne enfouie
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement une révision technique, mais un changement de paradigme. Le potentiel énergétique du Canada atlantique est immense — et sous-exploité.
La formation géologique de Horton Bluff, en Nouvelle-Écosse, contiendrait jusqu’à 69 trillions de pieds cubes (Tcf) de gaz de schiste, selon un rapport du Service de la bibliothèque du Parlement datant de 2014. À prix de marché actuel, cela représente une valeur potentielle de 190 milliards de dollars. À cela s’ajoute le gisement Frederick Brook au Nouveau-Brunswick, estimé entre 67 et 80 Tcf, pour une valeur marchande de 186 à 221 milliards de dollars.
Newfoundland and Labrador, de son côté, abrite la formation Green Point, dont le potentiel reste non quantifié en raison — ironie révélatrice — des moratoires qui empêchent toute exploration.
En somme, ce sont des centaines de milliards de dollars de richesse naturelle qui dorment sous les pieds des Maritimes. Et pourtant, ces provinces, riches en ressources, figurent parmi les plus dépendantes aux transferts de péréquation fédéraux. L’économie canadienne fonctionne à l’envers.
L’idéologie contre le bon sens
Le Canada est devenu un pays où l’idéologie verte l’emporte trop souvent sur les faits. Des provinces comme le Québec, pourtant gorgées de gaz naturel, interdisent non seulement son extraction mais aussi son exportation. Des projets de terminaux gaziers sont bloqués non pour des raisons techniques, mais pour satisfaire des agendas climatiques déconnectés des réalités mondiales. Et pendant ce temps, nos alliés européens, asphyxiés par leur dépendance au gaz russe, cherchent désespérément des fournisseurs fiables.
La levée du moratoire par la Nouvelle-Écosse n’est donc pas seulement une décision économique — c’est un signal politique fort : celui d’un retour à la raison.
« Les autres provinces devraient suivre l’exemple de la Nouvelle-Écosse. » — Kenneth P. Green
Et elles le devraient, pour des raisons multiples : créer des emplois qualifiés, stimuler l’investissement privé, réduire la dépendance au pétrole étranger, générer des revenus fiscaux pour les services publics, et accroître l’autonomie énergétique dans un monde instable.
Une transition oui — mais avec du gaz
Le discours dominant au Canada prétend qu’il faut sortir immédiatement des hydrocarbures. C’est une illusion dangereuse. Même l’Agence internationale de l’énergie (AIE) reconnaît que le gaz naturel jouera un rôle central dans la transition énergétique, en particulier pour remplacer le charbon, beaucoup plus polluant. Le gaz est un allié de la transition, pas son ennemi.
Il est donc incohérent de prétendre vouloir réduire les émissions mondiales tout en empêchant l’exploitation locale d’un gaz propre, abondant et stratégique. Refuser la fracturation, c’est condamner le Canada à importer ce qu’il pourrait produire lui-même — souvent depuis des régimes peu soucieux de l’environnement ou des droits humains.
La fin des interdits dogmatiques – ou leur retour
La décision du gouvernement Houston marque un tournant. Elle rappelle que les moratoires absolus, loin d’être des politiques de précaution, sont souvent des abris pour l’ignorance, la complaisance ou la lâcheté politique. Elle invite à un débat adulte, fondé sur les données, et non sur la peur, sur le potentiel plutôt que sur la panique. Ce geste audacieux ne signe pas un chèque en blanc aux compagnies pétrolières, mais il ouvre enfin la porte à une évaluation sérieuse, transparente et publique de notre potentiel énergétique.
Mais ce fragile retour au réalisme reste menacé. Dans le contexte de l’élection fédérale en cours, un éventuel retour au pouvoir du Parti libéral — qui a systématiquement mis en place, soutenu ou renforcé ces interdictions idéologiques — signifierait probablement le retour en force de politiques énergétiques dogmatiques : maintien ou réimposition de moratoires, blocage des projets de développement, instrumentalisation des évaluations environnementales, marginalisation des provinces qui souhaitent exploiter leurs ressources, et renforcement d’un régime de dépendance aux importations et aux transferts.
Il ne faut pas se méprendre : l’enjeu énergétique est aussi un enjeu de souveraineté politique. Les électeurs ont à choisir entre deux visions du pays. L’une, incarnée par des provinces comme la Nouvelle-Écosse, croit à la responsabilité partagée, à l’autonomie, à la science et au développement durable fondé sur des faits. L’autre, celle d’Ottawa sous les libéraux, repose sur la restriction, la centralisation et la désindustrialisation planifiée, au nom d’une vertu climatique qui ne tient compte ni des réalités économiques ni de la géopolitique mondiale.
Le Canada peut continuer à s’appauvrir au nom de principes abstraits, pendant que d’autres profitent de nos hésitations. Ou il peut, comme la Nouvelle-Écosse vient de le faire, reprendre le contrôle de son avenir énergétique. Ce choix, il appartient désormais aux électeurs de le faire.