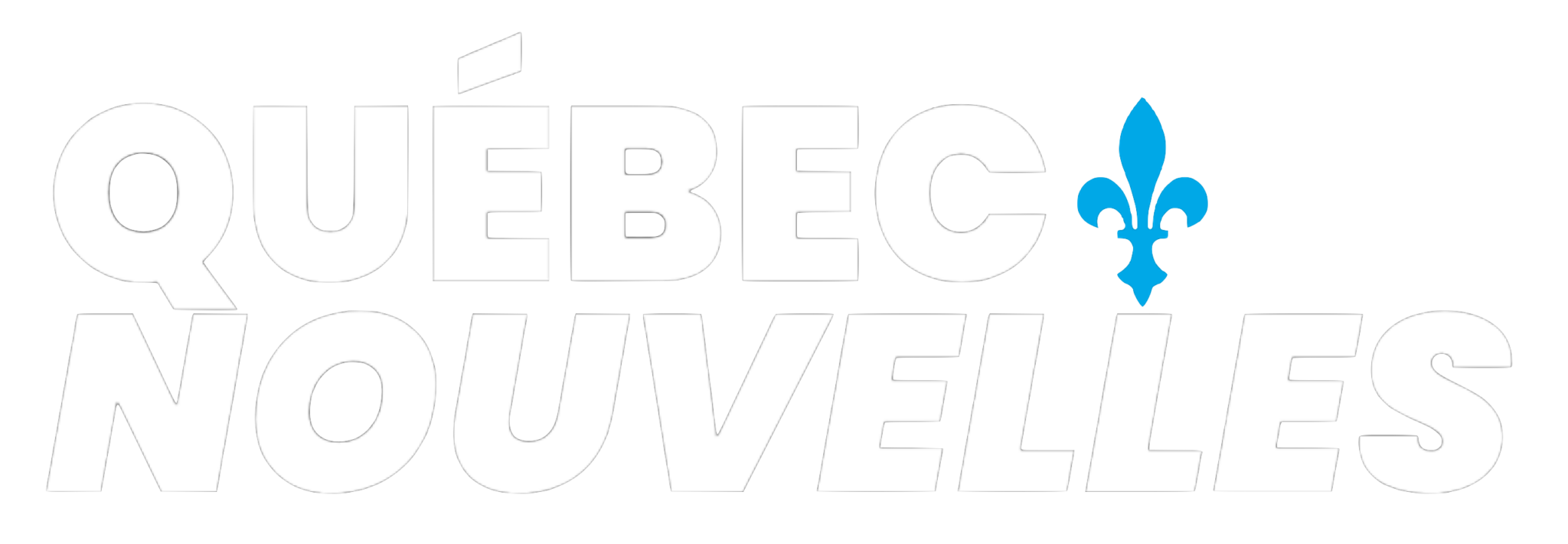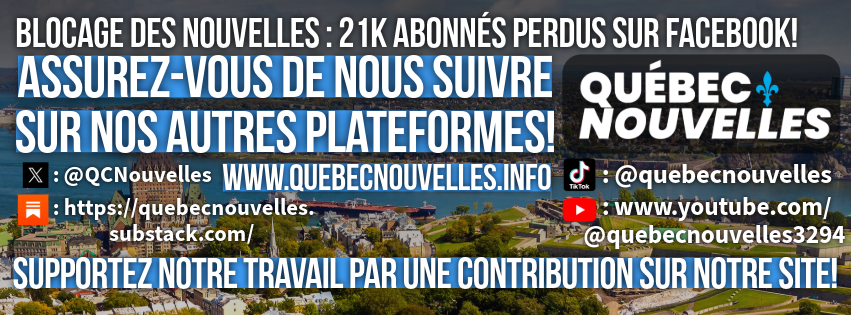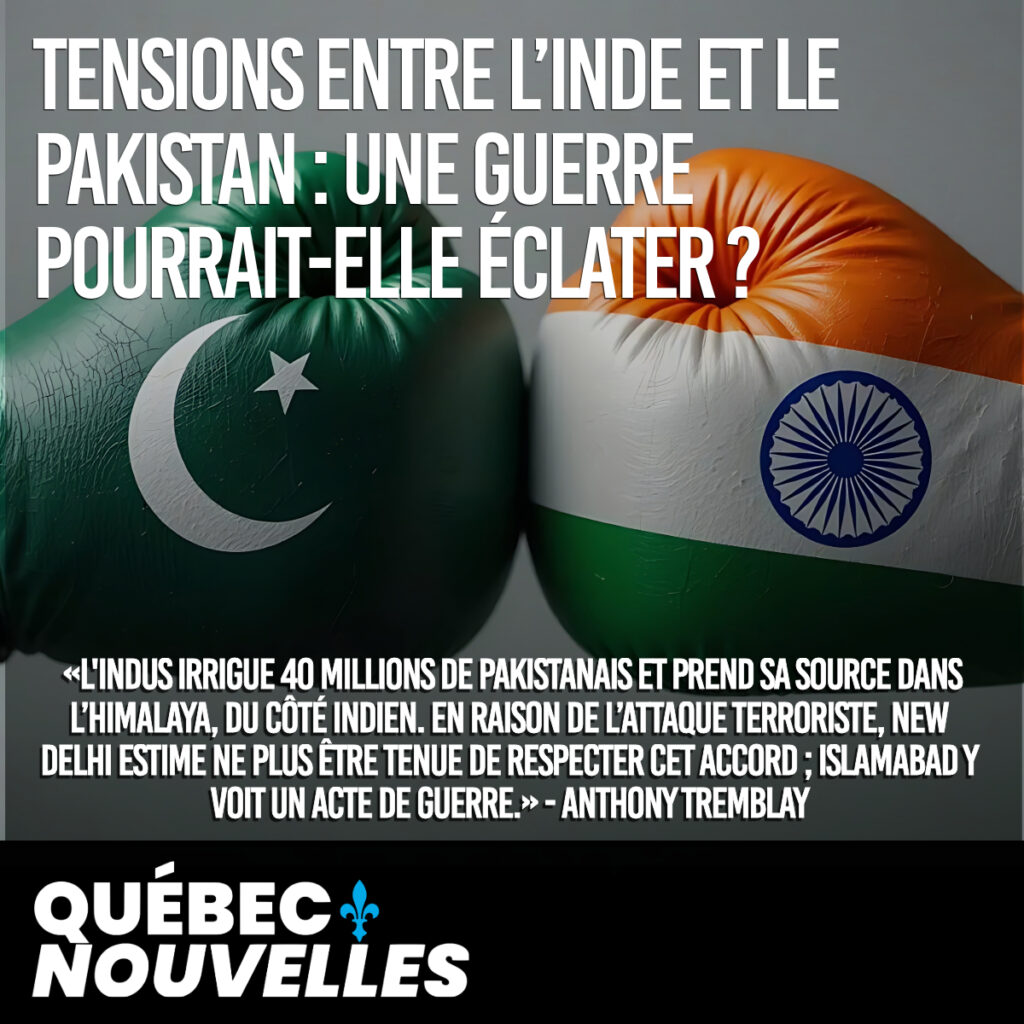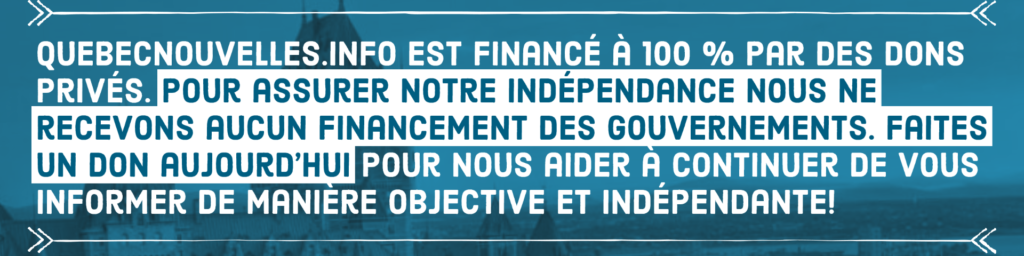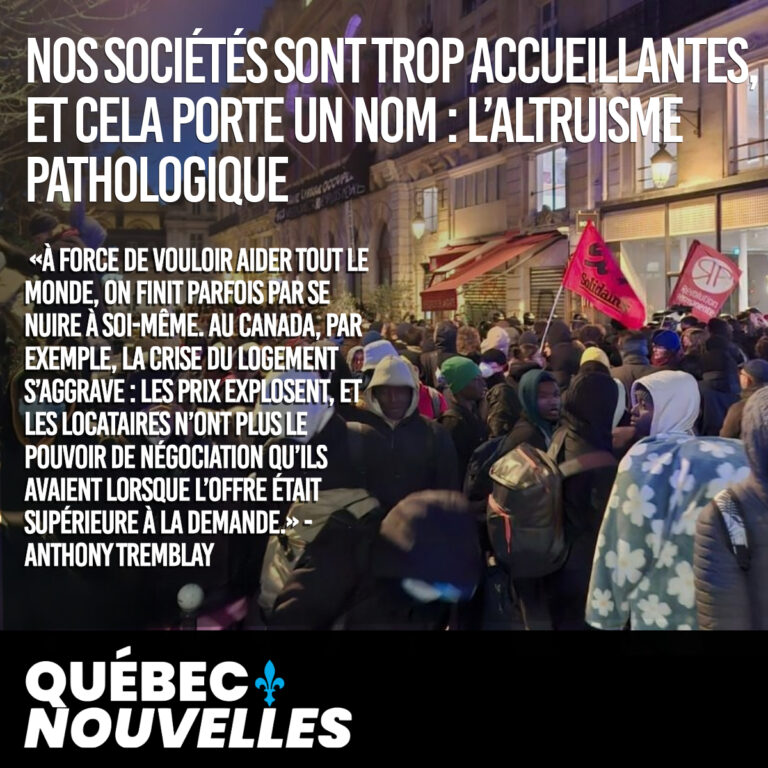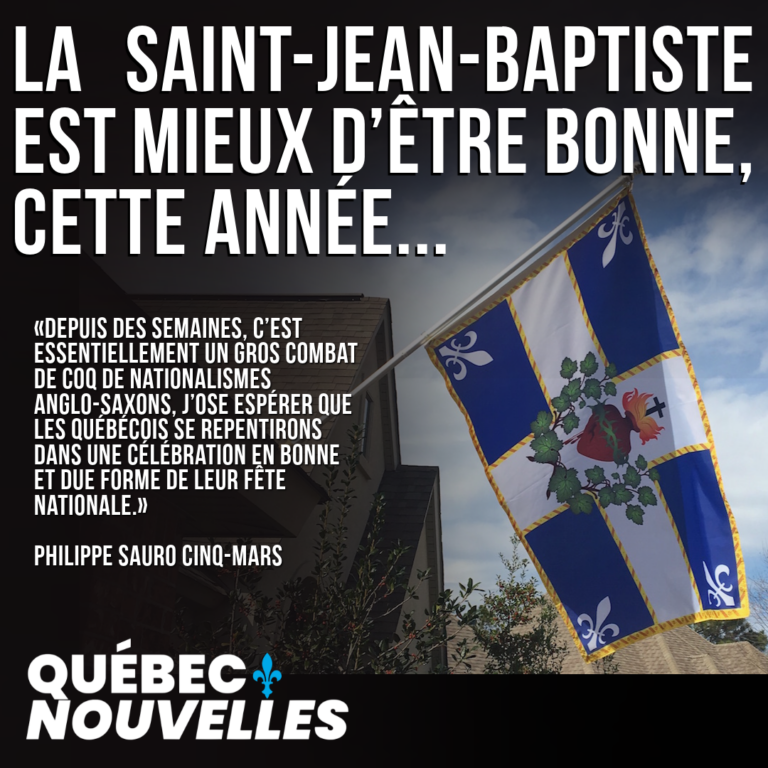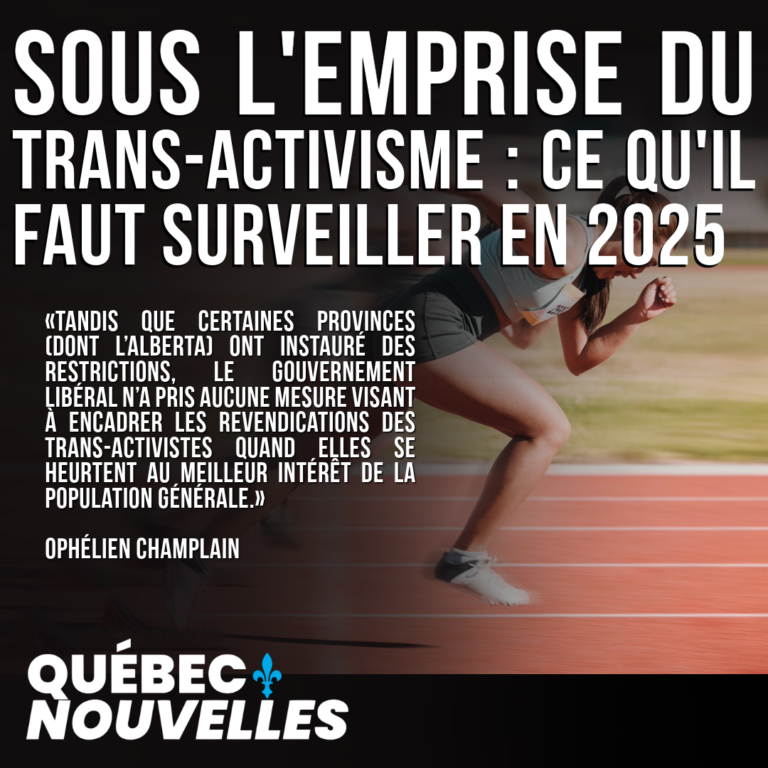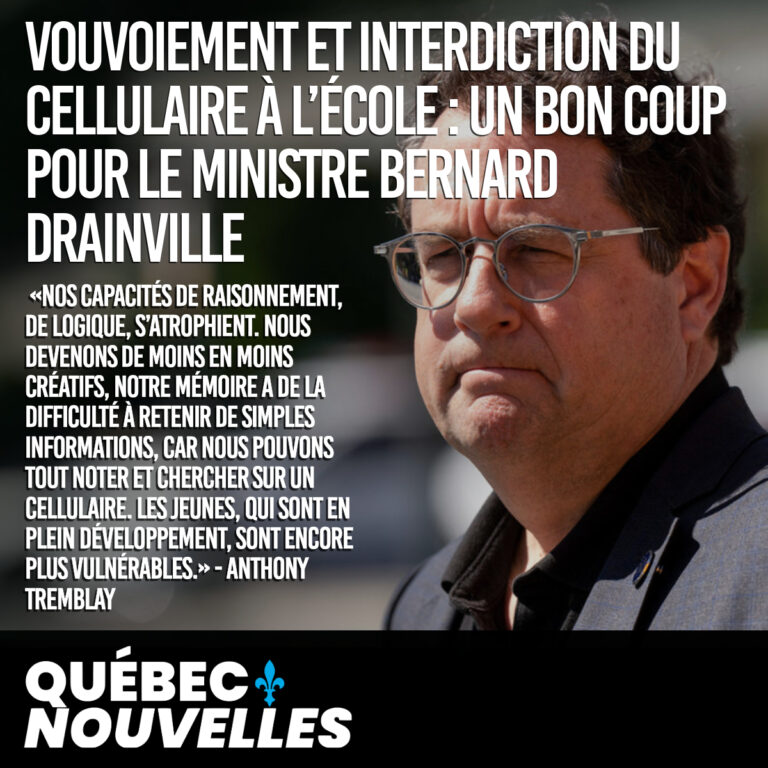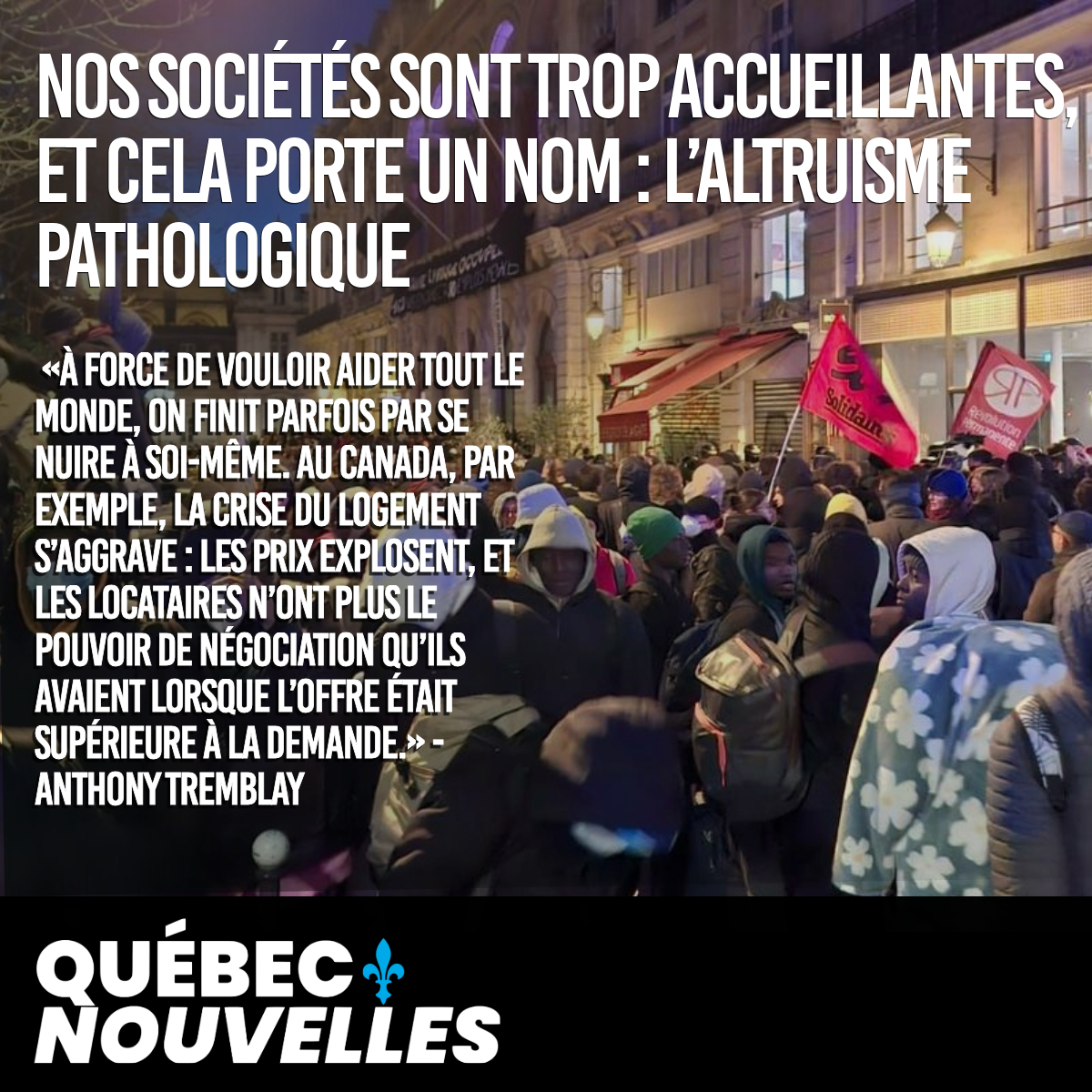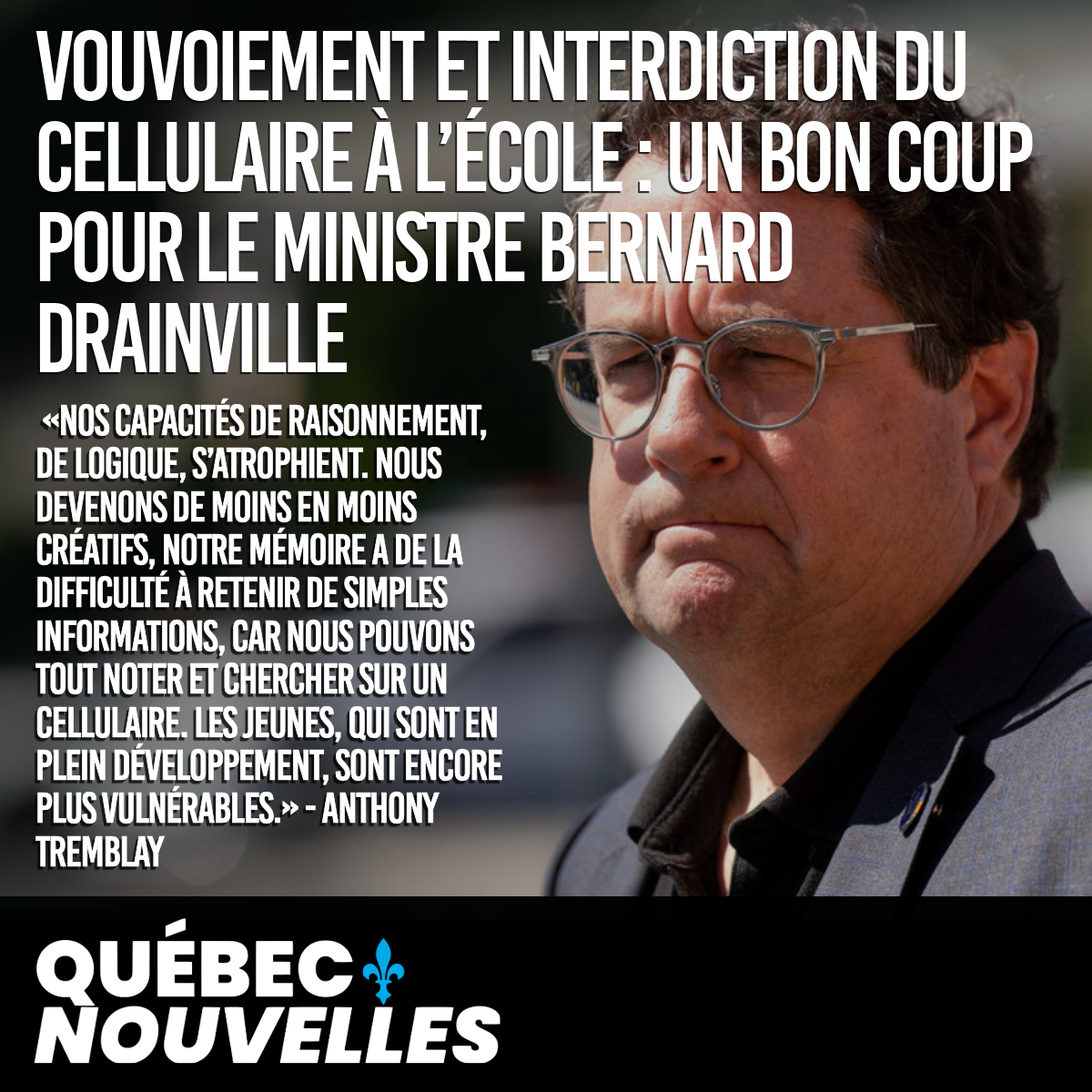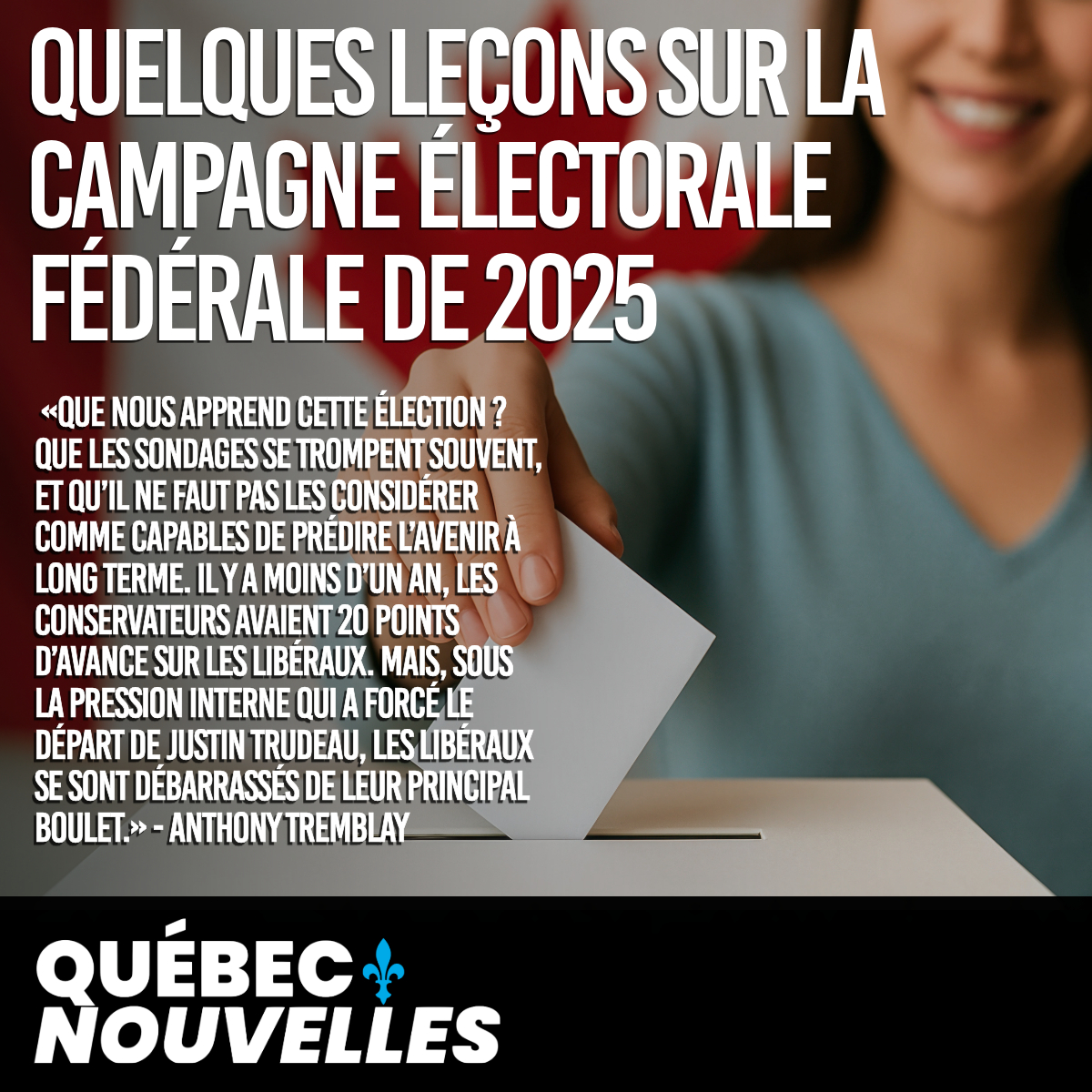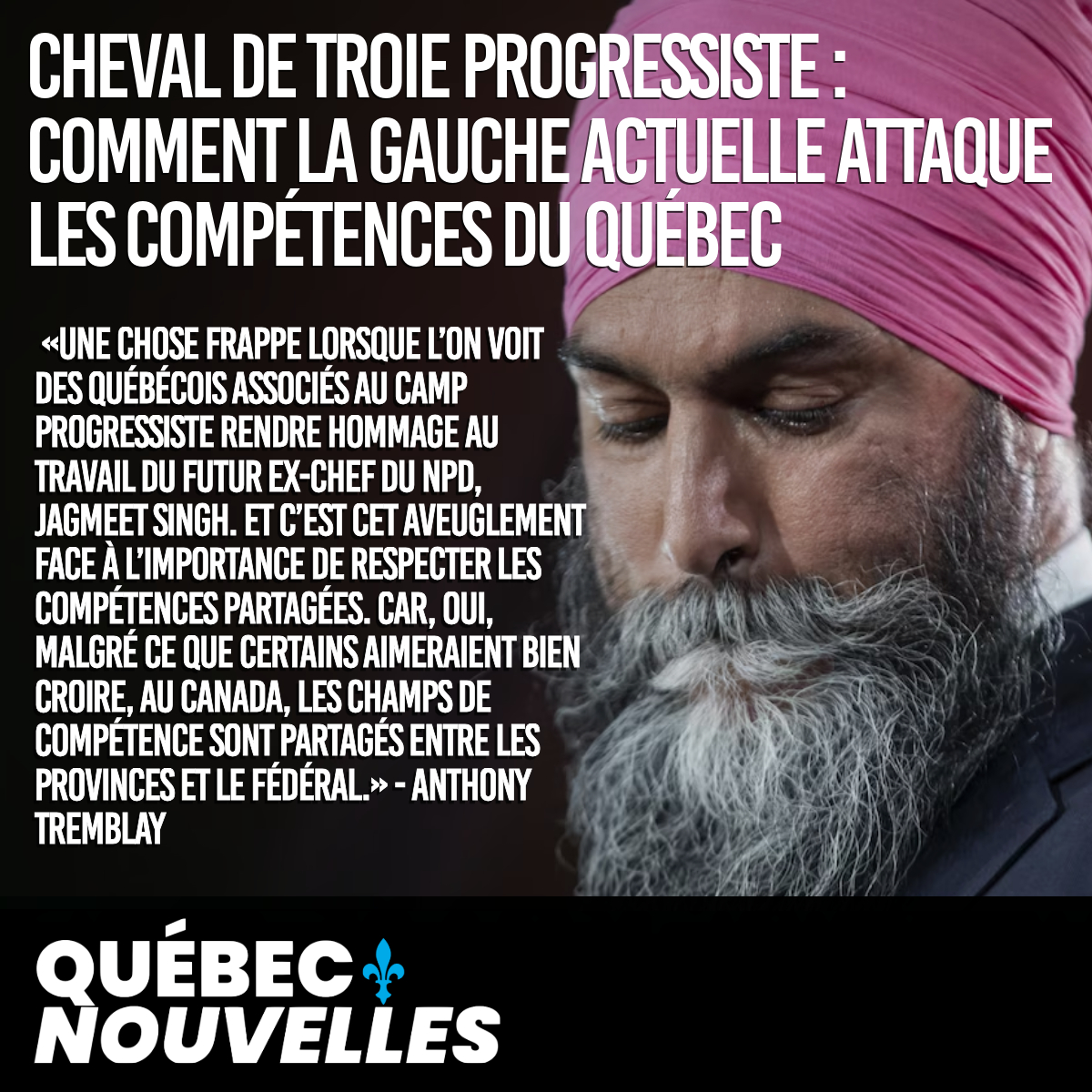Mardi 22 avril, un attentat terroriste a fait 26 morts au Cachemire indien. Des hommes armés ont demandé la religion d’un groupe de touristes, séparant ainsi hindous et musulmans, puis ont abattu les hindous. Dans un pays déjà très tendu politiquement, où l’hindutva – ce nationalisme qui veut faire de l’hindouisme la seule religion légitime en Inde – gagne du terrain, cet épisode a provoqué un véritable séisme. Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle guerre ?
Cet attentat a profondément choqué un pays particulièrement sensible aux tensions confessionnelles. Depuis l’arrivée au pouvoir, en 2014, du nationaliste hindou Narendra Modi, chef du BJP, l’Inde cherche à affirmer sa puissance sur la scène internationale et à restaurer l’hindouisme comme religion d’État, au détriment des minorités chrétiennes, musulmanes et sikhes.
Pourtant, près de 200 millions de musulmans vivent en Inde depuis des siècles, soit 16 % de la population. L’attaque s’est produite dans la région du Cachemire, la seule partie de l’Inde à majorité musulmane, et dont le territoire est disputé entre New Delhi et Islamabad.
Dans cette région himalayenne, certains groupes indépendantistes veulent rompre la tutelle indienne ; d’autres rêvent de rattachement au Pakistan, l’éternel rival. Les deux États partagent pourtant un passé commun : jusqu’en 1947, l’Inde et le Pakistan formaient les Indes britanniques. À l’indépendance, une partition hâtive en deux États – l’un « hindou », l’autre « musulman » – a semé les germes d’un conflit durable.
La première guerre indo-pakistanaise, en 1947, fit des millions de morts : hindous et musulmans traversaient la frontière pour rejoindre le pays « conçu » pour leur foi. D’autres affrontements ont suivi, avec des bilans variables.
Depuis, un nouvel équilibre de la terreur est né : l’Inde s’est dotée d’une arme nucléaire, grâce à l’aide du Canada qui a offert un réacteur civil pour le développement du pays, puis le Pakistan a fait de même, devenant le premier pays musulman détenteur de l’arme atomique.
Cette dissuasion mutuelle a jusqu’ici empêché tout conflit à grande échelle : deux milliards de vies seraient menacées en cas d’escalade nucléaire. Mais, suite aux attentats du Cachemire, que New Delhi attribue aux services secrets pakistanais, l’Inde a rompu son accord sur le partage des eaux de l’Indus.
Or ce fleuve irrigue 40 millions de Pakistanais et prend sa source dans l’Himalaya, du côté indien. En raison de l’attaque terroriste, l’Inde estime ne plus être tenue de respecter cet accord ; Islamabad y voit un acte de guerre. À court terme toutefois, New Delhi ne peut pas ralentir l’écoulement de l’Indus, faute de barrage, même s’il projette d’en construire depuis des années.
L’Inde, en forte croissance économique, cherche à réduire sa dépendance au charbon, qui fournit actuellement 75 % de son électricité, au prix d’une pollution grave — New Delhi enregistre régulièrement des taux de particules dangereuses.
Pour l’instant, l’Inde affirme avoir simplement mis fin à l’accord sur les eaux, sans pouvoir exercer de pression plus forte sur le Pakistan. Des escarmouches frontalières sont toutefois à craindre : Islamabad accuse déjà New Delhi de préparer une attaque dans les jours à venir.
Les enjeux sont immenses. Si des affrontements peuvent avoir lieu, il est peu probable qu’ils dégénèrent en guerre nucléaire : les dirigeants des deux pays savent qu’ils déclencheraient alors un engrenage incontrôlable.