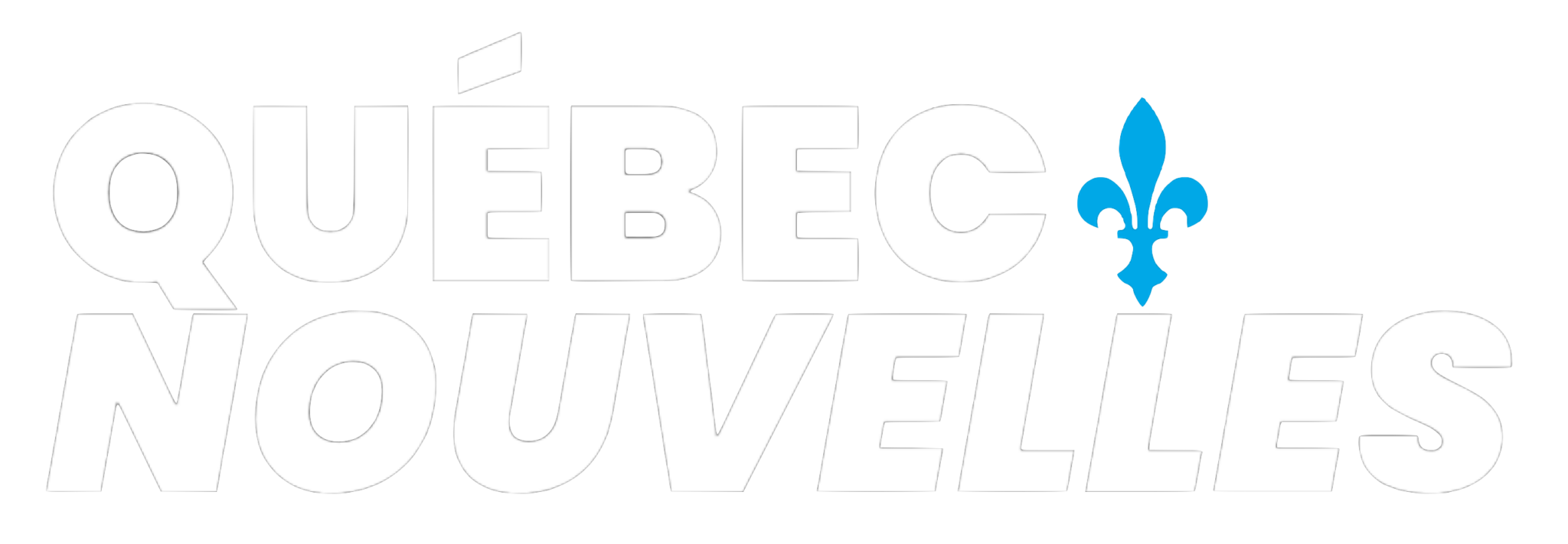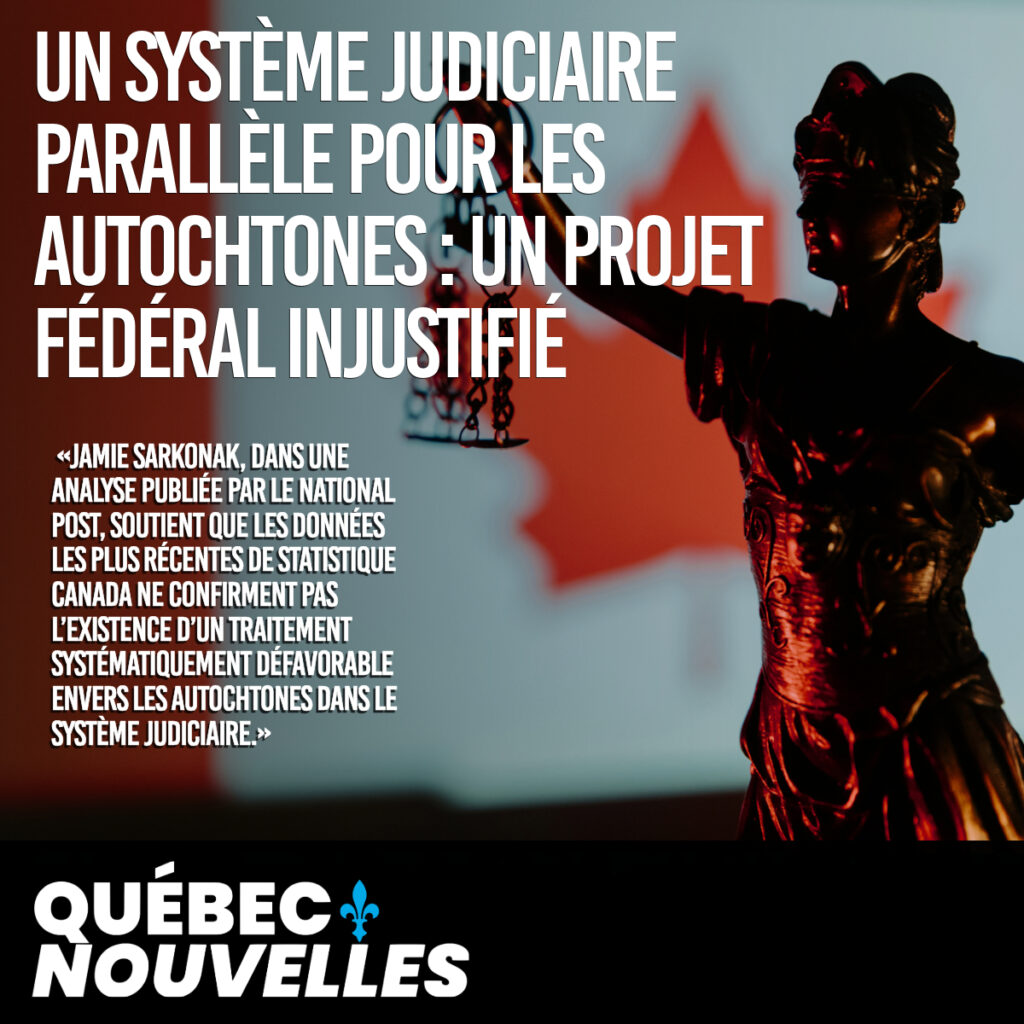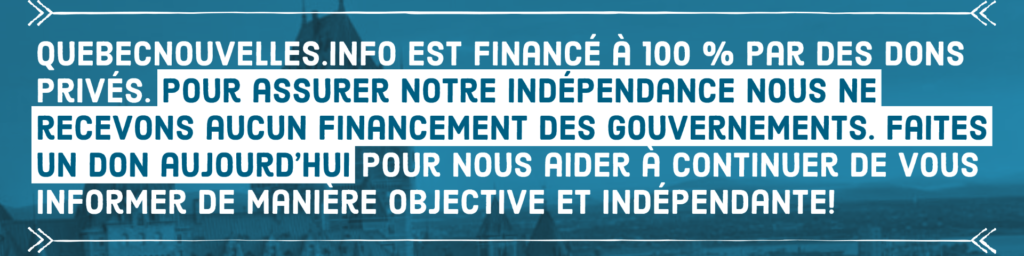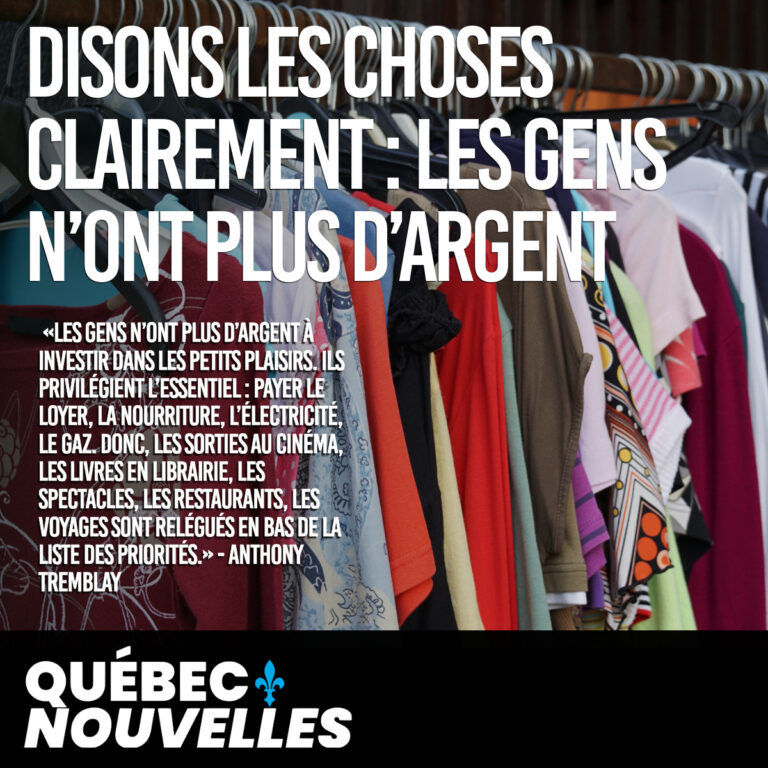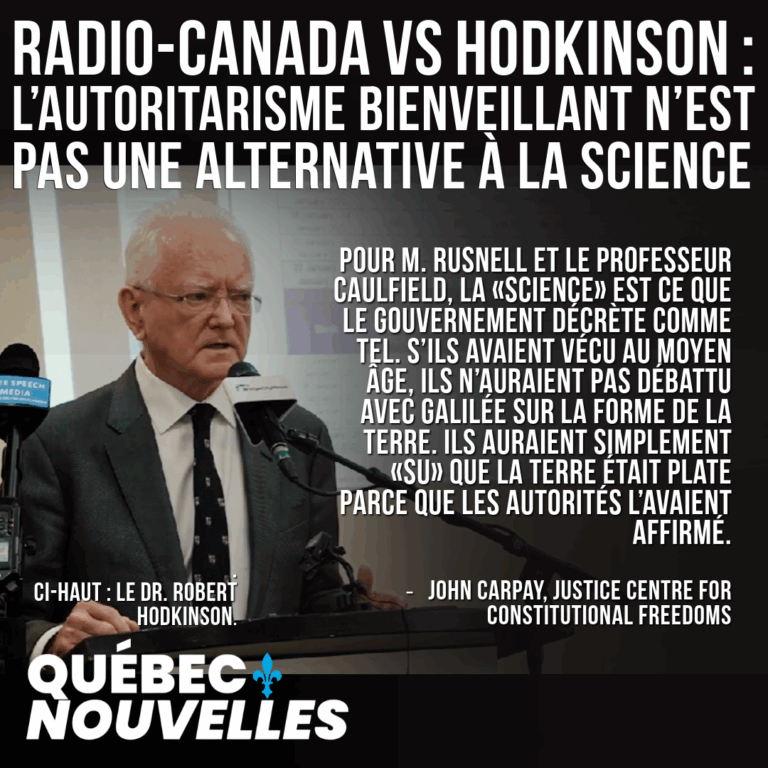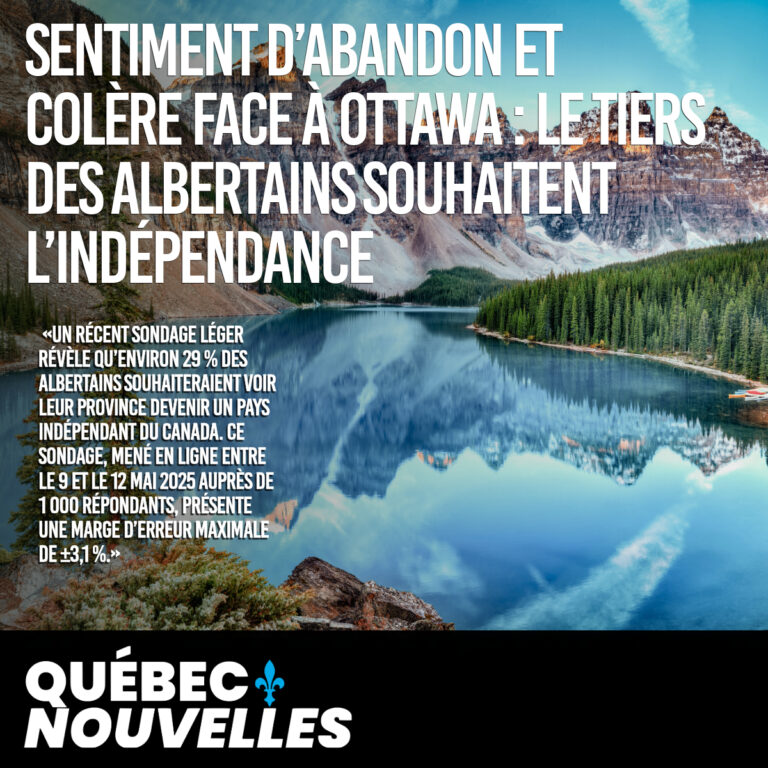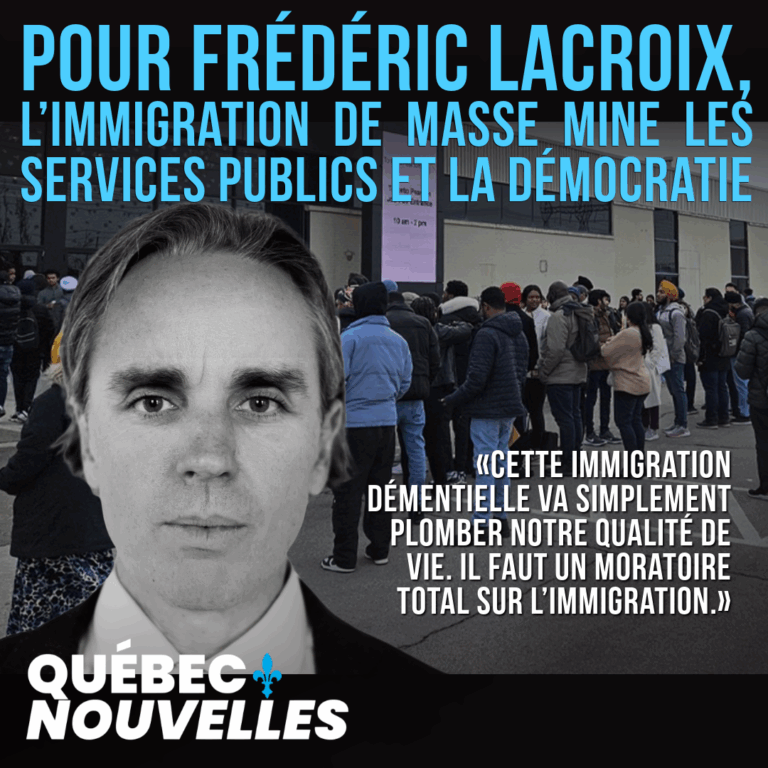D’après une analyse de Jamie Sarkonak publié dans le National Post le 22 mai 2025.
Alors que le gouvernement libéral de Justin Trudeau poursuit son initiative de transformation du système judiciaire canadien à travers la Stratégie de justice autochtone, lancée en mars dernier, plusieurs observateurs remettent en question le bien-fondé de cette approche. Jamie Sarkonak, dans une analyse publiée par le National Post, soutient que les données les plus récentes de Statistique Canada ne confirment pas l’existence d’un traitement systématiquement défavorable envers les Autochtones dans le système judiciaire.
« Il n’est pas nécessaire de bâtir un système parallèle de justice pénale pour les Autochtones », écrit Sarkonak, « surtout lorsqu’on constate que ceux-ci pourraient même parfois obtenir de meilleurs résultats que leurs homologues blancs. »
Des verdicts de culpabilité comparables
Une étude de Statistique Canada couvrant les années 2016-2017 à 2020-2021 démontre que, une fois la gravité des infractions prise en compte, les Autochtones accusés étaient aussi susceptibles que les Blancs d’être reconnus coupables. En d’autres mots, il n’y avait aucun biais systémique dans les verdicts eux-mêmes, lorsque les circonstances étaient équivalentes.
Sarkonak précise également que les accusations portées contre les Autochtones étaient deux fois plus susceptibles d’être suspendues (stayed), alors que les Blancs bénéficiaient davantage du retrait pur et simple des accusations — deux procédures aux effets similaires.
Des peines différentes selon l’origine
En matière de condamnation, certaines divergences apparaissent, mais elles ne pointent pas nécessairement vers une discrimination systémique négative pour les Autochtones :
- Les délinquants autochtones étaient plus souvent condamnés à des peines de prison, surtout s’il s’agissait de primo-délinquants.
- Toutefois, ils recevaient aussi davantage de peines courtes, tandis que les Blancs purgeaient des peines moyennes ou longues.
- Les Autochtones étaient entre 25 % et 35 % plus susceptibles de recevoir une assignation à résidence (house arrest) comme peine.
- Les Blancs, en revanche, recevaient plus souvent des amendes ou des périodes de probation.
- Enfin, les accusés blancs étaient plus susceptibles d’être acquittés.
Les causes structurelles en débat
Statistique Canada interprète plusieurs de ces écarts à travers le prisme du racisme systémique. L’organisme évoque notamment le nombre plus élevé de condamnations antérieures chez les Autochtones, qu’il relie à la marginalisation socioéconomique, au racisme et aux différences culturelles. Ces facteurs expliqueraient aussi leur plus grande propension à violer les conditions imposées par les tribunaux.
Jamie Sarkonak note pourtant que ces explications semblent fragiles lorsqu’on observe les résultats globaux. Par exemple, si les Autochtones ont en moyenne plus d’antécédents criminels, et que malgré cela ils sont déclarés coupables au même taux que les Blancs, cela pourrait suggérer que les antécédents des Blancs pèsent davantage dans les décisions judiciaires.
Une justice déjà orientée en faveur des Autochtones ?
Depuis l’arrêt R. c. Gladue de 1999, les juges canadiens doivent tenir compte de l’identité autochtone dans la détermination de la peine, ce qui s’est traduit par une tendance à imposer des peines réduites ou des sanctions alternatives. Le manuel fédéral des procureurs conseille même explicitement aux procureurs de demander des peines plus légères pour les Autochtones.
Sarkonak souligne que cette orientation est non seulement institutionnalisée, mais également promue politiquement :
« Ottawa pousse activement les tribunaux à accorder des peines plus clémentes aux Autochtones — avec moins de prison et plus d’assignation à résidence. »
De plus, les directives fédérales invitent les procureurs à tenir compte de l’identité autochtone lorsqu’ils évaluent s’ils doivent ou non porter des accusations, ce qui pourrait expliquer que les accusations contre les Autochtones soient plus fréquemment abandonnées avant le procès.
Des résultats judiciaires nuancés
La plus forte probabilité d’incarcération pour les Autochtones peut aussi s’expliquer, selon Sarkonak, par un taux plus élevé d’infractions dites « administratives », comme le non-respect des conditions de libération, les absences aux comparutions ou les violations de probation. Ces types d’infractions, indique-t-il, mènent plus souvent à l’incarcération.
Une stratégie idéologique plutôt qu’empirique
Sarkonak conclut que malgré une surreprésentation bien réelle des Autochtones dans les prisons canadiennes, les données ne permettent pas d’affirmer l’existence d’un racisme systémique dans le processus judiciaire. Le gouvernement Trudeau, en insistant sur cette idée, s’engage dans ce que l’auteur appelle une « croisade trudeaiste contre le racisme systémique », souvent au mépris des données empiriques.
La Stratégie de justice autochtone propose la création d’un système judiciaire parallèle, ainsi que des programmes de déincarcération et d’intervention racialisée, qui — selon Sarkonak — affaiblissent le principe d’égalité devant la loi.