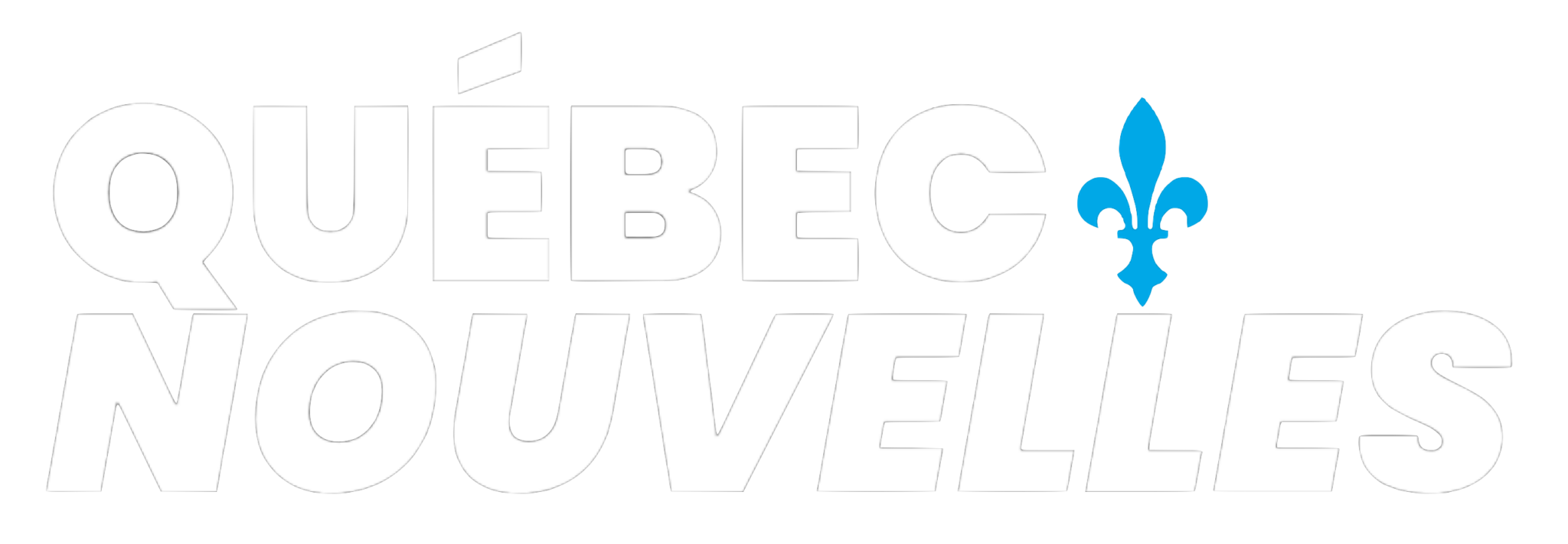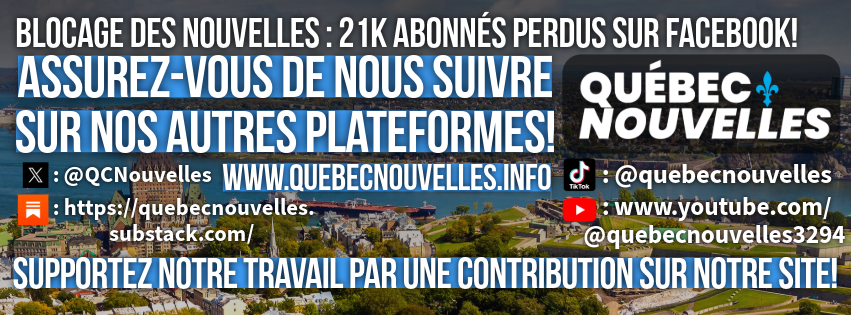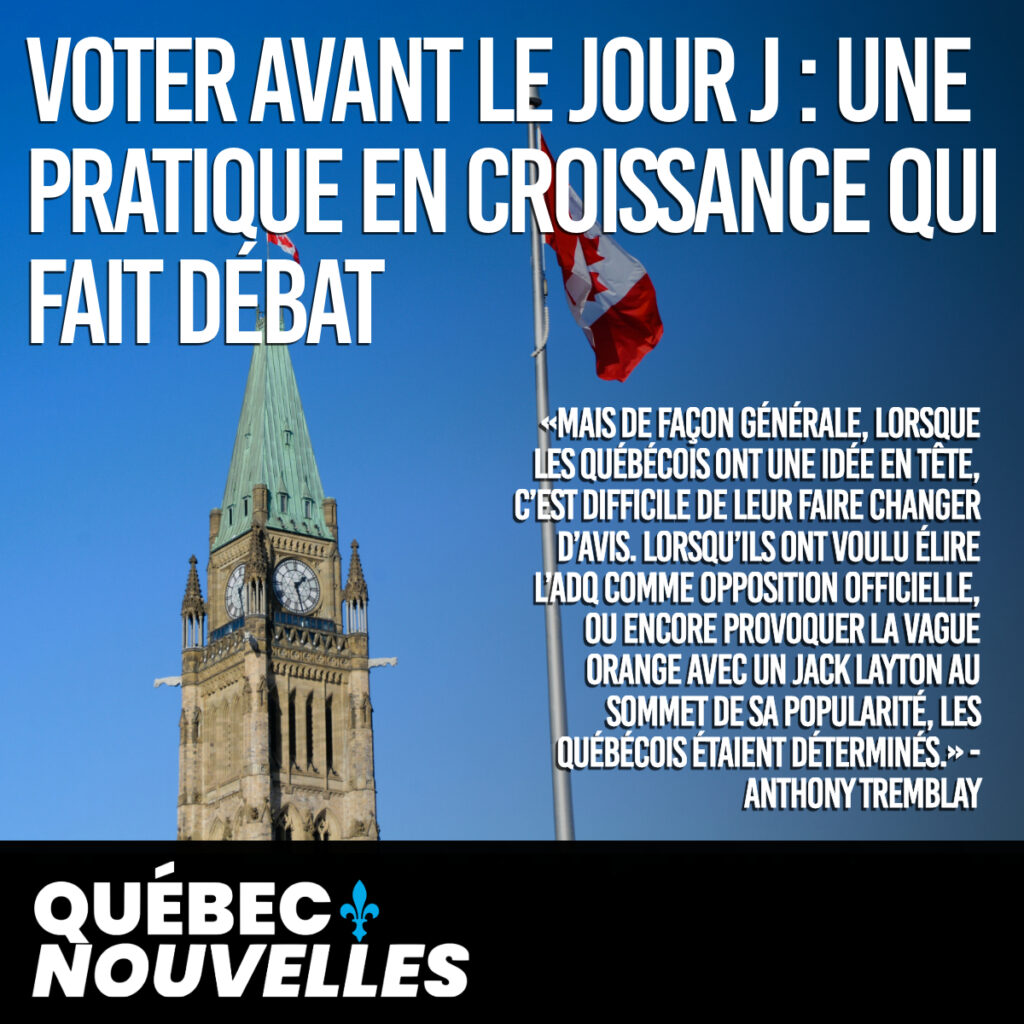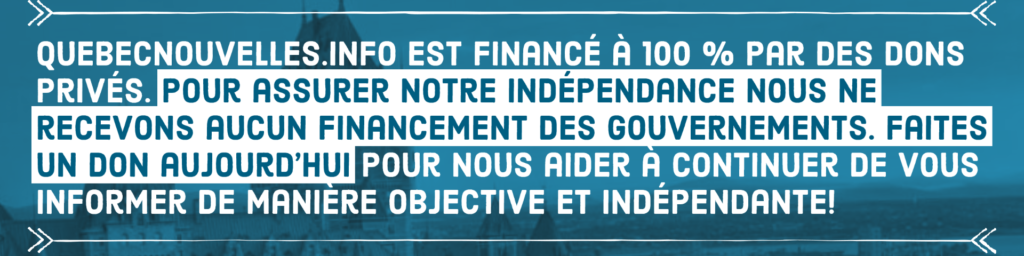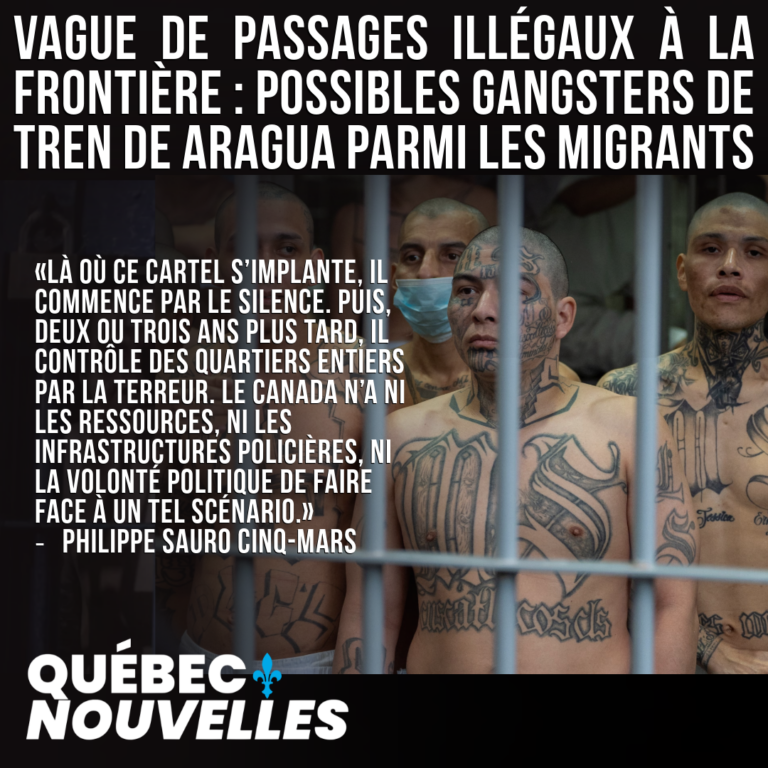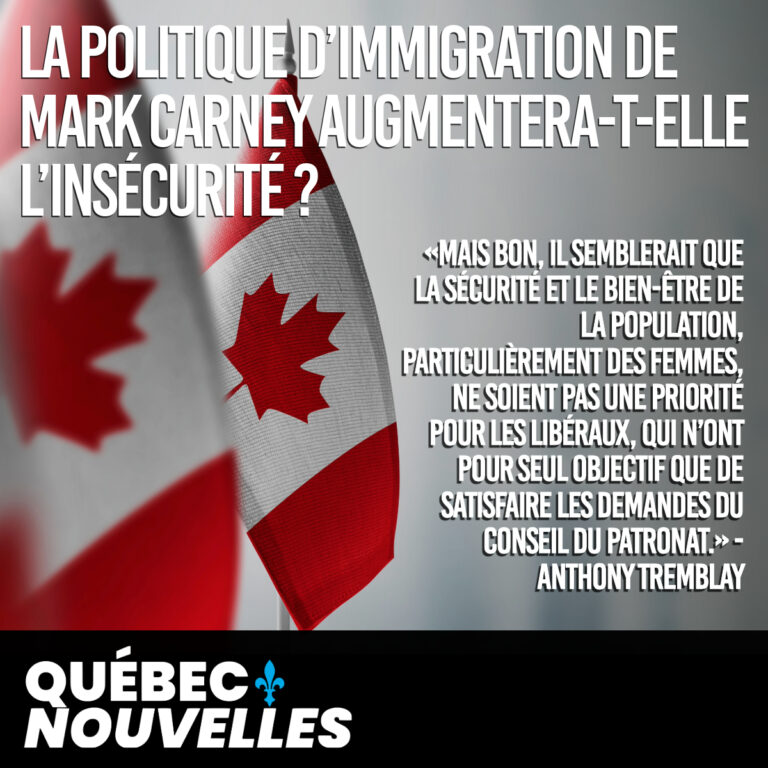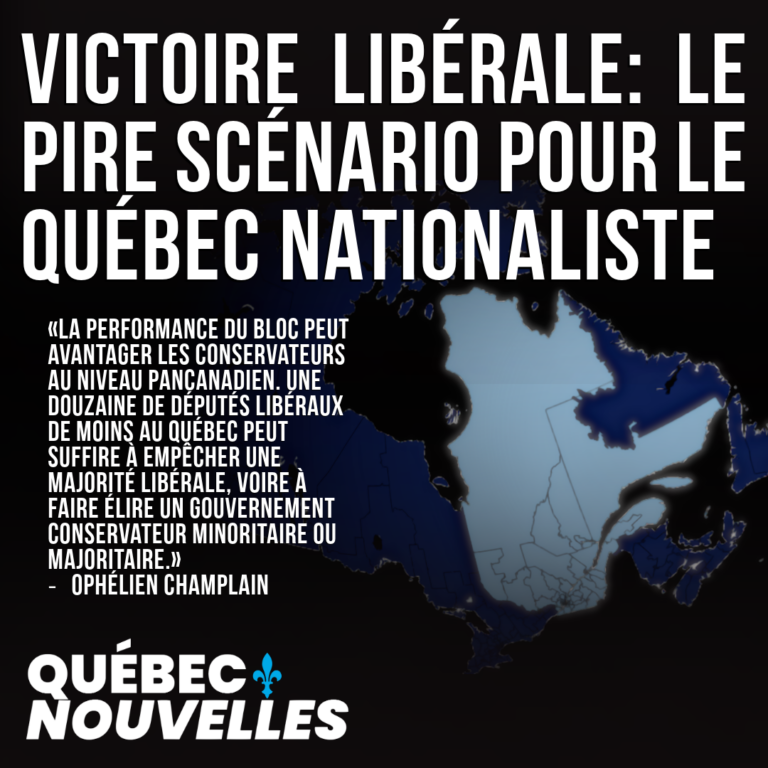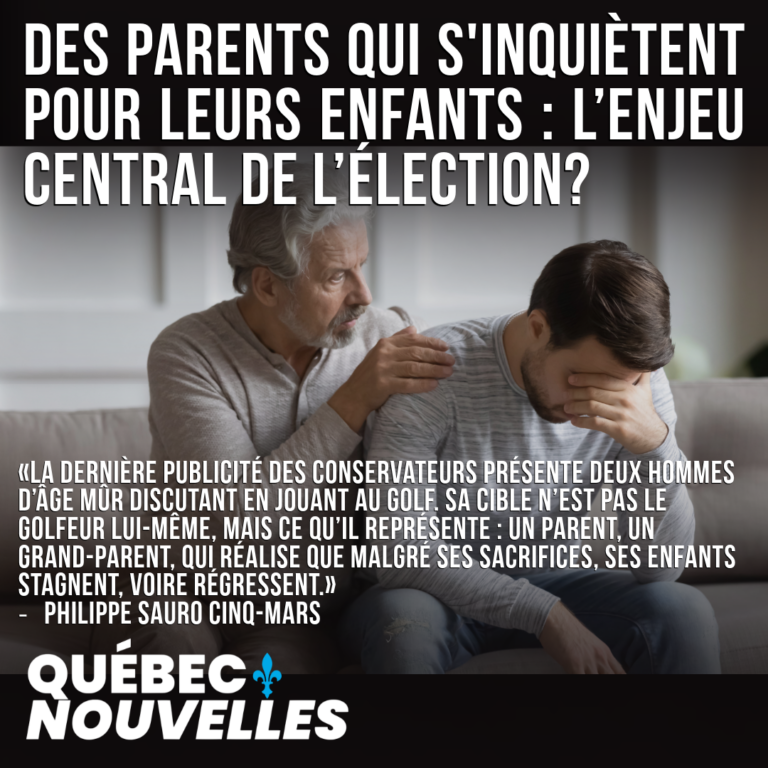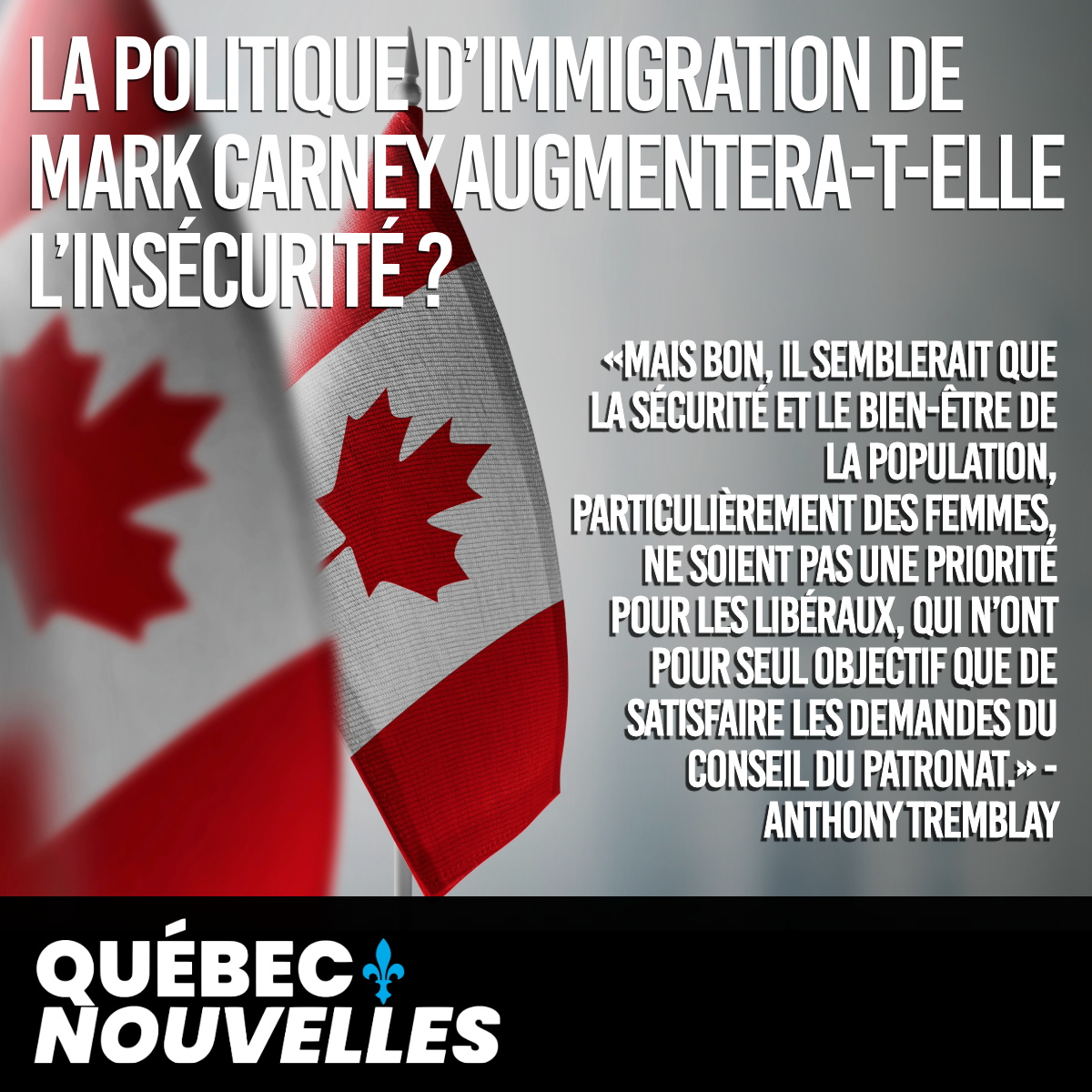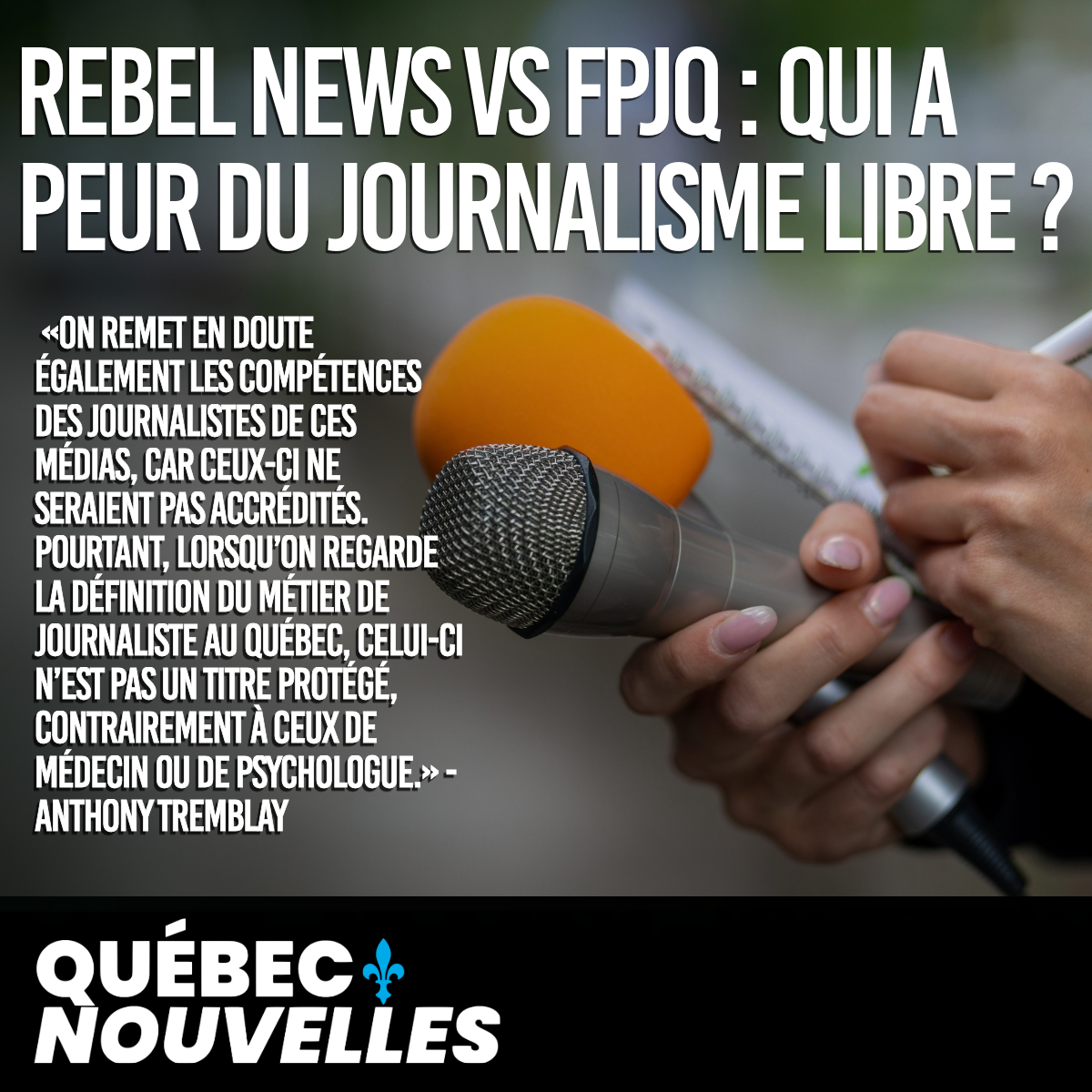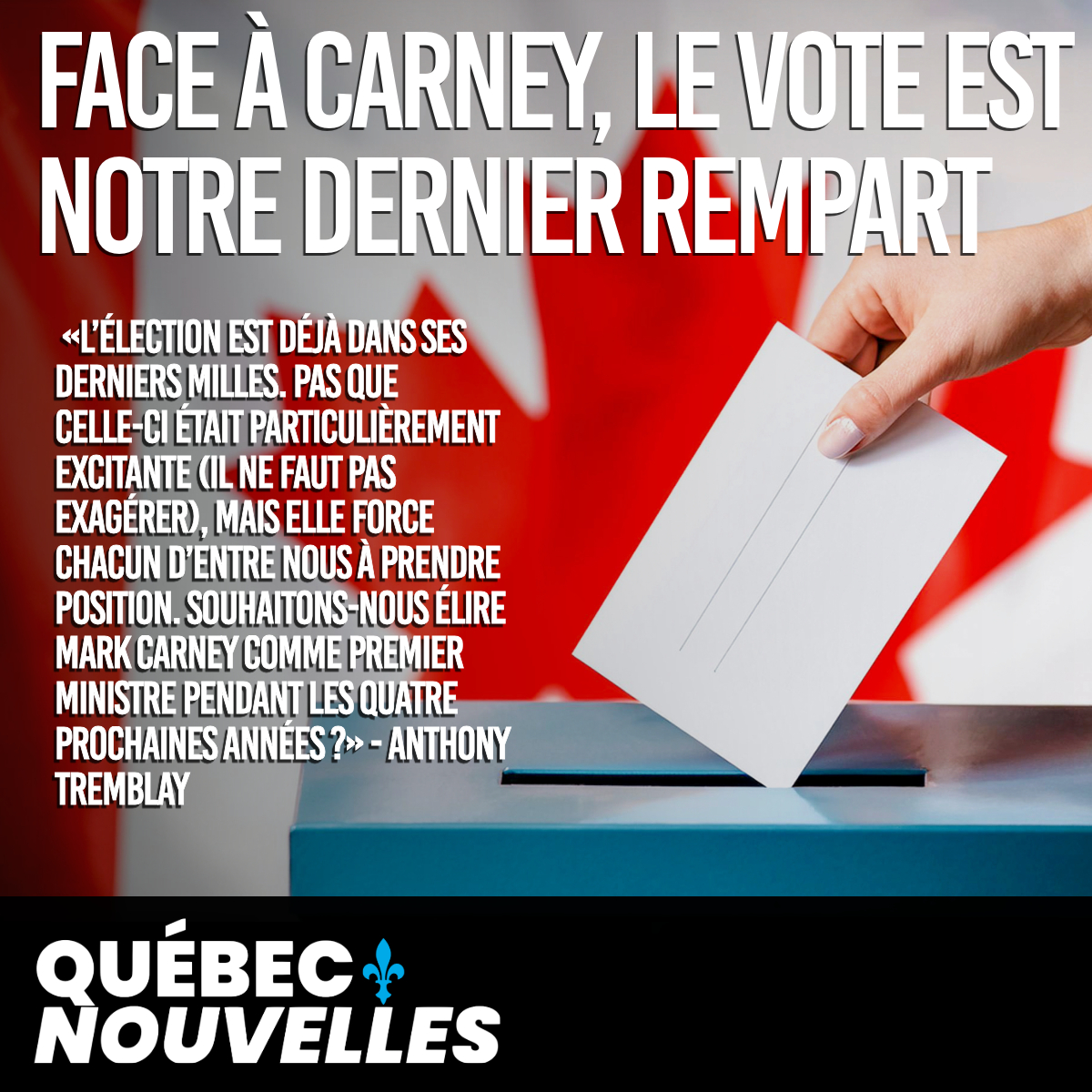Jean-François Lisée écrivait il y a quelques jours une chronique très pertinente dans les pages du Devoir. Il affirme que l’on désacralise le processus démocratique en permettant aux gens de voter par anticipation, et pas seulement le jour officiel du vote. Faut-il y voir un affront au sérieux que représente un vote démocratique, ou devrions-nous plutôt nous réjouir que des citoyens s’intéressent à la politique? Pas toujours évident.
Lisée est un grand politologue. Il fut conseiller de Jacques Parizeau lors du référendum de 1995, mais aussi un auteur politique prolifique. Normalement, lorsqu’il écrit un article dans les pages du Devoir, on a tendance à vouloir le lire. Et cet article, nommé sobrement Partir avant la fin, propose une critique intéressante du vote par anticipation, toujours plus populaire à chaque nouvelle élection.
Lisée se demande si nous serions prêts à quitter un mariage avant la fin, ou un film au cinéma avant que n’arrive le générique final. Dans le contexte des élections, voter avant la fin de la campagne, c’est potentiellement manquer des scandales ou des démissions. Mais c’est un peu plus compliqué que ça.
Bien sûr, les arguments de Lisée sont recevables. Mais, d’un autre côté, se peut-il que la popularité du vote par anticipation démontre que les citoyens s’intéressent malgré tout le cynisme ambiant à la politique? Nous devrions nous réjouir de la popularité de cette formule, qui permet de voter en dehors du jour officiel du scrutin — soit, dans ce cas-ci, le 28 avril.
Bien sûr, les gens peuvent hésiter. Le vote peut pencher d’un bord ou de l’autre, selon les controverses ou les bons coups des politiciens. Mais, en général, les gens ont quand même une idée ferme de ce qu’ils veulent. Par exemple, impossible de faire voter un fédéraliste pur et dur pour un parti indépendantiste!
Mais de façon générale, lorsque les Québécois ont une idée en tête, c’est difficile de leur faire changer d’avis. Lorsqu’ils ont voulu élire l’ADQ comme opposition officielle, ou encore provoquer la vague orange avec un Jack Layton au sommet de sa popularité, les Québécois étaient déterminés — même si cela a parfois mené à des catastrophes.
Le peuple québécois est comme ça. Il vit dans un monde ordinaire, où la vie quotidienne est prioritaire sur les grands enjeux internationaux. Est-ce mal en soi? Non, bien sûr. Cela indique un peuple paisible (parfois trop?), prêt à faire des compromis. Mais Jean-François Lisée pense trop comme un politicien, et non comme une personne du quotidien.
Il faut aimer son peuple comme il est. Avec ses belles qualités, mais aussi ses petits défauts. Nous pouvons nous réjouir de l’intérêt que les Québécois ont pour la politique, mais encore faut-il que cette attention, cette énergie, soit canalisée vers quelque chose de constructif pour l’avenir.
N’en demandons pas trop aux gens. C’est déjà bien qu’ils aillent voter, même s’il faut offrir des accommodements pour cela. Par exemple, instaurer un vote obligatoire serait contre-productif, puisque le projet des élus québécois devrait être la pédagogie, et non la coercition. Heureusement, cela n’est pas dans les projets du gouvernement.
Par contre, une chose qui ne devrait pas arriver, c’est le vote en ligne. Là-dessus, Lisée a raison. Comment prévenir la fraude en ligne, protéger les données et la légitimité du scrutin? Des puissances hostiles pourraient-elles favoriser certains candidats? Le mieux, pour le moment, c’est que les gens se présentent à un bureau près de chez eux pour voter.
Le débat est lancé sur la pertinence du vote par anticipation, et sur le fait qu’il soit ou non une forme de désacralisation d’un acte solennel, celui de voter. La seule journée, tous les quatre ans, où les citoyens ont le pouvoir — autrement délégué à des élus censés gouverner dans l’intérêt de tous. Ce qui, on ne l’apprend pas ici, n’est pas toujours évident.