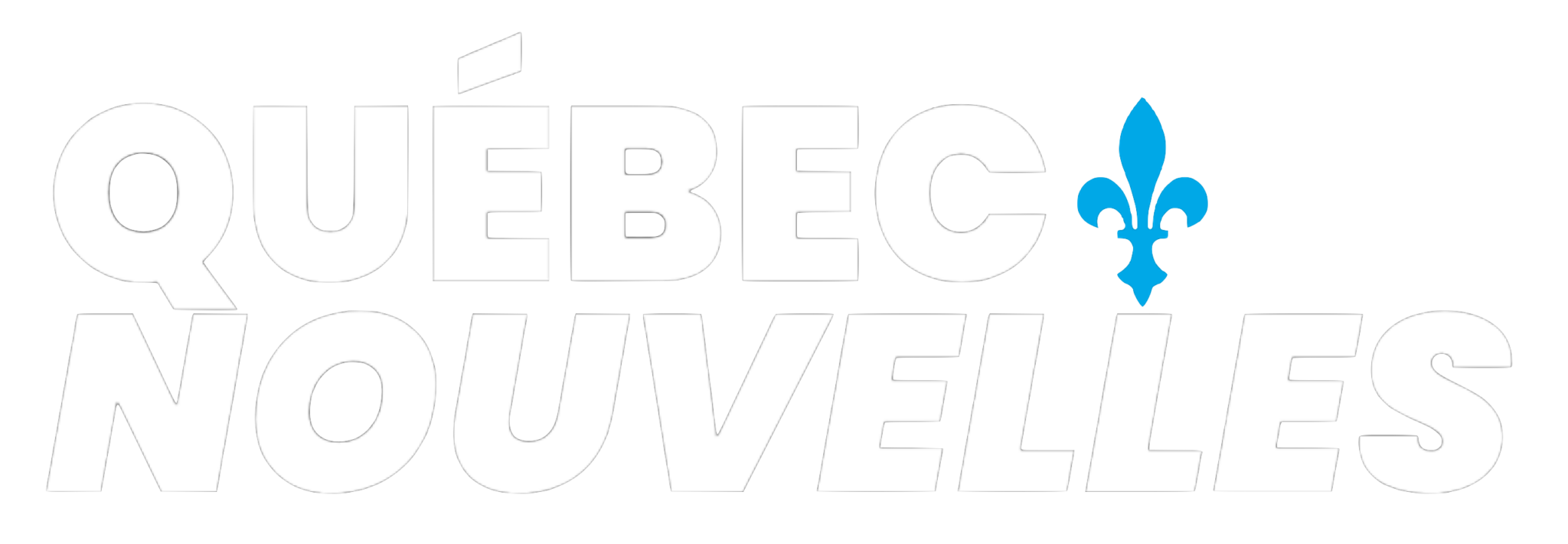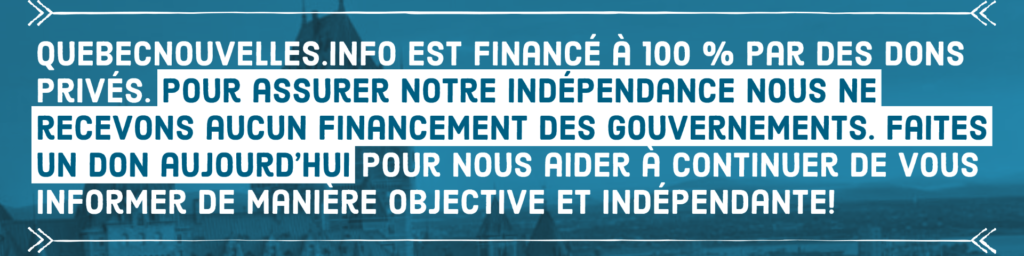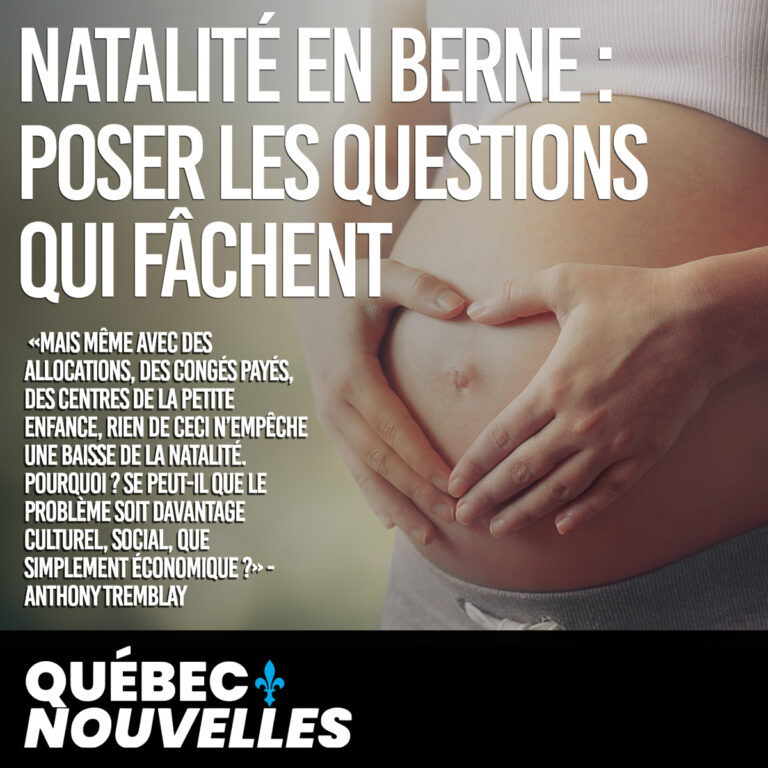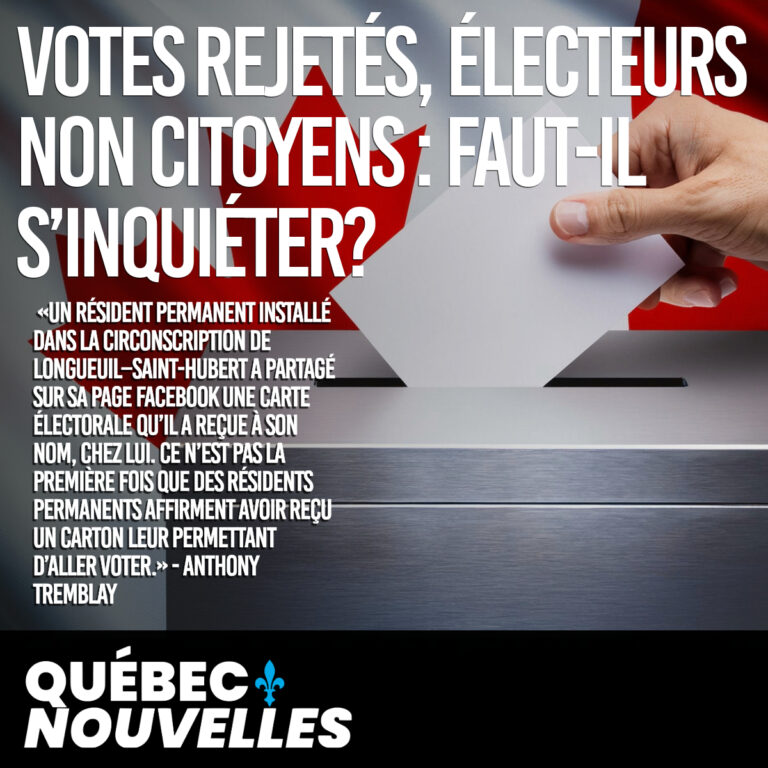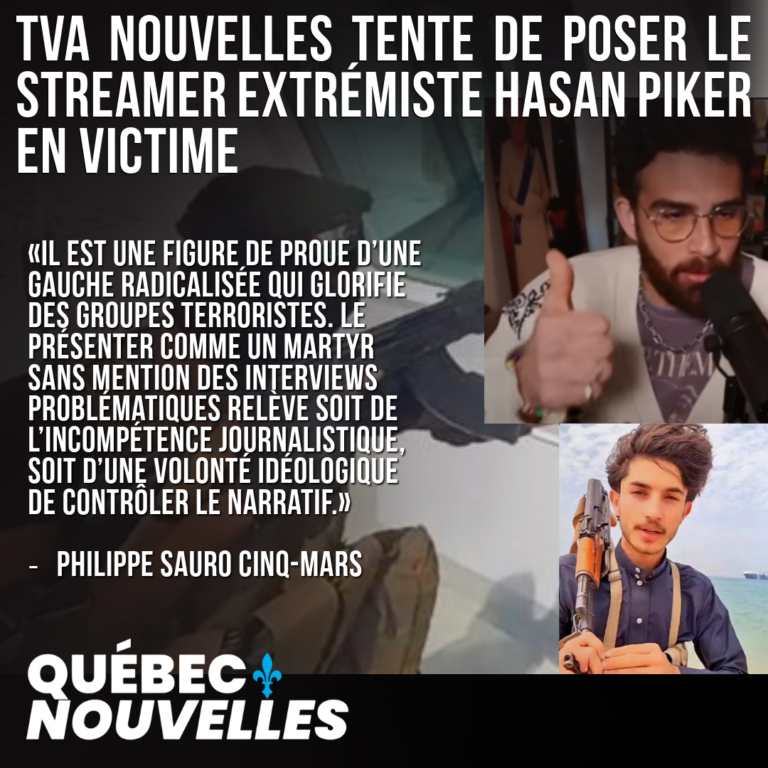Le monde de l’énergie renouvelable est secoué par une révélation explosive : des dispositifs de communication non documentés ont été découverts dans des onduleurs solaires fabriqués en Chine, selon une enquête fouillée de Sarah Mcfarlane pour Reuters. Ces composants, absents des schémas techniques officiels, pourraient permettre des accès non autorisés aux réseaux électriques — un cauchemar en matière de cybersécurité.
Dans un contexte d’électrification accélérée, au Québec comme au Canada, cette alerte soulève de graves questions de souveraineté technologique et énergétique. Car ces onduleurs, qui servent d’interface entre l’énergie produite (solaire, éolienne) et les réseaux publics, sont omniprésents… et largement dominés par les manufacturiers chinois.
Un système parallèle dans le réseau : la découverte d’un accès fantôme
L’enquête de Reuters révèle qu’un dispositif discret mais redoutable pourrait permettre à des acteurs extérieurs — y compris étatiques — d’interagir avec des infrastructures critiques sans autorisation. Le problème a été identifié aux États-Unis, où des analystes mandatés par des compagnies d’électricité et le Département de l’Énergie ont commencé à remarquer des communications anormales dans les flux de données.
Des radios cellulaires cachées
Dans certains cas, les onduleurs inspectés contenaient des radios cellulaires intégrées, non mentionnées dans les fiches techniques fournies par les manufacturiers. Ces modules permettent une connectivité indépendante du réseau local et peuvent contourner les pare-feu mis en place pour protéger les réseaux intelligents. Un expert cité par Reuters a résumé la menace ainsi :
« Cela revient à installer un interphone secret derrière la console principale d’un centre de contrôle. »
Les modules détectés peuvent émettre ou recevoir des signaux sans que le propriétaire ou l’opérateur ne le sache. Selon plusieurs sources du secteur, certaines communications détectées provenaient de serveurs situés en Chine, bien qu’il n’y ait pas encore de preuve irréfutable d’une exploitation malveillante à ce jour.
Les entreprises concernées
Les noms les plus fréquemment mentionnés sont Sungrow, Ginlong Solis et Growatt, trois géants chinois de l’onduleur, présents dans des dizaines de pays. Ces firmes dominent le marché non seulement pour des raisons de coût, mais aussi parce qu’elles sont fortement soutenues par l’État chinois. Des produits de Huawei, aujourd’hui interdits dans plusieurs pays pour leurs télécommunications, ont également été examinés dans ce contexte.
Selon des chiffres européens cités par Reuters, les trois plus gros producteurs chinois totalisent à eux seuls plus de 200 GW de capacité installée en Europe. En Allemagne, par exemple, les onduleurs Solis et Sungrow sont parmi les plus populaires chez les particuliers.
Réactions aux États-Unis
Le Department of Energy (DOE) et le Department of Homeland Security (DHS) suivent désormais l’affaire de très près. Plusieurs compagnies d’électricité américaines ont été invitées à mener des audits internes, souvent en collaboration avec des firmes privées de cybersécurité. Un haut responsable de la sécurité énergétique aux États-Unis a déclaré :
« Un adversaire pourrait exploiter ces canaux pour désynchroniser des segments du réseau ou saboter des équipements sensibles. »
À noter : certains de ces onduleurs sont utilisés non seulement dans des foyers ou des bâtiments commerciaux, mais aussi dans des fermes solaires de taille industrielle, ce qui élève le risque au niveau stratégique.
Un précédent militaire : la doctrine chinoise du contrôle énergétique
L’inquiétude est d’autant plus grande que la doctrine chinoise officielle, telle que décrite dans plusieurs publications du Parti communiste, inclut l’utilisation des infrastructures énergétiques comme leviers géopolitiques. L’idée que l’interconnectivité énergétique puisse servir à collecter des données ou à créer des points de pression en cas de conflit est bien documentée dans la doctrine militaire chinoise dite de la « guerre hors-limites ».
Pour les États-Unis et leurs alliés, cette découverte est donc interprétée à la lumière d’une stratégie plus large de prise de contrôle — non militaire — de réseaux critiques à l’étranger.
Une technologie bon marché… mais à quel prix ?
Les manufacturiers chinois d’onduleurs ont conquis les marchés mondiaux en partie grâce à des prix imbattables et une très grande flexibilité d’intégration. Mais cette efficacité industrielle cache aussi une opacité structurelle : documentation incomplète, composants soudés de manière à rendre leur identification difficile, et mises à jour logicielles impossibles à auditer.
L’un des experts interrogés par Reuters conclut ainsi :
« Vous ne pouvez pas gérer la sécurité nationale d’un pays avec du matériel à 30 dollars non vérifiable. »
Un Québec électrifié, mais vulnérable ?
Le Québec s’est engagé dans une transition énergétique ambitieuse, visant à électrifier ses transports, mais beaucoup de cela repose sur des technologies vertes expérimentales comme le solaire. Le gouvernement de François Legault a fixé l’objectif de 2 millions de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030. Cependant, avec environ 250 000 véhicules électriques en circulation en 2023, cet objectif semble difficile à atteindre.
Parallèlement, le gouvernement investit massivement dans l’infrastructure de recharge, avec un plan de 514 millions de dollars pour installer plus de 100 000 bornes de recharge publiques d’ici 2030. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui prévoit plus de 9 milliards de dollars sur cinq ans pour décarboner l’économie québécoise.
Au niveau fédéral, le Premier ministre Mark Carney a annoncé une réorganisation du cabinet pour faire face aux défis économiques et diplomatiques, notamment en réduisant la dépendance à l’égard de l’économie américaine et en investissant dans la diversification économique. On promet beaucoup d’engagements énergétiques… et toujours beaucoup de technologie vertes et de solaire.
Or, nous savons que ces efforts entrepreunariaux ici se heurtent à la domination chinoise dans le secteur des technologies vertes. La Chine contrôle près de 95 % des composants clés des modules photovoltaïques solaires et 40 % de la production mondiale de polysilicium. De plus, des entreprises chinoises comme BYD, soutenues par d’importantes subventions gouvernementales, dominent le marché mondial des véhicules électriques.
D’ailleurs, le 5 mai dernier, le P.D.G. d’Hydro-Québec, Michael Sabia, annonçait le lancement d’un appel d’offre pour ajouter 300 mégawatts (MW) d’énergie solaire à son réseau. Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action 2035 de la société d’État, qui vise à diversifier les sources d’énergie et à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. De plus, Hydro-Québec offrira dès 2026 «une aide financière pour soutenir l’installation de panneaux solaires. Les clients qui produisent leur propre énergie solaire peuvent la revendre à la société d’État et ainsi réduire leur facture d’électricité.» (Radio-Canada)
Cette démarche représente une première étape vers le développement de la filière solaire au Québec, encore peu présente dans la province. En 2021, Hydro-Québec avait inauguré deux centrales solaires expérimentales à La Prairie et à Varennes, d’une puissance installée combinée de 9,5 MW, produisant environ 16 gigawattheures (GWh) d’énergie solaire par année, soit l’équivalent de la consommation de 1 000 clients résidentiels.
Le développement de l’énergie solaire, plus productive en période estivale, vise notamment à compléter l’offre de l’énergie éolienne, plus utiles en période hivernale.
Cependant, cette expansion de la filière solaire soulève des préoccupations quant à la dépendance envers les équipements chinois. La récente révélation de dispositifs de communication non documentés dans certains onduleurs solaires chinois met en lumière les risques potentiels pour la sécurité des réseaux électriques. Dans ce contexte, il est crucial pour le Québec de s’assurer que les équipements utilisés dans ses projets d’énergie solaire respectent des normes de sécurité strictes et proviennent de sources fiables.
Un enjeu global : la sécurité énergétique au XXIe siècle
Ce que révèle cette affaire, c’est une vulnérabilité stratégique profondément enracinée dans le modèle économique actuel : celui d’une dépendance à l’innovation low-cost chinoise dans des secteurs critiques comme l’énergie, les batteries et les télécommunications.
Alors que le Canada et le Québec veulent devenir des champions de la transition énergétique, ils risquent d’installer chez eux des chevaux de Troie technologiques. D’autres pays réagissent : la Lituanie a interdit les onduleurs Solis en 2023 ; l’Estonie audite désormais tous les dispositifs connectés à son réseau national.
Des questions urgentes s’imposent :
- Qui certifie la sécurité des composants importés ?
- Pouvons-nous réellement faire confiance à du matériel subventionné par un gouvernement autoritaire ?
- Sommes-nous prêts à sacrifier la souveraineté numérique pour l’électrification rapide ?
Diversification énergétique, mais aussi technologique
Les révélations de Reuters ne sont pas à prendre à la légère. Elles rappellent une leçon fondamentale : on ne peut pas bâtir une société durable sur des bases technologiques instables. La transition énergétique ne doit pas se limiter à l’électrique et aux vœux pieux de production locale — elle doit aussi inclure un audit rigoureux des chaînes d’approvisionnement.
Cela suppose :
- Une production locale ou alliée de composants critiques (onduleurs, batteries, modules de recharge) ;
- Un renforcement des capacités de certification indépendante ;
- Un débat politique sérieux sur les risques d’intégration de technologies étrangères sensibles.
Si le Québec veut rester maître de son avenir énergétique, il devra aussi devenir maître de sa technologie énergétique.